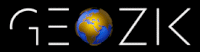Mali - Parole d'ancêtre songhay 1/2
Les Songhay représentent une ethnie importante de la cité de Tombouctou (Mali). Leur littérature orale se compose d'influences culturelles sahariennes et subsahariennes puisque cette ville est entre autres composée de Touareg, de Songhay, de Bella et d'Arabes. Les croyances religieuses des Songhay est faite d'une perméabilité entre animisme et islam.
© Amadou Coulibaly alias Daniel Coulibaly & Patrick Kersalé 1993-2024. Dernière mise à jour : 14 septembre 2024.
SOMMAIRE
. Kabani
. Le gros oiseau
. Deux hommes loyaux
. Dialadio le prodigue
. Le lion, la panthère et l’hyène
. Dimba, le marabout et le monstre
. Guirzile le crocodile
. L’homme gourmand
. La selle d’or de la ville de Say
. Les orphelins
. L’honneur, en fin de compte
. La fidélité
. Pourquoi l’hyène marche-t-elle en boitillant ?
. Que justice soit rendue
. Au pays de Sa
. Un malheur n’arrive jamais seul
. Deux trouvailles providentielles
. Famine dans le village des animaux
. L’ultime sacrifice
. La femme infidèle
. La jeune fille et le taureau
. Le chat et les souris
. Le cultivateur et le lièvre
. Le lièvre et l’hyène font du jardinage
. Le lièvre et l’hyène vendent leur mère
. Le lièvre, l’hyène et le chasseur
. Le lion, l’hyène et le lièvre
. Le mariage du monstre de la brousse
. Le poisson d’or
. Le secret dévoilé
. Leçon de chasse
. Ma fille en sacrifice
. Pourquoi personne ne voit la mort
. Parole, ne coupez pas…
. Répands le bien autour de toi
. Un juste retour des choses
. Une femme exemplaire
. Une leçon d’humilité
. Digna
. Le sel, la poule et la brebis
. Le chien, le lièvre et la biche
. La lionne et la chamelle
. La partie de danse
. La méchante marâtre
. L’orpheline et l’arbre
. Le vieux crapaud musicien
. La force de l’amour maternel
. La jeune fille et la sorcière
. La poule et le chat
. Le bracelet de Sirou
. Le serment trahi
PISTES PÉDAGOGIQUES
- Lecture. Silencieuse ou à haute voix.
- Chantefables. Improvisez ou créez des mélodies sur deux ou trois notes pour interpréter les parties chantées.
- Thématiques. Sélectionnez une thématique dans le chapitre « Caractéristiques culturelles » et recherchez les termes dans le PAE. Croisez les divers textes répondant à vos critères s'il en est et étudiez les similarités. Par exemple, le “lièvre” : que/qui représente-t-il, quels sont ses traits de caractères…
- Culture saharienne. Découvrir, dans les textes, ce qui est propre à la culture saharienne.
- Allez plus loin avec les Éditions Lugdivine.
Avant-propos
Ce PAE présente des récits traditionnels des Songhay de Tombouctou et des environs, ainsi que quelques textes des Zarma qui partagent nombres de caractéristiques culturelles avec les premiers.
Même si l’Afrique subsaharienne possède peu de littérature écrite, elle est riche d'un immense patrimoine de littérature orale transmis de génération en génération, soit verbalement, soit par l’intermédiaire des tambours. Autrefois littérature vivante, elle tend aujourd’hui à se raréfier avec l'avènement des médias modernes. Elle véhicule des éléments de connaissance remontant à des temps immémoriaux — parfois plus de deux millénaires ! — et s’enrichit à chaque nouvel événement politique, économique, météorologique… Contes, légendes, mythes, épopées, énigmes, devinettes, charades, proverbes, chansons, chantefables, prières, incantations... autant de qualificatifs susceptibles de désigner la variété de ses formes. Littérature publique détenue par tout un chacun ou encore segmentée par une stricte réglementation de la tradition, elle est souvent objet de pouvoir pour qui détient sa connaissance. Qu’il s’agisse d’éduquer, de jouer, d’initier, de rendre la justice, d’invoquer les esprits, de rendre hommage, d’entraîner la mémoire, il est toujours un mot ou un texte adapté, appartenant à ce gigantesque patrimoine.
La littérature orale présentée ici dépeint divers traits de la société songhay, par extension de l’Afrique occidentale et plus largement encore de l’Afrique saharienne et subsaharienne. En effet, les récits voyagent avec les hommes et se retrouvent à quelques variantes près, aux quatre coins du grand continent.
Les nombreux récits d’animaux dans lesquels le lièvre et l’hyène tiennent une place prépondérante, nous renseignent sur la morale et ne sauraient cacher la pertinence de leur rôle pédagogique ! D’autres font état de la place privilégiée des griots dans la société songhay, de l’importance de la fidélité, du pouvoir des devins, de l’importance de l’amour et du pardon, de la valeur de la parole, de la soif de justice…
Ces “pages” de littérature orale ont été collectées par Amadou Coulibaly, lui-même songhay natif de Tombouctou. Il parle plusieurs langues du Mali : songhoy, tamasheq, foulfouldé, bambara. Il a fait appel à sa propre mémoire pour certains récits de cet ouvrage et en a collecté d’autres auprès de sachants.
Exceptionnellement dans le monde de la littérature orale, chaque texte est nommément attribué au narrateur-source.
Les Songhay & Tombouctou
Les Songhay sont un peuple de la vallée du fleuve Niger vivant principalement du travail de la terre et de l'artisanat. Ils constituent un groupe ethnique important du Mali, du Niger, du Nord du Bénin, présent aussi en minorité au Nigeria et au Burkina Faso. L'Empire songhay a connu un rayonnement important à la fin du XVe et au début du XVIe siècle.
Tombouctou est une ville du Mali située à une douzaine de kilomètres au nord du fleuve Niger. Surnommée « la ville aux 333 saints » ou « la Perle du désert », elle est une cité historique de renommée mondiale, classée par l'UNESCO à plusieurs titres au Patrimoine mondial de l'humanité.
Caractéristiques culturelles
De nombreuses publications existent sur les Songhay. Nous en avons listé un certain nombre dans la bibliographie à la fin de ce PAE. Aussi, nous nous sommes limités à lister sous forme de séries thématiques classées alphabétiquement, les éléments pertinents contenus dans les récits, bases d'une possible démarche pédagogique.
Animaux sauvages : Cigogne, corbeau, crapaud, crocodile, éléphant, épervier, hippopotame, hyène, lion, mouche, moustique, panthère, porc-épic, scorpion, silure, singe, souris, termite, vautour. Autrefois, de grands animaux peuplaient les zones sahéliennes, mais aujourd’hui, la plupart d’entre eux ont disparu.
Animaux domestiques
- Âne, chameau : utilisés pour le transport des marchandises et des personnes. Les chameaux sont la propriété des Touareg ; les Songhay de Tombouctou n’en possèdent pas.
- Bœuf, chèvre, mouton : animaux élevés par les Peul*.
- Cheval : n’est plus aujourd’hui qu’un lointain souvenir à Tombouctou.
- Chien, chat : animaux errants arpentant jour et nuit les rues de Tombouctou.
- Poule.
Acteurs imaginaires
- Monstres polycéphales.
- Anthropomorphes et aquatiques : comme dans la plupart des contes merveilleux du monde entier, les contes songhay présentent leurs propres héros monstrueux.
Acteurs physiques
- Captif de case : même si l’esclavage est aujourd’hui aboli, cette notion est tellement ancrée dans la conscience des Songhay de Tombouctou, que maîtres et esclaves du passé connaissent et observent encore certaines prérogatives et servitudes liées à leurs statuts respectifs. Ils étaient chargés des tâches domestiques et participaient aux travaux champêtres.
- Chef de guerre : ancien peuple guerrier, les Songhay comptaient de redoutables chefs de guerre.
- Chef de village : le chef de village peut, selon des lieux et les époques, posséder des pouvoirs plus ou moins étendus : responsabilité administrative, pouvoir exécutif, chefferie coutumière…
- Circonciseur : les Songhay étant musulmans, ils pratiquent la circoncision. Les circonciseurs songhay se transmettent les secrets par filiation patrilinéaire. Ils sont appelés wanjam en songhay et wanzam en zarma.
- Féticheur, charlatan : devin qui fait parler les fétiches.
- Forgeron : fabrique les outils des cultivateurs, des pêcheurs et des chasseurs. Il travaille également les métaux précieux pour la bijouterie.
- Griot : musicien, généalogiste, louangeur… Les griots constituent une caste.
- Marabout : homme pieux, saint de l'islam, dont le tombeau est un lieu de pèlerinage. Les marabouts songhay pratiquent aussi la sorcellerie.
- Sorcier : bien que musulmans, les Songhay possèdent une grande tradition de sorcellerie et de magie.
Activités
- Agriculture : Tombouctou étant située à 13 km du fleuve Niger l'agriculture dans la ville même est inexistante.
- Chasse : aujourd’hui, la chasse est inexistante à Tombouctou compte tenu de la raréfaction du gibier.
- Commerce de perles, d’étoffes de soie et d’épices : autrefois, les caravanes de chameaux rapportaient ces marchandises précieuses d’Orient.
- Cuisson du pain : dans les rues de Tombouctou, on trouve des fours en banco*, dans lesquels les femmes font cuire leur pain au feu de bois.
- Extraction du sel : aujourd’hui encore, le sel est extrait en plaques à Taoudenni par les Arabes (Laarow-terey en songhay) et transporté par les caravanes de chameaux sur près de 700 km jusqu’à Tombouctou il y a quelques années encore.
- Pêche : le poisson est pêché et vendu frais ou séché par les Bozo, pêcheurs semi-nomades du fleuve Niger.
Armes de chasse : Arc (avec flèches empoisonnées), sagaie (empoisonnée ou non).
Armes de guerre : Sabre (takuba), sagaie.
Environnement géographique
Les Songhay vivent sur un large territoire, entre l’Afrique Blanche et l’Afrique Noire, délimité à l’ouest par le lac Débo (Mali), à l’est par l’embouchure du Birni n Kebbi (Nigeria) et longeant d’une manière quasiment ininterrompue les deux rives de la grande bouche du fleuve Niger.
- Sable : Tombouctou et l’ensemble des villages environnants sont construits dans le désert de sable (erg).
- Fleuve : jusqu’en 1984, un canal reliait Tombouctou au fleuve Niger mais l’avancée du désert, la négligence des hommes et les conditions économiques ont relégué le fleuve à treize kilomètres de la ville !
Environnement humain : À Tombouctou vivent plusieurs ethnies, dont certaines sont citées dans les récits :
- Arma : descendants des conquérants marocains portant le nom de Touré.
- Bozo : pêcheurs semi-nomades du fleuve Niger.
- Garaasa : “forgerons des Touareg”. Les hommes travaillent le métal, un peu le bois et les femmes le cuir.
- Peul : nomades, semi-nomades ou sédentaires, éleveurs de bovins, de caprins et d’ovins.
- Touareg : guerriers nomades s’étant peu à peu sédentarisés. Vivant autrefois de razzias, ils se tournent aujourd’hui vers l’artisanat et le commerce.
- Zarma : immigrants venus de l’ouest installés au Niger.
Instruments de musique
- Sifflet de chasseur : autrefois, les chasseurs utilisaient des sifflets pour communiquer entre eux.
- Tambour : comme dans la plupart des sociétés africaines, les Songhay utilisaient autrefois des tambours de communication. Aujourd’hui, plusieurs formes de tambours accompagnent musiques et chants (tubal : tambour hémisphérique en bois ou en calebasse à une membrane ; koloo : tambour en argile à une membrane.)
- Vièle (njerka : vièle monocorde en calebasse) et calebasse (gaasu kar-ndi nda korbo - litt. “calebasse frappée avec des bagues”). Ces instruments sont utilisés pour le culte des esprits et les danses de possession hollo-horey.
- Luth (kubur) : luth à trois cordes joué par les griots.
Lieux
- Arabedji, Arrameini, Djokké (villages non situés).
- Diré : village à 120 km par route au sud-ouest de Tombouctou.
- Dokimana : village du Niger.
- Lac Débo : à 200 km au sud-ouest de Tombouctou.
- Sa : village à 190 km au sud-ouest de Tombouctou.
- Say : village à 30 km au sud de Niamey (Niger).
Maladie : Lèpre : cette maladie persiste dans cette région du monde.
Mœurs : Polygamie : selon les préceptes de l’islam, les Songhay pratiquent la polygamie.
Moyens de transport
- Pirogue : embarcation encore couramment utilisée sur le fleuve Niger pour transporter les marchandises et les personnes.
- Cheval : moyen de transport aujourd’hui disparu.
Objets et denrées précieux
- Or.
- Noix de kola : denrée importée des forêts humides (Côte d’Ivoire) et consommée pour ses qualités toniques et stimulantes.
- Tabac : le meilleur tabac est cultivé dans la région de Gourma-Rharous et Bourrem.
Prénoms féminins : Aminata, Assaïta, Binta, Bolo, Diawondo, Djembya, Nagnouma.
Prénoms masculins : Amadou, Bandjougou, Dialadio, Dimba, Kassari, Lamsidi, Mamadou, Mamani, Sirou.
Plantes vivrières et nourritures
- Arachide : consommée fraîche, grillée, en pâte dans les sauces ou sous forme d’huile.
- Baobab : ses feuilles servent à préparer la sauce du to. Ses fruits, appelés pain de singe, fournissent une substance blanche au goût acidulé, ressemblant à la mie de pain ; ils sont consommés comme gourmandise.
- Couscous : préparé avec du blé. Probablement introduit par les Marocains.
- Goyave, noix de palme, orange. Aujourd’hui denrées importées.
- Haricot : nourriture très appréciée.
- Mil : céréale constituant la nourriture de base des régions sahéliennes. Après pilage et meulage, on utilise sa farine pour préparer le to.
- Pain (takula) : pain rond cuit au feu de bois.
Plantes diverses : Acacia tanin, faidherbier, liane, nénuphar.
Sanctions : Fouet, bâton : autrefois, le fouet et la bastonnade étaient des sanctions courantes pour les délits.
Sorcellerie : Marabout, talisman, totem villageois, guérison miraculeuse, gris-gris : bien que musulmans, les Songhay s’adonnent à des pratiques telles sorcellerie, magie, guérison… et portent gris-gris et amulettes.
Valeurs humaines universelles : Loyauté, fidélité, sagesse, humilité : les contes traditionnels ont un rôle pédagogique indéniable. Utilisés pour exalter les valeurs humaines, ils mettent en situation des personnes humaines, des monstres ou des animaux pour édifier le discours.
Contes
Kabani, par Alassane Diahara. Tombouctou
Nous vous offrons ici le texte audio de notre collectage afin que vous puissiez écouter la voix de la narratrice en même temps que vous lirez le texte qui a été traduit au plus prêt de l'original. Un expérience stimulante !
Durée : 07:14. © Patrick Kersalé 1998-2024.
Je vais commencer...
Il s’agit d’un chasseur qui possédait un chien. Ce seul chien eut cent enfants, mais l’homme ne donna aucun de ces enfants à quiconque et personne ne lui en prit non plus. Chaque chien gagnait seul sa part de nourriture en brousse en se transformant en paille puis en revenant à la maison. Ils continuèrent ainsi, ils continuèrent ainsi...
Leur mère se nommait Kabani.
Un jour, le chasseur mourut en laissant un garçon. Celui-ci continua à faire comme son père. Il ne donna ses chiens à personne, il ne les vendit pas, il les garda tous. Il est resté ainsi, il est resté ainsi, il est resté ainsi.
Quand il devint un homme, il partit en brousse avec tous ses chiens et son fusil. Il rencontra le lion et sa lionne, arrêtés. Il tira sur le lion et lionne s’enfuit en disant :
— Tu m’as créé des problèmes, tu as tué mon mari, tu m’as créé des problèmes, tu as tué mon mari. Ô mon Dieu, il a tué mon mari, ô mon Dieu, il a tué mon mari !
La lionne partit avertir tous les animaux de la brousse. Elle leur dit :
— Je vais aller chercher Mamani le chasseur. Que celui qui a une lance la prenne, que celui qui a un coupe-coupe le prenne, que celui qui a un sabre le prenne, que celui qui a un couteau le prenne pour le tuer.
Lorsque les jeunes garçons virent arriver la lionne, ils se réjouirent. Ils lui demandèrent :
— Que viens-tu chercher ?
La lionne répondit :
Je suis seulement venue chercher Mamani le chasseur.
On lui montra la maison de Mamani le chasseur. Celui-ci alla informer sa mère qu'une étrangère était arrivée chez lui.
La mère répondit :
— Hum Mamani, ce n'est pas une personne, l'odeur que je sens n'est pas celle d'une personne !
Mamani rétorqua :
— Maintenant, de toute façon, l’étrangère est venue chez moi.
La mère répondit :
— Que Dieu te protège.
— Je ne mange pas la viande de mouton, je ne mange que la viande de chien.
Au cours la journée, on lui égorgea deux chiens, dans la nuit deux chiens, le matin deux chiens.
La mère de Mamani dit à son fils :
— Quand tu prépares les chiens, mets-moi les os de côté, apporte-les-moi et garde la chair.
Mamani fit ainsi jusqu’à ce qu’il ne restât que la mère des chiens, Kabani.
La mère de Mamani dit :
Ainsi, la mère conserva tous les os qui lui furent apportés. Au moment où Mamani voulut partir, sa mère lui dit :
— N’oublie pas de prendre l’ancien fusil de ton père.
Quand Mamani eut pris le fusil de son père, la lionne lui dit :
— Tu as pris le fusil de ton père, veux-tu me tuer ?
Alors Mamani déposa le fusil. Sa mère lui dit :
— Il faut prendre le sabre.
— Tu as pris le sabre, veux-tu me couper la tête ?
Alors Mamani déposa le sabre. Sa mère lui dit de prendre la lance.
Le chasseur prit la lance. La lionne lui dit :
— Tu as pris la lance, veux-tu me transpercer ?
Alors il déposa la lance et prit le bâton de son père. La lionne dit :
— Tu as pris le bâton, veux-tu m’assommer ?
Sa mère lui dit :
— Prends l’ancien sifflet de ton père et mets-le dans ton pantalon.
Mamani prit alors le sifflet, le mit dans son pantalon et sortit les mains vides.
Il se trouve qu’un crocodile avait caché son enfant dans le champ du père de Mamani. En effet, si la femelle d’un crocodile a un enfant et que celui-ci est un mâle, elle ne le laisse pas parmi les mâles sinon il serait tué. Quand il est venu cacher son enfant, Mamani l’avait vu faire. Comme le crocodile voulait fuir, Mamani lui avait dit :
Mamani et la lionne partirent, partirent, partirent ensemble jusque dans le champ du père de Mamani et la lionne posa cette question au chasseur :
— Reconnais-tu cet endroit ?
Le chasseur répondit :
— C’est le champ de mon père. C’est ici que j’ai rencontré un lion avec sa femme, que j’ai tué le mâle et que la femelle a fui.
À ce moment-là, Mamani dit :
Pendant ce temps, la lionne partit avertir tous les animaux de la brousse, pour leur dire qu’elle avait amené le chasseur qui avait tué son mari. Quand le chasseur apprit cela, il monta sur un arbre et, d’un côté, vit de la poussière. Arrivés près de l’arbre, les animaux de la brousse commencèrent à le couper, le couper, le couper... jusqu’à ce qu’il soit prêt à tomber. Arriva alors le crocodile. Il dit à Mamani :
— As-tu un sifflet ?
Mamani répondit :
— Oui, j’ai un sifflet.
Le crocodile dit :
— Si tu as un sifflet, siffle.
— Chiens de mon père, si vous ne venez pas à mon secours, ils vont me manger, chiens de ma mère, si vous ne venez pas à mon secours, ils vont me manger, chiens des longues nuits, si vous ne venez pas à mon secours, ils vont me manger !
Pendant ce temps, la mère du chasseur était assise chez elle. Les os des chiens étaient près d’elle. Chaque fois que Mamani sifflait pour demander du secours, sa mère prenait un os, versait de l’eau chaude dessus et l’os se transformait aussitôt en chien. Tous les os se transformèrent ainsi en chiens. Il y en avait trois cent trois. Kabani divisa les chiens en six groupes et les envoya dans six directions. Il se trouve qu’à ce même moment, les animaux de la brousse se préparaient et que le crocodile était là. L’arbre était prêt à tomber. Alors, le crocodile prit sa hache, frappa l’arbre et celui-ci redevint normal.
Le crocodile dit :
— Je viens de payer le bien de ton père aujourd’hui.
Il y avait de la poussière partout. Les animaux venaient de tous côtés. Tout à coup, Mamani sauta sur le cou du crocodile et celui-ci le prit sur ses épaules. Rien se sortit de la brousse, que les chiens n’aient pas piétiné, pas même les petits insectes.
Les chiens vinrent trouver Mamani et lui dirent :
Mamani dit :
— Si Dieu le veut, je ne donnerai jamais un de mes chiens à quiconque. Si quelqu’un vient me demander un chien, je ne le donnerai pas, je ne donnerai pas les trois cent trois chiens qui sont avec moi. Rien ne rentrera, rien ne sortira.
C’est fini.
Le gros oiseau, par Alassane Diahara. Tombouctou
Nous vous offrons ici le texte audio de notre collectage afin que vous puissiez écouter la voix de la narratrice en même temps que vous lirez le texte qui a été traduit au plus prêt de l'original. Un expérience stimulante !
Durée : 04:12. © Patrick Kersalé 1998-2024.
Il était une fois, un très très très très très gros oiseau, si gros qu’il ne pouvait voler. Les chasseurs et tous les animaux sauvages de la brousse avaient essayé de l’attraper, mais ils n’avaient pas réussi. Le lion le chassa, la panthère le chassa, l’éléphant le chassa, même les chasseurs le chassèrent.
La nuit venue, quand tout était calme, l’oiseau s’en allait au fleuve pour boire et manger et revenait se coucher.
Les animaux de la brousse étaient tellement fatigués, fatigués, fatigués, qu’ils décidèrent de trouver une solution. Alors, ils allèrent trouver le scorpion. Celui-ci leur dit :
— Comme je suis le plus petit et le plus faible d’entre vous, vous allez me suivre, j’irai piquer l’oiseau et il tombera.
Les animaux lui répondirent :
— Bismilla !
La panthère vint, le serpent vint, le scorpion lui-même vint, le lion vint. Ils s’approchèrent de l’oiseau. Celui-ci leur dit :
— Eh scorpion, ne monte pas ici, je te vois ! Il ne faut pas monter, je te vois !
Alors le scorpion dit :
— Si tu me vois vraiment, je suis avec qui et qui ?
L’oiseau répondit :
— La panthère est là, derrière cet arbre, le serpent est là, sur cette colline, toi tu es là en train de monter sur l’arbre pour venir chez moi et lion est là, derrière la termitière.
Alors le lion dit :
— Hum tu nous as vu, hum tu nous as vu, hum tu nous as vu, hum tu nous as vu...
Alors, tout à coup, la panthère gifla le lion, « pouk » et dit :
— Ne t’avais-je pas dit de te taire ?
Le lion répondit :
— Bon, je ne parle plus.
Pendant ce temps, le scorpion monta sur l’arbre, s’avança vers l’oiseau, le piqua et ce dernier tomba, « pak ».
Tous les animaux se regroupèrent pour attraper l’oiseau et le mirent dans un sac. Le lion dit :
— Allez chercher du bois, nous allons faire un feu pour le griller ; pendant ce temps, je vais rester près de lui.
Tandis que les animaux étaient partis chercher du bois, le lion dit à l’oiseau :
— Eh l’oiseau, tu as une très belle voix !
L’oiseau répondit :
— Eh lion, comment pourrais-je avoir une belle voix ? J’ai les pattes cassées, j’ai les ailes cassées !
Le lion répondit :
— Eh l’oiseau, si j’entrouvre le sac, ne vas-tu pas t’enfuir ?
L’oiseau répondit :
— Non !
Le lion dit :
— Eh la cigogne, je te vois ! Le scorpion est en train de venir chez toi, la panthère est de l’autre côté, le serpent est sur la colline, le lion est derrière cette chose-là !
Puis il continua :
— Est-ce que tu me vois ?
L’oiseau répondit :
— Je te vois, je te vois, je te vois. Où vais-je aller ? Fais-moi sortir.
Le lion fit sortir l’oiseau du sac et lui demanda de chanter. Alors l’oiseau commença à chanter, à chanter, à chanter, à chanter :
Le lion je te vois
Le lion est par derrière il est en train de venir
Le lion est par derrière il est en train de venir.
Avant que le lion n’arrive, l’oiseau fit « tchusss » et partit. Le lion dit alors :
— Eh aujourd’hui, c’est aujourd’hui que j’ai chaud !
Alors le lion remplit le sac d’excréments et en attacha l’ouverture. Quand les autres animaux furent de retour, ils dirent :
— Ah le lion, aujourd’hui tu as fait quelque chose de bien dans ta vie, tu n’avais jamais rien fait de bien dans ta vie !
Celui-ci répondit ;
— Vous pouvez toucher le sac mais pas l’ouvrir, vous pouvez toucher le sac mais pas l’ouvrir... Depuis que vous êtes partis, je n’ai cessé de lutter avec l’oiseau. Maintenant il faut allumer le feu.
Ils allumèrent le feu et mirent le sac dedans. Alors le sac cuit, cuit, cuit, puis explosa « poum » et frappa la panthère. Le lion prit la fuite, poursuivi par la panthère. La panthère frappa le dos du lion.
« Voilà pourquoi le lion a les hanches cassées. »
C’est fini. Quand même, l’oiseau est parti.
Deux hommes loyaux, par Barry Hamidou. Gabero (près de Tombouctou)
Il était une époque, où, dans les contrées de l’Afrique profonde, de farouches guerriers se battaient seulement par instinct. Ils guerroyaient à la sagaie sur des chevaux fougueux et aguerris. Je m’en vais vous conter les faits d’armes de l’une des plus redoutables de ces troupes, à une époque où les hommes s’entretuaient, se capturaient et où il n’y avait pas de place pour les faibles.
Un jour, alors qu’ils cherchaient à commettre quelques méfaits, nos guerriers ne trouvèrent sur leur chemin, ni adversaire à combattre, ni village à piller, ni femme, ni enfant à capturer. Ils ressentirent alors un vide angoissant car ils ne savaient faire qu’une seule chose, se battre.
Soudain, tandis qu’ils cheminaient, ils aperçurent un point d’eau. Ils s’y dirigèrent pour se désaltérer et abreuver leur monture. Ils y rencontrèrent une jeune femme d’une beauté sauvage qui puisait de l’eau. Ils restèrent perplexes. Elle était la femme du maître des lieux, le redoutable seigneur Balla.
Le soleil achevait sa course à l’horizon, commençant à jeter sur les arbres sa traînée jaune d’or, quand les guerriers s’emparèrent de la jeune femme. Ils dressèrent le camp pour la nuit et installèrent la tente de la captive au beau milieu de la place. Au petit jour, ils repartirent avec leur prisonnière et, à l’embranchement de deux chemins, décidèrent de la libérer. Un sentier menait au camp royal de son mari et l’autre, au camp de nos guerriers. Le chef de la troupe, qui avait la jeune femme à califourchon derrière lui, lui fit mettre pied à terre. Nos hommes se remirent en chemin et la jeune femme rentra à son village.
Durant toute la course à cheval, les seins de la jeune femme s’étaient écrasés contre les épaules du guerrier, ce qui l’avait fait frissonner de bonheur. Mais, en arrivant dans son village, notre chef de guerre se sentit de plus en plus mal car il venait de commettre l’irréparable : les gris-gris qui lui servaient de protection n’aurait jamais dû être contact avec le corps d’une femme.
Deux années s’écoulèrent et le guerrier allait de mal en pis. Tous les soins prodigués restaient inefficaces. Un jour, on fit appel à la grande devineresse du village. Elle vint et fit parler les fétiches. Elle rappela alors avec exactitude au guerrier, tous les détails qui avait conduit cette jeune femme à entrer en contact avec ses gris-gris. Comme remède, elle lui conseilla de se rendre seul auprès de la jeune femme et de coucher avec elle.
Le jeune homme, avec l’aide des siens, enfourcha son cheval et partit à sa rencontre au village. Il arriva devant une case, salua par trois fois un homme d’âge respectable qui lui répondit et l’aida à mettre pied à terre. Il ne tarda pas à raconter à son hôte sa mésaventure et la raison de sa visite. La jeune femme se trouvait être son épouse. Cet homme d’une grande sagesse le comprit et lui dit que pour le sauver, il acceptait qu’il couche avec sa propre femme, mais ne lui cacha pas la délicatesse de la tâche. Il lui conseilla ceci :
— Demain, tu partiras en forêt pour la journée. Lorsque le soleil jettera sur nous ses rayons d’or, tu reviendras dans ce village. À l’approche de la case, ton cheval hennira trois fois, mais tu n’en descendras pas seul. Deux captifs viendront à ta rencontre pour t’aider à mettre pied à terre. L’un s’occupera de ta monture et le second apportera deux nattes, l’une rouge et l’autre noire. Il les couvrira et placera sur chacune d’elle un oreiller. Tu t’assiéras alors sur la natte noire. Ma femme sortira avec deux calebasses, l’une de lait frais et l’autre d’eau. Tu commenceras par le lait, dont tu prendras trois gorgées ; de l’eau, tu prendras quatre gorgées. Tu ne dois pas te tromper, car tous tes gestes seront suivis par ma femme qui restera agenouillée devant toi. Elle ne doit pas se douter qu’elle n’est pas en face de son mari. Ensuite, elle t’apportera le repas dont tu n’extrairas pas plus de trois bouchées.
Elle remportera les ustensiles dans la case et se couchera. Tu la suivras dans sa chambre et tu enlèveras seulement ton boubou. Tu te coucheras sur le dos auprès d’elle sans la toucher. Lorsqu’elle aura envie de toi, elle commencera à te caresser et se couchera sur ton corps. Alors, si elle t’arrache ton pantalon et seulement à cette condition, tu pourras lui faire l’amour.
Notre guerrier suivit à la lettre les conseils donnés par l’homme. Lorsque la femme posa ses mains sur lui, il sentit son corps frissonner et le mal le quitter. Il retrouva bientôt toutes ses forces et décida de ne pas lui faire l’amour. Au premier chant du coq, il enfourcha son cheval, alla trouver le mari, le remercia infiniment et lui assura qu’il avait pu partager l’intimité de sa femme, ajoutant même qu’il avait affaissé le lit en bambou. Puis il repartit vers son village et fit l’amour à sa propre femme. Le vieil homme, à son tour, en fit autant avec la sienne.
Les deux femmes tombèrent enceintes et donnèrent naissance à de magnifiques bébés. Le jeune guerrier envoya dire à son bienheureux guérisseur que sa femme accouchait. Le vieil homme, quant à lui, vint trouver le jeune homme pour lui parler d’un problème crucial. Il lui dit ceci :
— J’ai un problème très sérieux qui ne peut se résoudre qu’avec le sacrifice d’un nouveau-né.
Le jeune homme acquiesça et lui répondit qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour l’aider. Après avoir consulté sa femme, il offrit son enfant à son sauveur de jadis. Celui-ci se rendit alors en forêt où il abattit un lièvre. De son sang, il macula un morceau de laine blanche qu’il vint montrer aux parents de sa présumée victime. Puis il ramena sain et sauf l’enfant à sa propre femme qui l’éleva en même temps que le sien, de son lait et avec son amour.
Lorsqu’ils atteignirent l’âge de devenir à leur tour des guerriers, le vieil homme enseigna aux enfants à se battre, à chasser, à devenir de véritables hommes et à le remplacer en toutes circonstances.
Les années s’écoulèrent.
Les deux garçons eurent l’âge de fonder un foyer. Lorsqu’ils en exprimèrent le souhait, le vieil homme décida que le temps était venu de révéler au second garçon, comment il était arrivé sous son toit car, pour lui donner une femme, il fallait en informer ses véritables parents. Il les fit venir, accompagnés par leur captive de case. On fit battre le grand tambour et tous ceux de la contrée vinrent. Au milieu de la foule, enturbannés et parés autant que leur monture, de blanc, d’argent et d’or, les deux garçons attendaient. Le vieil homme interpella la captive de case et lui demanda de désigner parmi ces deux garçons, celui qu’elle avait jadis dorloté et entouré de ses soins. Elle ne put empêcher sa colère d’épouser son indignation, se sentant choquée par la question. Elle répondit :
— Vous l’avez sacrifié pour vos besoins et vous daignez me poser une telle question !
Ce fut alors le tour de la mère du garçon de passer à l’épreuve. Elle assura pouvoir reconnaître son enfant, car il portait une tâche héréditaire sous l’aisselle gauche, son père ayant lui-même eu cette cicatrice à la suite d’une blessure au combat. Elle se dirigea vers les deux garçons et reconnut le sien. Elle en fut stupéfaite. Des acclamations fusèrent de partout. Son père, lui aussi, fit éclater sa joie au grand jour puis renvoya la surprise dans le camp de son guérisseur de jadis. Il lui révéla, tout en faisant témoigner la femme de ce dernier, qu’il n’avait jamais couché avec elle.
La foule entonna alors l’hymne à la loyauté et l’on se demanda lequel de ces deux hommes était le plus loyal.
Dialadio le prodigue, par Barry Hamidou. Gabero (près de Tombouctou)
Jadis, au pays des prodigues, Dialadio était tellement célèbre et généreux, que tous les griots du pays se rendaient tour à tour chez lui, pour lui jouer les morceaux traditionnels et déclamer les éloges dus à son rang. Dialadio avait toujours veillé à satisfaire ses visiteurs. Il avait fait don de toute sa richesse aux griots qui ne vivaient que des faveurs des nobles gens du pays.
Un jour, alors que le soleil montait hors de sa tanière et que Dialadio parlait avec sa femme, il vit deux griots d’un âge respectable accompagnés de leur petit, se dirigeant vers sa cour. Il comprit qu’une fois encore, il devrait satisfaire ces étrangers venus de loin. Il se précipita alors chez lui afin de masquer son visage et trouver avec sa femme un subterfuge pour satisfaire ces griots insatiables. La femme ressortit et s’adressa aux visiteurs :
— Chers étrangers, mon mari est parti en voyage, mais il a néanmoins laissé un de ses meilleurs captifs à l’attention des griots qui viendraient. Comme vous êtes les premiers de ce jour, si vous décidez de repartir et si vous le désirez bien sûr, je me ferai un devoir de vous le livrer.
Pendant ce temps-là, Dialadio se faisait enduire de beurre de vache et de cendre de bois de cuisine pour dissimuler tous les traits qui auraient pu le trahir.
Les griots décidèrent de retourner chez eux. La femme de Dialadio fit ligoter le prétendu captif et le remit à ses étrangers qui prirent le chemin du retour. Ils placèrent leur butin avec le petit griot sur le même cheval. Chaque fois que le vent soufflait et que les cendres démasquaient son visage, Dialadio dérobait ses traits pour éviter les soupçons, mais c’était sans compter avec la vigilance du jeune griot qui, par deux fois, attira l’attention de ses pères sur le caractère douteux de l’identité de leur butin :
— Pères, il ne ressemble point à un captif, il a les paupières qui luisent au soleil !
Les vieux griots ne se doutant de rien, écoutèrent le jeune et continuèrent leur voyage. Peu à peu, le soleil lança tout droit sur leur tête ses rayons de braise et d’éblouissante lumière. Ils firent halte auprès d’un grand arbre. Ils descendirent le captif à demi ligoté et le jeune griot emmena les chevaux s’abreuver. Tout à coup, au bord du rivage, le jeune homme sentit l’arrivée d’un détachement de cavaliers qui avançaient comme des guerriers effarouchés. Leurs coursiers fougueux martelaient le sol de leurs sabots et hennissaient sourdement. Le jeune griot vint, essoufflé, prévenir ses pères de cette visite inopinée et leur conseilla de se rendre, de leur proposer leurs services et leur entière disponibilité, car nul ne peut résister aux paroles du griot, maître dans l’art de manier le verbe. À peine eut-il terminé, qu’un nuage de poussière les enveloppa. Ils se retrouvèrent face à face avec des centaines de museaux soufflant à chaude haleine.
— Que la paix soit avec vous, braves guerriers, articulèrent les griots. Nous sommes des griots. Nous sommes à vous, nobles gens, nous vous servirons et serons à vos services et ordres !
Lorsque ces mots furent lâchés, Dialadio se délia et devant la hargne de ces centaines de guerriers, enfourcha un coursier fougueux et se mit en retrait avant de crier :
— C’est moi Dialadio et je ne serai jamais un butin de guerre, je ne serai le captif que de celui qui, m’ayant vaincu, m’emmènera tel un captif !
Soudain, dans la plaine, il y eut plus de jets de sagaies et de tirs de flèches que de bruits de sabots. De son épée, Dialadio ravageait ses adversaires par rangées entières et disparaissait chaque fois qu’il se sentait cerné. Lorsque les guerriers sentirent venir leur défaite, Dialadio leur avait déjà coupé la retraite. Il ordonna aux griots de rassembler les montures, les armes et les guerriers capturés vivants. Ensemble ils mirent le cap sur le village de Dialadio.
Dialadio, célèbre, grand guerrier, maître de la victoire, fit battre les tambours. On fit appel à tous les griots du pays. Le moment était venu pour lui de défier ceux qui l’avaient tant sollicité, mais dont aucun n’avait composé un morceau, un éloge en son nom propre et en lui seul.
— Existe-t-il dans ce pays un noble plus généreux que moi ?
— Non ! répondirent les griots.
Il ajouta ceci :
— N’ai-je pas droit à un éloge personnel de votre part ?
— Si ! répondirent-ils en chœur.
Alors, ne suis-je pas un héros méritant ?
— Si ! enfin à l’unanimité.
Dialadio répliqua :
— Je vous accorde un délai de sept jours. Allez-vous-en aux quatre coins du monde chercher un éloge que vous chanterez pour moi seul et qui me plaira. Sinon, le huitième jour, je vous ferai tous égorger où que vous vous trouviez, car je possède ce pouvoir !
Les griots s’évanouirent dans la nature à la recherche d’une chanson pour Dialadio. Au septième jour, ils rentrèrent les uns après les autres, nonchalants et bredouilles. Dans la cour de Dialadio, les arrivants étaient ligotés par les captifs au fur et à mesure qu’ils déclinaient leur mésaventure.
Le vieux chef des griots se traînait jusqu’à l’entrée du village, quand il croisa un de ses informateurs. Celui-ci ne tarda guère à lui annoncer comment les choses évoluaient dans le village et précisément dans la cour de Dialadio. Il décida alors de partir loin d’ici, loin de l’humiliation. Il partit vers l’ouest, afin de s’éloigner le plus possible.
Lorsque le soleil finit sa course derrière la cime des arbres, alors qu’il jetait sur la forêt sa lueur jaunâtre, le vieux griot s’arrêta au bord d’une rivière. Mystérieuse était cette nature et les eaux qui y coulaient. Deux grands arbres dressés sur les deux rives croisaient leurs branchages au-dessus de ces eaux calmes et abondantes. Le piroguier de la traversée ramait doucement et sa pirogue glissait sur les eaux. Le vieux griot se tenait dans cet esquif. À la cime des branchages qui se croisaient au-dessus des eaux, une tourterelle chantait d’un ton langoureux une chanson mélodieuse, l’hymne le plus beau jamais chanté par la bouche ni par le monocorde d’un griot. Il pouvait plaire à l’oreille de tout mortel. Le vieux griot sursauta et s’empara de son instrument. Il accompagna les airs de l’oiseau de bonheur et ne tarda pas à s’ériger en maître du son et du rythme, jouant avec zèle sur son instrument.
Le vieux griot venait de faire une trouvaille hors du commun et demanda au piroguier de rebrousser chemin. Il traîna le poids de ses années jusqu’à la cour de Dialadio qui avait mis ses captifs à ses flancs. Le griot lui annonçait déjà qu’il était revenu avec quelque chose dans son sac. Mû par l’impatience, Dialadio lui lança :
— Alors dévoile ta trouvaille, j’ai hâte de connaître ta mésaventure, comme tous les tiens !
Sagement, le vieux griot ébranla la certitude de Dialadio :
— Je proclamerai tes éloges, je jouerai pour toi ce que nulle oreille n’a savouré auparavant, je chanterai pour toi, Dialadio, les airs du diable, le rythme du mystère, le son du bonheur, mais avant, tu dois organiser une cérémonie grandiose. Tu feras venir les plus belles demoiselles de chez nous, tu ramèneras de la forêt un roi de la brousse, un lion. Tu le feras dépouiller et je m’assiérai sur sa peau. Tu délieras tous mes griots que tu devais exécuter au retour de mes aventures prophétiques, car on n’attendait que moi pour la cérémonie macabre. Je la transformerai en inoubliable cérémonie de fête et de fierté, une cérémonie par laquelle le griot vengera son honneur !
Ainsi dit, ainsi fut fait.
Assis sur sa peau de lion et entouré de tous les griots qui étaient ligotés en attendant leur chef pour mourir, il fit sortir des notes d’une grande pureté de son instrument fétiche, tandis que les autres entonnaient les refrains. Petit à petit, Dialadio dodelinant de la tête faisait mine de savourer. Mais bientôt ses poils se dressèrent dans leurs pores, ses yeux scintillèrent comme du cristal et ses lèvres se mirent à trembler. Le vieux griot faisait parler son instrument de plus belle et notre héros fut désarmé, vaincu par la magie du son et le mystère du verbe. Dialadio, comblé, s’assit et baissa la tête. Le vieux griot vainqueur lui cria :
— Tu es le généreux qui ne regrette pas ses dons, tu es l’or dont l’éclat ne ternit point, tu es l’obscurité qui voile le malheur des hommes !
À l'origine de la circoncision, par Cissé Ali - Tombouctou
Dieu créa Adama et Hawa[1] et décida de leur permettre de se multiplier. Ainsi donnèrent-ils naissance à plusieurs enfants, dont deux garçons jumeaux.
Un jour, les deux jumeaux décidèrent d’aller se promener non loin du village mais, quand le soleil atteignit le zénith, ils s’égarèrent. Après avoir longuement tourné en rond, l’un des jumeaux épuisé, tomba sous un gros baobab, agonisant de soif et de faim. Le voyant dans cet état comateux, son frère appela au secours. Alors, le vieux crocodile, appelé Wanzama, l’entendit et lui fit signe. Le jeune garçon se dirigea vers le fleuve où il le trouva. Il lui narra son aventure. Le vieux crocodile lui dit :
— Je peux sauver ton frère à condition que, toi-même, tu sauves ma femelle bloquée au fond des eaux du fleuve. Elle a dans le ventre, la pierre magique du génie qui me rendra le plus puissant sur la terre. Tant que ma femelle ne vomira pas cette pierre magique, elle restera prisonnière du génie au fond des eaux.
Le jeune garçon promit à Wanzama de faire vomir la pierre magique à sa femelle. Il alla cueillir une herbe sauvage puis monta sur le dos du crocodile. Ils descendirent ensemble au fond des eaux et dès que la femelle avala l’herbe, elle vomit la pierre magique et le génie perdit tout pouvoir. Alors, celui-ci pria Dieu de le rendre invisible devant les hommes, de crainte d’une vengeance de leur part.
À son tour, le vieux crocodile aida le garçon à sauver son jeune frère et promit de lui donner certains pouvoirs au fond des eaux. Pour ne pas confondre les jumeaux, il lui arracha une partie de la peau flottante de son sexe.
Lorsque les jumeaux arrivèrent au village, on constata qu’ils n’avaient pas le même sexe et que l’un des deux avait des pouvoirs au fond des eaux. Alors, les parents souhaitèrent couper la partie molle du sexe du second jumeau. Le frère circoncis courut avertir le vieux crocodile qui se déguisa en vieil homme et entra au village. Il dit aux villageois :
— On ne peut donner un pouvoir à quiconque sans vérifier sa bravoure.
Pour cela, le second jumeau dut subir de rudes épreuves durant une semaine. Puis, comme il les avait endurées avec courage, on le circoncit.
Les villageois demandèrent le nom du vieil homme qui répondit s’appeler Wanzama.
Depuis lors, on circoncit chaque année tous les enfants d’un certain âge en présence d’un vieil homme appelé wanzama, ayant reçu des pouvoirs auprès du vieux crocodile, d’où l’origine des wanzaman[2] au Sahel. Ces hommes ne mangent pas la chair du crocodile mais utilisent ses dents pour rendre plus tranchants leurs instruments de circoncision.
Ainsi naquit et se généralisa au Sahel, la pratique de circoncision.
__________________
[1] Adam et Ève.
[2] Chez les Songhay, le circonciseur est nommé wanjam. Chez les Zarma, wanzam.
dugu-wey-dugu : (dugu : encens, wey : femme). Cette appellation titre son origine du fait que les femmes utilisent de l'encens lors des baptêmes, des circoncisions et des mariages au cours desquels cette forme de chant est interprétée. La veille de la circoncision, la mère du futur circoncis fait une boule de tissus qu'elle place sous ses vêtements pour simuler qu'elle est enceinte, puis elle chante et danse. Dugu-wey-dugu est généralement chanté par les Hosso (caste de griots d'hommes et de femmes assistant traditionnellement à la défloration des filles et à la circoncision des garçons). Ils sont notamment réputés pour leur vulgarité comportementale. Il arrive cependant que dans certaines circonstances d'autres personnes que les hosso interprètent cette forme de chant pour amuser le public. Ici, la partie soliste de cette pièce est chantée par un enfant.
Durée : 02:36. © Patrick Kersalé 1998-2024.
Le lion, la panthère et l’hyène, par Barry Hamidou. Gabero (près de Tombouctou)
Un jour, le lion, la panthère et l’hyène lancèrent le défi d’accomplir chacun un acte de bravoure. Les trois compères se traînèrent jusqu’aux alentours d’un campement touareg et attendirent la tombée de la nuit. Le lion s’introduisit alors dans le plus grand enclos du campement et en ressortit avec le taureau le plus puissant et le plus beau, sans que ni les chiens ni leurs maîtres ne s’aperçussent de quoi que ce soit. Il emporta sa proie jusqu’à la tanière commune, suspendue à ses redoutables mâchoires et soutenue par sa puissante nuque.
La panthère à la robe dorée se glissa dans le hameau, erra parmi les ombres et s’approcha du bouc le plus fougueux et le plus criard. Elle s’en empara sans qu’il pût ni lancer le moindre cri, ni alerter les autres.
Ce fut alors le tour de l’hyène aux couleurs ternes, à la démarche boitillante et à la senteur inquiétante. Elle se précipita sous une tente, attrapa une jeune fillette et la traîna sur le sol jusqu’à sa tanière.
Au lever du soleil, le campement touareg se réveilla en effervescence et constata avec effroi les dégâts commis pendant la nuit. Le chef, furieux et désemparé par la mort de sa fillette chérie, fit battre le grand tambour. Il rassembla ses guerriers les plus fougueux et les envoya à la recherche des fauves. Trois cents jeunes à cheval, armés jusqu’aux dents, se ruèrent sur les traces de la maudite hyène qui ne peut jamais fuir avec une proie sans laisser d’empreintes. Ils crièrent bientôt halte devant la tanière où s’étaient réfugiées les bêtes. Afin d’obliger les fugitifs à en sortir, les Touareg placèrent des souches d’arbres et des branchages secs à l’entrée, y mirent le feu et attendirent que la chaleur atteigne le fond du trou.
Au fond de leur refuge, les trois héros cherchaient un moyen d’échapper à la fougue des guerriers. Le lion, le roi, étira le premier ses membres puissants, secoua sa crinière et, d’un bond, fit un va-et-vient dans le fond du trou. Il fixa sa femelle et lui demanda :
— Comment sont mes yeux ?
Elle lui répondit :
— Ils sont aussi rouges que le sang de tes proies.
Cette réponse ne lui convenant pas, il fit un autre bon et renouvela la question à sa femme :
— Comment sont mes yeux ?
Celle-ci lui répondit :
— Tes yeux, par leur éclat et leur rougeur, ternissent l’éclat des flammes.
Alors, le lion rugit et, accompagné de sa lionne, surgit du trou. Sur leur passage, cent cavaliers traînèrent leur propre cadavre dans la poussière.
Mais l’étau se resserra de nouveau à l’entrée de la tanière. La panthère, souple et redoutable, s’étira avec force et se redressa. Se tournant vers sa femelle, elle lui demanda :
— Comment sont mes yeux ?
Sa femme lui répondit :
— Plus rouges que le soleil à la fin de sa course.
D’un bond, la panthère surgit à l’extérieur de la tanière, accompagnée de sa femelle. Cent cavaliers perdirent la peau de leur visage, gisant dans le sang. Les deux compères échappèrent à leurs poursuivants.
L’hyène, qui ne supportait plus très bien la chaleur, se mit à courir dans le trou et se présenta devant sa femelle. Celle-ci lui dit :
— Tes yeux ont un peu changé de couleur.
L’hyène hurla, se mordit la queue et sa femelle continua :
— Tes yeux sont maintenant plus blancs qu’ils ne l’ont jamais été. Alors, nous périrons tous.
À peine le couple surgit-il à l’extérieur de la tanière, que les sagaies des Touareg les transformèrent en de minuscules lambeaux de chair.
Dimba, le marabout et le monstre, par Cissé Ali. Tombouctou
Il était une fois, un marabout qui avait de nombreux élèves. Parmi eux, se trouvaient ses propres fils. L’un d’eux s’appelait Dimba. Il l’aimait beaucoup et lui épargnait les corvées quotidiennes et les punitions qui étaient monnaie courante. Un jour, le maître s’absenta. Ses élèves, dont Dimba, s’en allèrent cueillir des fruits sauvages dans la forêt quand, tout à coup, un monstre surgit des touffes sombres des arbres, leur barrant le passage. Il interrogea les enfants pour savoir qui était Dimba. Tous ayant une rancœur contre la progéniture chérie du maître, le désignèrent du doigt. Commença alors une course effrénée.
Le marabout, dans son occupation, eut un frisson qui lui traversa tout le corps. Il rebroussa alors chemin, sentant que Dimba était en danger et se précipita à sa rencontre.
Dimba avait été confié à ce marabout par sa mère décédée à la suite des frayeurs occasionnées par ce maudit monstre qui voulait enlever son enfant pour on ne sait quelle raison. Tous les élèves coururent après l’enfant afin de le livrer au monstre qui le pourchassait inexorablement. Bientôt, Dimba put se réfugier dans les bras de son maître et père adoptif, et tous les élèves restèrent là, interdits. Alors, le monstre gronda, fit trembler ciel et terre, tourbillonner le vent qui arracha les branchages.
Le marabout lui offrit un élève. Le monstre l’avala, hurla de plus belle et répéta sans cesse :
— Tout ce que je pourrai avaler ne me satisfera jamais autant que Dimba.
Le marabout répliqua :
— Sa mère me l’a confié en mourant et je ne peux te le donner.
Alors le monstre s’exclama :
— La maudite a trahi notre serment, elle n’a pas payé, alors son fils paiera à sa place.
Le marabout répondit :
— Épargnons les innocents et oublions nos vieilles rancunes, car elles pourraient nous détruire.
À chaque fois que le monstre se déchaînait, le marabout mettait Dimba à l’abri et lui envoyait un élève dans l’espoir de le sauver. Mais lorsque le maître se prépara à se livrer lui-même, Dimba, indigné, courut vers le monstre qui n’en fit qu’une bouchée. C’est alors que l’enfant chéri sortit son coutelas et se mit à lui taillader l’estomac. Le monstre vomit alors toutes ses proies et, avec elles Dimba, qui, en sortant, lui trancha la gorge.
Guirzile le crocodile, par Cissé Ali. Tombouctou
Dokimana était un village de pêcheurs du Niger réputé pour ses belles filles. Tous les villages environnants y venaient prendre femme. Au moment du retour vers leur village, les jeunes mariés devaient emprunter la voie fluviale, car il existait à l’époque une grande forêt peuplée d’animaux sauvages et de serpents, aussi le fleuve semblait être la voie la plus sûre.
Cependant, vivait dans ce fleuve un vieux crocodile appelé Guirzile qui attaquait les convois uniquement pour capturer les jeunes femmes mariées, n’ayant d’appétit que pour elles. Guirzile avait fait de tels de ravages que finalement plus personne ne vint se marier à Dokimana et les jeunes filles qui devenaient trop nombreuses, commencèrent à vieillir sans être mariées. Devant cette situation, le chef du village lança un appel à tous les pêcheurs de la contrée : « Quiconque tuera Guirzile aura une forte récompense. »
Ainsi les pêcheurs tentèrent de le tuer, mais aucun n’y parvint.
C’est alors que Dindamo décida de s’en charger lui-même. Il annonça aux villageois que dans quarante jours, on n’entendrait plus parler de Guirzile.
Au quarantième jour, il emporta ses sagaies et ses harpons chez le vieux forgeron du village pour les faire affûter. Pendant ce temps, le crocodile ayant appris les intentions de Dindamo, décida d’acérer lui aussi ses dents. Il les enleva une à une pour en faire des flèches et se rendit chez le vieux forgeron après s’être transformé en vieux chasseur. Quand il arriva chez lui, il trouva Dindamo assis dans la forge, attendant ses armes. À peine s’était-il assis que Guirzile demanda au forgeron :
— À quoi servent toutes ces armes ? À qui appartiennent-elles ?
Aussitôt Dindamo lui répondit :
— Elles sont à moi, je les prépare pour affronter Guirzile.
Alors l’avatar du crocodile demanda :
— Comment comptes-tu tuer ce phénomène de Guirzile, alors que plusieurs pêcheurs ont déjà essayé sans succès.
Dindamo répondit :
— J’ai beaucoup voyagé dans les pays gourma, haoussa, dendi et songhay. J’y ai obtenu une infaillible recette.
— Quelle est donc cette recette ? demanda Guirzile.
— Pour tuer Guirzile, je dois me transformer sept fois.
— Et quelles sont ces sept fois ?
— Tout d’abord je l’attaque comme pêcheur. S’il m’attrape, je me transforme en herbe. S’il attaque l’herbe, je me transforme en poisson. S’il attaque le poisson, je me transforme en pierre. S’il attaque la pierre, je me transforme en pirogue. S’il attaque la pirogue, je me transforme en bois mort. S’il attaque le bois mort, je me transforme en serpent d’eau. S’il attaque le serpent d’eau, je me transforme en ai…
À peine eut-il dit « ai… » que le vieux forgeron le frappa et le fit taire.
— On ne raconte pas tout son secret à un étranger ! lui rétorqua-t-il.
Ainsi la causerie s’acheva-t-elle brusquement. Dindamo prit ses armes et partit vers le fleuve. Aussitôt Guirzile ramassa lui aussi ses flèches et en fit autant.
La bataille commença sur le fleuve et continua au fond des eaux. Elle dura des heures. Guirzile dut affronter toutes les transformations énumérées chez le vieux forgeron. À la dernière attaque, le crocodile chercha à comprendre la suite du mot ai…, mais ne trouva pas. La nuit tomba. Dindamo rentra chez lui pour attendre le lendemain, car ses féticheurs lui avaient dit de n’attaquer Guirzile que de jour. Pendant la nuit, le crocodile se transforma en personne humaine et alla trouver le vieux forgeron. Il le menaça pour lui soutirer la suite du mot ai…, mais il refusa et Guirzile le tua.
De bon matin, les hommes étaient réunis chez le chef du village pour les salutations d’usage et pour discuter des affaires locales. Avant que chacun n’aille vaquer à ses occupations, Guirzile, déguisé en vieux sage, vint s’asseoir dans l’assistance. Le chef du village questionna Dindamo sur la situation. Ce dernier répondit qu’il lui restait à effectuer une seule transformation avant de tuer Guirzile. Cependant, personne ne devait savoir de quoi il s’agissait car le vieux forgeron qui l’avait conseillé était mort et lui, Dindamo, était sûr que Guirzile, à la recherche du dernier mot, était l’auteur de ce crime.
Tout le monde prit la parole pour donner son point de vue, sauf le vieux sage, nouvel avatar du crocodile. Quand le chef du village lui demanda son avis, il répondit :
— Chef, ce Guirzile ne doit pas mourir car, s’il trépasse, trois vies placées sous la même étoile suivront la sienne. Je m’explique. Il y a de cela soixante ans, quand une nuit nous entendions le fleuve bouger avec ses violentes vagues, l’eau devint noire et chaude. C’était la mère de Guirzile qui enfantait et au même moment ta mère te mit au monde. Non loin de chez toi, la mère de Dindamo accouchait et, au même instant, ton père, qui était chef à cette époque, plantait cet arbre au milieu du village, cet arbre qui aujourd’hui a soixante ans comme Guirzile, Dindamo et toi-même. Guirzile a mangé plus de vingt jeunes filles qui maintenant dominent vos âmes et demain engendreront votre mort. Voilà ce que je pense. Passez une bonne journée !
Guirzile s’en alla. Après avoir palabré, l’assistance refusa de croire le vieux sage qu’ils ne connaissaient pas.
Aussi la bataille s’engagea-t-elle entre le crocodile et Dindamo qui se transforma en ai…guille. Mais Guirzile n’avait toujours pas compris la suite du mot. Aussi l’aiguille le piqua-t-elle à l’œil. Il devint borgne. Puis elle lui piqua l’autre œil. Il devint aveugle. La lutte continua au bord du fleuve, où Dindamo tua finalement Guirzile. Au même moment le chef du village mourut, l’arbre planté par son père se dessécha et Dindamo trépassa à son tour.
Les villageois enterrèrent Guirzile, le chef du village et Dindamo autour de l’arbre sec.
Depuis ce jour, à chaque ouverture de la pêche, on sacrifie un bœuf pour obtenir leur bénédiction. On égorge aussi une poule sur la tombe de Guirzile avant de célébrer un mariage à Dokimana.
L’homme gourmand, par Cissé Ali. Tombouctou
Il était une fois, un homme d’une rare gourmandise. Il cultivait un jardin et ses récoltes n’étaient jamais bonnes, ne cessant d’affirmer que tantôt cela était dû aux oiseaux, tantôt aux rongeurs. Or, la réalité était tout autre : il mangeait lui-même sur place, une grande partie de ses récoltes.
Comme le dit la sagesse africaine, l’habitude n’est pas éternelle.
Un jour, comme à l’accoutumée, le jardinier posa sur le feu, dans un coin du jardin, sa marmite de haricots. La cuisson dégageait une délectable odeur qu’il savourait à souhait. Pendant ce temps, il allait et venait entre les sillons en chantant. Mais ce jour-là, le malheur s’abattit sur lui sans qu’il pût le soupçonner. Sa belle-mère vint lui rendre visite alors qu’il était sur le point de ventiler son repas pour le rafraîchir à la convenance de son gourmand palais. Du fond du jardin, la femme lui lança une première salutation. Surpris et craignant d’être découvert, il s’empressa de verser le contenu de son plat dans le creux de son chapeau et mit ce dernier sur sa tête.
La femme arriva et ils se saluèrent dans un mélange de cordialité et d’agitation. L’homme dodelinait sans cesse de la tête en répétant :
— Lorsque nous étions jeunes, c’est ainsi que nous faisions en parcourant les sillons.
Son crâne cuisait sous son chapeau. Il exécutait des gestes pour amortir l’intense chaleur qui lui brûlait la peau, mais en vain. La femme l’observait mais cela ne dura que trop longtemps, hésitant entre le désir de sauver sa vie et sa dignité, l’homme s’écroula.
C’est alors que l’on découvrit la réalité que jusque-là, l’homme gourmand avait cachée aux siens.
Haala. Danse des cultivateurs
Durée : 02:40. © Patrick Kersalé 1998-2024.
La selle d’or de la ville de Say, par Cissé Ali. Tombouctou
Il existait jadis, une selle de cheval en or. Elle avait appartenu au fondateur de la ville de Say[1]. Vivait là un marabout[2] très puissant qui n’aimait pas la guerre. Aussi utilisait-il cette selle pour défendre sa cité. Un jour, il alla l’enterrer dans un endroit qu’il était seul à connaître.
Les grands guerriers mossi[3] ; entendirent parler de ce puissant marabout et décidèrent de l’attaquer. Ils se mirent en chemin pour Say. Arrivés à deux kilomètres de la ville, ils s’arrêtèrent sur une colline. Le chef mossi demanda à son guide :
— Où se trouve la ville du marabout ?
Le guide répondit :
— En bas de cette colline.
Au même instant, un homme était venu prévenir le marabout que des guerriers mossi venaient attaquer sa cité. Le marabout demanda à son fidèle :
— Dans quelle direction se trouvent les guerriers ?
Alors le fidèle montra de la main la direction. Le marabout lui demanda confirmation en montrant lui aussi de la main :
— Est-ce bien dans cette direction ?
Le fidèle confirma. Alors, le marabout pointa son index dans la direction indiquée et le chef mossi tomba de son cheval, mort. Lorsque les guerriers constatèrent la mort de leur chef, ils rebroussèrent chemin. Ainsi, la ville de Say ne put jamais être attaquée par un quelconque guerrier.
Mais un jour, le marabout mourut et ses enfants héritèrent de son secret. Plusieurs générations se succédèrent. Un jour, les femmes de la ville ayant besoin de sable blanc pour répandre sur le sol de leur case, partirent à la sortie de la ville et creusèrent le sol. Une des femmes creusa un grand trou. En creusant, elle toucha un morceau de métal. Alors elle cria qu’elle avait touché quelque chose et devint aussitôt lépreuse. Devant cette désolation, les autres s’enfuirent. La femme s’en alla trouver le chef du village qui demanda ce qui s’était passé.
Elle répondit qu’en creusant le sable, elle avait touché quelque chose de métallique et qu’aussitôt elle était devenue lépreuse. Alors le chef envoya deux vieux[4] constater sur place. Il approfondirent le trou creusé par la femme, découvrirent la selle de cheval en or et l’apportèrent chez le chef du village qui leur dit :
— Cette selle d’or est le totem protecteur de notre village. Vous êtes maintenant trois personnes à le savoir en plus de moi. Moi, je suis condamné à garder le secret. La femme qui l’a découverte doit aller l’enterrer en secret dans un autre endroit afin que personne ne la trouve.
Accompagnée des deux vieux, la femme partit exécuter les ordres du chef. Mais, en cours de route, un des deux sages décida de ne pas enterrer la selle mais de la jeter dans le fleuve. Arrivée au bord du fleuve, la femme y jeta la selle le plus loin possible. À ce même moment, elle devint aveugle et muette et les deux sages devinrent aveugles. Ils revinrent chez le chef raconter leur mésaventure. Ce dernier leur dit :
— Cette femme est devenue aveugle et muette car les femmes ne savent pas garder les secrets. Désormais, elle ne pourra ni dire ni montrer à quiconque l’endroit où se trouve notre totem. De même, pour vous, les vieux, vous êtes devenus aveugles afin que vous ne montriez jamais l’endroit où se trouve la selle et celui qui, un jour, se hasarderait à révéler le secret, perdra lui aussi la parole.
Un jour, l’un des deux sages fut tenté d’en parler à sa femme et devint instantanément muet.
______________
[1] Village du pays songhay situé sur le Niger à une trentaine de kilomètres au sud de Niamey.
[2] Saint personnage musulman vénéré tant au cours de sa vie qu'après sa mort.
[3] Aujourd'hui ethnie majoritaire du Burkina Faso.
[4] En Afrique, l'usage des termes “vieux” et “vieille” pour désigner respectivement un homme et une femme âgés marque le respect.
Les orphelins, par Cissé Ali. Tombouctou
Il était une fois une belle orpheline. Elle était belle comme les fleurs d’été, belle comme les lucioles dans l’obscurité. Afin que rien de fâcheux ne lui arrivât, son frère l’emmena loin des regards indiscrets et des mauvaises intentions. Dans un endroit reculé de la brousse, il construisit une cabane solitaire entre les feuillages. Chaque matin, il conduisait son troupeau dans les pâturages. Au petit soir, il revenait tranquillement, enlevait les verrous de la cabane et nourrissait sa sœur de lait.
Afin que nul ne pût accéder au coffre qui gardait la perle orpheline, ils avaient convenu d’un mot de passe. Ainsi, elle pouvait, de l’intérieur, ouvrir elle-même la porte. Chaque fois, il lui lançait :
— Nagnouma.
Et elle répondait :
— Je crains les mauvais regards et les mauvaises intentions.
Le frère répondait alors :
— Cesse Nagnouma, cesse, car je crains la ruse des indiscrets, je crains la chasse des rois, tu es une proie rare.
Ainsi, Nagnouma et son frère vivaient en toute liberté dans cette nature généreuse. Ils jouissaient d’un bonheur parfait, loin de toute emprise humaine, jusqu’au jour où un chasseur du roi, s’étant séparé des siens, découvrit le mystère. À la vue de Nagnouma, il se frotta les yeux, abandonna sur place son arc et ses flèches et courut informer le roi.
Le souverain, impatient de voir cette mystérieuse créature, envoya son chasseur lui ramener Nagnouma. Mais comment le chasseur pourrait-il l’arracher de la cabane forteresse ? Un après-midi, il s’en alla provoquer Nagnouma dans son antre. Peine perdue, on aurait juré que ce logis n’avait jamais été habité. Il partit alors trouver le forgeron-féticheur et lui ordonna de lui donner une voix aussi belle qu’il le jugerait nécessaire. Le chasseur retourna tenter l’exploit. Il lança :
— Nagnouma.
Celle-ci répondit :
— Je crains les mauvais regards et les mauvaises intentions.
Le chasseur répondit :
— Cesse Nagnouma, cesse, car je crains la ruse des indiscrets, je crains la chasse des rois, tu es une proie rare.
Le soir, lorsque le frère de Nagnouma revint à la cabane, à la vue de la porte béante, la démence l’emporta. Il se languit et devint fou. Les bêtes sauvages décimèrent son troupeau, les oiseaux vinrent se poser sur sa tête et y déposer leurs excréments.
Les nuits succédaient aux journées. Les saisons passaient et repassaient. Nagnouma était devenue la femme adorée du roi. Jamais elle ne sortait de la cour royale mais ne manquait de rien. Le roi l’empêchait de voir son frère et elle-même n’aurait su le retrouver. Depuis lors, Nagnouma avait donné naissance à trois filles. Elles descendaient souvent au bord du fleuve, face au palais royal, pour s’y baigner.
Un jour, jeté en cet endroit par sa folie, le frère de Nagnouma traînait ses haillons, sa tête sale et sa sinistre maigreur. Il demanda à la fille aînée de lui apporter un bol d’eau afin qu’il se désaltère, car il avait peur des eaux du fleuve. Elle le rabroua en ces termes :
— Moi, princesse du roi, te servir dans mon propre bol, va-t’en au diable !
Le fou se retourna alors vers la benjamine turbulente et naïve qui apportait un bol d’eau en courant. Il se désaltéra et proposa de lui chanter une chanson qu’elle ne devrait chanter devant personne.
De retour à la cour royale, les deux filles aînées ne cessèrent de se moquer de leur sœur. Celle-ci s’isola dans un coin tranquille et chantonna sans cesse sa trouvaille :
— Nagnouma, je crains les mauvais regards et les mauvaises intentions. Nagnouma, cesse, car je crains la ruse des indiscrets, je crains la chasse des rois, tu es une proie rare.
Sa mère, interpellée par ces mots, s’approcha discrètement et écouta attentivement sa petite fille. Elle fondit en sanglots et l’enfant se tut. Elle fit mille caprices afin que la petite lui avouât qui lui avait appris cette chanson et dans quelles circonstances. Le lendemain, elle envoya ses serviteurs lui ramener le fou en question.
— C’est bien mon frère, pleurait-elle sans cesse.
On lui rasa le crâne, on lui fit porter des boubous neufs et on le logea dans le palais. Le roi, qui vieillissait, lui promit son trône, car il avait guéri à la seule vue de sa sœur.
L’honneur, en fin de compte, par Coulibaly Amadou. Tombouctou
Il y avait jadis, dans les sociétés traditionnelles de l’Afrique, une caste d’hommes et de femmes qui, depuis la nuit des temps, s’étaient érigée en gardiens de la mémoire des peuples, maîtres du verbe et de la parole. Ils étaient la mémoire vivante des royaumes et des empires. Ils chantaient les louanges des braves guerriers et des héros au combat. On les appelle aujourd’hui “griots*”.
Naguère, dans une société de l’Afrique ancienne, les griots chantaient les éloges mieux que n’importe où ailleurs. Les nobles y vivaient avec le poids ou les délices des événements anciens relatés avec zèle par les maîtres de la parole. Dans cette société, vivait un vieux griot, que l’on avait l’habitude de nommer doyen, un de ceux qui ne chantent pas selon le bon vouloir du premier venu, se réservant de jouer leur multicorde quand bon leur semble. Il refusait de chanter les éloges d’un m’as-tu-vu ou d’un couard, de sorte qu’il était devenu la convoitise des gens d’ici. Chaque jour lui étaient proposés des têtes de bœufs, des métaux précieux, des esclaves et même des femmes comme épouses. Peine perdue.
Un jour, les aristocrates du village se réunirent et allèrent trouver le diély pour lui faire part de leur préoccupation face à sa passivité devant leurs offres, ô combien intéressantes. Ils tentèrent de le convaincre de chanter quelques éloges aux nobles gens qu’ils étaient. Le doyen sentit que leur insistance allait au-delà de ses attentes, le mettant dans l’obligation d’accepter de chanter les éloges d’un seul homme.
Il convia alors ceux de sa contrée à une fête grandiose. Au milieu de la foule, le diély fit creuser un grand trou, y fit planter des flèches et des sagaies bien aiguisées, luisant à l’éclat du jour et le fit couvrir d’une toile gardée par deux vigoureux captifs. Tour à tour, les hommes entraient dans la danse après que le griot eût fait vibrer les cordes de son instrument dont les sons faisaient frémir la fibre guerrière de tous. Nul ne choisit cependant de se jeter dans ce trou truffé de lames acérées, lorsque les deux captifs le découvrirent de sa toile. Aucun de ses intrépides ne voulut briser le mythe, aucun de ces m’as-tu-vu ne put aller au bout de l’exploit.
Le bruit arriva jusqu’aux oreilles de Diawondo, une de ces belles dames qu’on ne rencontre qu’une fois dans sa vie. Elle se présenta à la fête, se glissa au milieu de la foule à pas gracieux et souples. Le grand griot gratta ses cordes avec habileté et les captifs découvrirent la fosse. Diawondo s’en approcha au moment où la cadence et le rythme faisaient tourner les têtes. Elle n’hésita pas un seul instant et se jeta sur les lances enfoncées dans le sol, défiant ainsi le ciel. Dans sa tanière, elle dansa de plus belle. Les dards acérés ne tardèrent pas à se transformer en bouillie fluide et elle en ressortit saine et sauve, telle qu’elle y était entrée. Le grand griot lui dédia alors un éloge personnel, comme lui seul savait en faire.
La nouvelle se répandit aux quatre coins du pays et Diawondo, héros, devint la convoitise des hommes qui ne purent se garder de succomber à son charme innocent et à son exploit légendaire. Elle acceptait de donner sa main, mais à une condition : celui qui voudrait l’épouser devrait pouvoir rester sept jours sans boire ni manger. Certains ne purent résister la journée toute entière, d’autres tinrent deux jours, mais personne ne put accomplir l’exploit, jusqu’au jour où un jeune homme, un de ceux qui raffolaient d’histoires extraordinaires, apprit la nouvelle. Il alla trouver un grand sorcier auquel il se confia et lui fit part de sa préoccupation. Le grand féticheur lui assura qu’il pourrait le faire résister neuf jours sans boire ni manger. Pour cela, il lui donna le pouvoir de transférer dans son estomac la nourriture et la boisson des gardiens qui le surveilleraient, chaque fois qu’il en aurait besoin et ce, simplement en tâtant son ventre ou son cou.
Il s’en alla trouver Diawondo et lui fit part de sa disposition à accepter ses conditions. Il fut alors mis à l’épreuve. Comme pour tous ceux qui l’avaient précédé, chaque matin, une calebasse de lait frais lui était apportée pour défier son appétit. Les jours succédèrent aux jours. Le soleil se coucha et se leva six fois. Alors Diawondo alla trouver la coiffeuse pour se faire tresser et se rendre belle pour ses fiançailles, car elle sentait le jour de ses noces approcher, son candidat ayant atteint le seuil du succès. Au sixième jour, le veau chéri du chef des lieux, qui ne se nourrissait que de lait et que personne ici n’osait frapper d’un coup de doigt, se glissa dans la case. Il but à longues gorgées tout le lait de la calebasse, sous les yeux du jeune homme et de la vieille femme qui assurait sa surveillance, sans que ni l’un ni l’autre ne manifestât quoi que ce soit.
À la fin de cette scène, la vieille femme s’empara d’un balai et fit disparaître les traces de pas du veau.
La cabane s’ouvrit et le chasseur emporta Nagnouma à la cour du roi. Ce dernier la fit mettre hors de la vue des indiscrets, puis il récompensa le chasseur. Les captives s’affairèrent à tresser et parer la nouvelle reine.
Les hommes et les femmes, poussés par la curiosité de connaître le héros des lieux, remplirent la cour de la maison, mais furent étonnés de découvrir la calebasse vide. Le bruit fusa de partout que le prétendu héros avait lâché prise. Le jeune aventurier s’expliqua, se défendit comme un diable, mais sa vieille gardienne nia les faits, en y opposant l’excuse de ses sorties intempestives pour aller satisfaire dame nature. Stupéfait et blessé dans son honneur, le jeune homme alla trouver le seigneur des lieux pour lui prendre son veau et faire éclater la vérité. Il accepta en échange du cheval de l’aventurier. Ô combien rare, préférer un seul veau à deux bœufs ! Le jeune homme ordonna de vider l’estomac de l’animal dans la calebasse qui retrouva son contenu initial. La foule le hua, car tout le monde savait ici que ce veau n’avait jamais bu autre chose que du lait de vache. Blessé dans son honneur, notre brave homme fit vider ses intestins pour prouver son innocence, avant de céder son âme à Dieu. Plutôt mourir que de vivre un tel affront !
Il ne resta à Diawondo que ses yeux pour pleurer son désarroi. Des années durant, la belle jeune femme rumina son désespoir. Les saisons succédèrent aux saisons. Elle resta inflexible aux nombreuses demandes en mariage car elle avait perdu son amour, le seul qu’elle méritait véritablement.
Un matin, comme tous ceux que le pays avait connu, Diawondo s’extirpa enfin de ses affres. Elle accueillit auprès d’elle un homme qui accepta de respecter le souvenir de son défunt prétendant. Elle formula trois exigences pour honorer la mémoire de son amour : une part à chaque repas, un bain à chaque bain, l’évocation du nom de son inoubliable amour, répété trois fois par son époux, avant leur coucher et à chaque crépuscule. Elle vécut avec lui de tendres moments sans jamais effacer de sa mémoire sa victime d’autrefois.
Mais, au fil des années, le couple bascula de la tendresse vers l’amour brut et sauvage, celui qui détruit encore de nos jours les hommes lorsqu’ils le croisent sur leur chemin. Alors, Diawondo proposa une nouvelle épreuve à son époux afin de tester son courage. Elle lui demanda de rester avec elle dans la case et de s’asseoir sur ses genoux. Elle y mettrait ensuite le feu et il devrait jouer du monocorde jusqu’à ce que les flammes les aient consumés tous les deux ensemble.
Ainsi moururent Diawondo et son mari, elle chantant et lui jouant sur son monocorde calciné.
Comme l’avait dit Diawondo, il ne faut jamais mourir en laissant un homme ou une femme souffrir toute une vie parce que vous lui manquez.
Mais alors, de Diawondo, de sa première victime ou de son dernier mari, qui incarnait le courage, la ruse et l’honneur ?
Le takamba est la danse préférée des Songhay. Elle est accompagnée du luth à trois cordes (kubur) et d'une demi-calebasse (gaasu) frappée avec des bagues métalliques. Le répertoire est essentiellement constitué de chants de louanges.
Durée : 06:16. © Patrick Kersalé 1998-2024.
La fidélité, par So Souleyman. Tombouctou
Il était une fois, voilà bien longtemps, un petit village du nom d’Arrameini. Ce lieu très célèbre comptait peu d’habitants. Mais tous étaient soit musulmans, soit animistes.
Un jour, un chef animiste arriva à la tête du village. Il régna pendant sept ans et, durant ces sept années, tout enfant qui naissait était assassiné et jeté à l’eau sur son ordre. Les villageois, mécontents mais effrayés, n’osaient s’y opposer de peur d’être assassinés à leur tour. Ainsi ce chef mécréant continua à agir en toute impunité. Comme si cela ne suffisait pas, il fit aussi arrêter et tuer des adultes. Alors, un homme d’âge mûr nommé Mamadou, décida d’éliminer ce chef impétueux. Il prit une hache et, au milieu de la nuit, entra chez lui, le trouva endormi et lui fendit la tête en deux. Le lendemain, il se proclama chef du village. Comme il était musulman, il promit de se mettre au service des villageois et leur dit ceci :
— Ô villageois ! Vous allez maintenant changer de vie puisque vous avez changé de chef. Vos enfants vivront comme vous le souhaiterez. Ceux qui ont de jeunes enfants dont ils ne peuvent assumer la charge, qu’ils les conduisent chez moi, je m’en occuperai.
Ainsi, Mamadou rassembla chez lui beaucoup d’enfants. Parmi eux, il y avait deux orphelins : une fille du nom d’Aminata et un garçon, Mamadou. Ces deux orphelins se croyaient frère et sœur et le chef les aimait beaucoup. Ils étaient heureux.
À cette époque et en ces lieux, il était de coutume de se marier à trente ans. Quand Mamadou eut atteint cet âge, le chef l’appela et lui dit :
— Mamadou, aujourd’hui tu as l’âge de te marier car tu as trente ans, aussi je te donne de l’or, une flèche et un cheval. Va dans le village à la recherche de celle que tu aimes et reviens m’informer.
Mamadou monta sur son cheval et partit. Il se promena sept jours durant sans pourtant rencontrer celle qu’il aimait car, en fait, il n’avait d’yeux que pour Aminata. Il retourna alors chez Mamadou et lui dit :
Le chef du village étonné, répliqua en ces termes :
— Mamadou ! Aminata n’est pas ta sœur, alors si tu l’aimes, épouse-la.
Mamadou, très heureux, répondit :
— Abba[1], je l’aime.
Le chef du village célébra aussitôt le mariage puis demanda aux nouveaux époux dans quelle maison ils souhaitaient habiter. Mamadou et sa femme répondirent :
— La maison que nous voulons habiter est la tienne, là où nous avons grandi.
À ces mots, le chef leur dit :
— Je ne peux vous donner ma maison toute entière, cependant je peux vous en céder une partie. Alors, si cela vous convient, je vous offre l’étage[2].
Ils acceptèrent et en furent très heureux. Mamadou leur offrit également de l’or et des bijoux, en bref, toutes les richesses que l’on pourrait imaginer. Les jeunes époux vécurent dans un parfait bonheur pendant deux années. Mais un jour, Aminata dit à son mari :
— Mon cher époux, voici deux années que nous vivons dans de bonnes conditions, mais nous ne travaillons pas. Nous dépensons les richesses que le chef nous a données lors de notre mariage. Si nous restons ainsi à ne rien faire, un jour ou l’autre ces trésors seront épuisés et nous n’aurons pas l’audace de lui en parler. Maintenant, poursuivit-elle, je te propose d’essayer de créer un petit commerce. Pour cela, prends ces cinq moutoukal[3] d’or, va au village voisin, vends-les et avec l’argent, achète des marchandises que tu viendras vendre ici ou dans un autre village, comme le font les grands commerçants.
Mamadou écouta sa femme, prit les cinq moutoukal d’or et partit au village voisin avec les grands commerçants. Arrivé là, il vendit son or, mais au lieu d’acheter des produits de valeur tels du bétail, des parures ou du sel comme le font les grands commerçants, il acheta des poules, des pigeons et du tabac. Passé le jour de la foire, il suivit les commerçants vers un autre village pour écouler ses produits, mais il ne put les vendre car ils n’étaient pas de valeur.
Dans le village, il se fit un ami qui lui loua une chambre afin d’y entreposer ses marchandises et lui prêta de l’argent pour qu’il puisse retourner à Arrameini. Quand les commerçants eurent terminé leurs affaires, ils revinrent ensemble au village. Lorsque Mamadou arriva chez lui, sa femme lui demanda :
— Alors mon cher mari, comment marche notre commerce ?
Mamadou répondit :
— Ça n’a pas marché car je n’ai pas pu vendre les produits que j’avais achetés, alors je les ai confiés à quelqu’un qui m’a prêté de l’argent pour me permettre de revenir ici. Maintenant je n’ai rien en poche, si ce n’est lâ ilâha ill’Allâh[4].
Aminata répliqua en ces termes :
— Mamadou, tu sais, le commerce c’est toujours comme ça, les débuts sont difficiles, surtout pour toi qui ne connaît rien dans ce domaine. Prends maintenant cinq autres moutoukals d’or et essaie d’acheter d’autres produits, peut-être cela ira mieux cette fois.
Mamadou les prit et partit. Mais cette fois, sa situation fut encore plus délicate, car il ne parvint pas même à vendre son or. Arrivé au village de son ami, ce dernier lui réclama le loyer de la chambre puis ses dettes. Pendant son absence, les termites avaient envahi la pièce dans laquelle se trouvaient poules, pigeons et tabac. Mamadou avait tout perdu. Il fut obligé de payer les crédits avec l’or qui lui restait. Tandis que les autres commerçants retournaient à Arrameini, Mamadou resta là, malheureux et misérable. Il finit alors par mendier. Il avait honte de retourner à Arrameini et ne donnait même pas de nouvelles à sa femme qui l’attendait. Elle l’attendit ainsi pendant un an. Aminata, soucieuse, fatiguée et désespérée, entreprit d’aller à la recherche de son époux. Elle ferma sa maison et partit. Elle arriva dans un petit village nommé Arabedji. Par bonheur, elle logea chez le chef qui lui demanda :
— Qui es-tu, d’où viens-tu, où vas-tu ?
Elle lui répondit :
— Je m’appelle Aminata, je viens d’Arrameini et je suis à la recherche de mon époux, parti il y a très longtemps.
Ce chef avait une fille très belle qui ne sortait jamais de la maison. Elle restait à l’étage et était gardée par des esclaves. Aminata se lia d’amitié avec elle et parvint à partager sa chambre. Elle était encore plus jolie que la fille de ce chef de village. Alors des hommes envoyaient à longueur de journée leurs esclaves demander des informations sur elle. Beaucoup voulaient l’épouser. Elle répondait invariablement qu’elle n’était pas venue ici pour se marier car elle l’était déjà. Un esclave, l’ayant aperçue dans la cour du chef du village, courut annoncer la nouvelle à son maître célibataire. Ce dernier se présenta sans délai chez le chef et lui demanda la main d’Aminata. Le chef, surpris, éclata de rire et lui dit :
— Va la voir toi-même, elle n’est pas ma fille !
L’homme se dirigea vers elle et lui déclara son amour. Elle lui répondit :
— Monsieur, ce n’est pas parce que je ne vous aime pas, mais je suis déjà mariée. Cependant nous pouvons échanger quelques mots si cela vous fait plaisir sinon, je vous le répète, je reste toujours fidèle à mon mari. De grâce, ne me parlez plus de mariage !
L’homme répliqua :
— Si tu ne m’acceptes pas comme mari, je te tuerai.
Aminata répondit :
— Tu me tueras alors.
Sur ces mots, l’homme, enragé, sortit de la maison.
Aminata était restée un bon moment chez le chef du village car elle s’entendait très bien avec sa fille. Toutes deux parlaient de tout et de rien. Il leur arrivait même d’échanger leurs couchettes. La nuit venue, l’homme qui avait projeté de tuer Aminata, s’arma d’un couteau tranchant et se dirigea vers la maison du chef du village. Il s’introduisit discrètement dans la chambre des jeunes filles, les trouva endormies, souleva lentement la couverture d’Aminata, l’égorgea et mit le couteau entre les mains de la fille du chef qui dormait profondément. Cependant, l’homme ignorait que cette nuit-là, les filles avaient changé de place et qu’il venait d’égorger non pas Aminata, mais la fille du chef du village.
Au petit matin, le chef envoya un esclave réveiller les filles à l’étage. Mais le pauvre revint rapidement en courant et en criant après avoir découvert la scène :
— Maître, maître, la jeune fille étrangère a égorgé votre fille, je vous le jure, en ce moment même, elle a le couteau en main et fait semblant de dormir.
Le chef répondit :
— Comment est-ce possible ? Je ne te crois pas.
Il envoya alors un autre esclave constater si cela était bien vrai. Ce dernier revint et lui raconta la même chose.
Le chef monta lui-même voir ce qui s’était passé. Lorsqu’il vit la mare de sang, il fondit en sanglots pendant quelques minutes puis reprit ses esprits. Le jour même, il convoqua chez lui tous les hommes de droit, les marabouts, le juge et tous ceux qui s’occupaient de rendre la justice. Quand tous furent arrivés, on fit venir Aminata pour décider de sa peine puisqu’il était dit qu’elle était l’assassin. En premier lieu, le juge prit la parole et dit ceci :
— Mesdames et Messieurs, je ne crois pas que cette jeune fille soit l’assassin de la fille du chef.
Puis il demanda l’avis du chef. Celui-ci pardonnait à Aminata, requérant sa libération, mais sollicita toutefois l’avis de sa femme qui dit :
— Moi, je ne peux pas pardonner à Aminata ; puisqu’il est dit qu’elle est coupable de l’assassinat de mon unique fille, alors qu’on applique la loi.
Le juge demanda à Aminata si elle avait bien entendu la déclaration de la femme du chef. Elle répondit qu’elle avait bien entendu et ajouta :
— Un mensonge qui ressemble à la vérité ne peut être jugé que par Dieu.
Alors le juge demanda qu’on la fouette. On la fouetta. On la fouetta jusqu’à ce qu’elle perdît connaissance puis on la transporta à dos de chameau loin du village.
Après cette tragédie, tous ceux qui avaient contribué à faire souffrir Aminata dans le village, succombèrent au malheur : la femme du chef, Assaïta, tomba gravement malade et l’homme qui l’avait fouettée perdit la vue. Le chef lui, resta sain et sauf.
Comme Aminata avait été jetée hors de la ville, elle se trouvait sur le chemin des commerçants qui partaient pour Arrameini, son village. Elle était restée là et souffrait. Alors, elle vit venir une caravane de chameaux. Arrivés à sa hauteur, les commerçants descendirent de leur monture. Aminata avait soif et faim. Ils lui donnèrent à boire et à manger et lui demandèrent ce qui lui était arrivé. Elle répondit :
— Le mensonge qui ressemble à la vérité ne peut être jugé que par Dieu, c’est tout ce que j’ai à dire.
Les commerçants lui proposèrent de les suivre pour l’emmener dans leur village situé près d’Arrameini et de la donner à leur chef comme femme car elle était très belle. Aminata refusa. Alors la caravane l’abandonna.
Aminata marcha péniblement sans savoir où elle allait quand soudain, elle aperçut un homme qui se dirigeait vers elle, s’approcha et la salua. Aminata le salua à son tour. Ensemble, ils prirent la route, tout en bavardant. À la tombée de la nuit, l’homme sortit ses provisions, ils mangèrent puis parlèrent de nouveau. Devant la beauté d’Aminata, l’homme ne put se retenir et finit par lui déclarer son amour. Elle lui répondit :
— Je suis à la recherche de mon mari, nous ne pouvons donc nous marier, mais si tu connais une manière d’avoir des rapports sans être vu de Dieu, alors j’accepte.
L’homme répondit que cela ne pouvait se faire. Alors ils marchèrent durant trois jours et trois nuits et mangèrent ensemble toutes les provisions de l’homme. La quatrième nuit, il répéta à Aminata qu’il l’aimait. Elle lui demanda s’il avait enfin trouvé la manière d’avoir des rapports sans être vu de Dieu. Sur ces mots, l’homme, découragé, se coucha et s’endormit. Le lendemain matin, Aminata se réveilla de bonne heure et partit alors qu’il dormait profondément. Elle marcha, marcha, et arriva enfin dans une grande ville. Elle se dirigea vers la maison du chef qui lui demanda :
— Qui es-tu ?
Elle répondit :
— Je suis l’esclave de Dieu, étrangère du chef de la ville.
Le chef l’accueillit. Aminata lui dit :
— Je suis à la recherche de mon mari qui est parti de notre village, Arrameini, il y a très longtemps. Je viens voir s’il ne serait pas ici.
Le chef répondit :
— Madame, il n’y a aucun étranger dans ma ville si ce n’est vous.
Puis il ajouta :
— Savez-vous madame, que mon village se prépare à partir en guerre contre la ville voisine ? Chaque année, nous nous battons mais nous sommes toujours vaincus. Si vous le pouvez, madame, faites quelque chose pour nous, afin que nous puissions vaincre nos ennemis.
Aminata dit au chef :
— Je suis d’accord, je vais vous aider. Appelez-moi vos braves guerriers afin que je leur donne un talisman.
Ainsi fut fait.
Les guerriers partirent, firent la guerre et la gagnèrent pour la première fois. À leur retour, le chef de la ville, très heureux, dit à Aminata :
— Dites-moi ce que vous désirez et je vous le donnerai.
Aminata répondit :
— Je vous ai donné le talisman au nom de Dieu, pas pour gagner quelque chose. Mon seul désir est de retrouver mon cher mari.
Alors le chef chargea le griot de publier dans tout le pays que « chez le chef de la ville de Djokké, il y a une femme qui soigne toutes sortes de maladies. Elle travaille bien et ne demande rien aux patients, seulement qu’ils soient honnêtes et francs avec elle, en lui racontant comment ils ont contracté leur maladie, c’est tout ».
En moins de deux jours, des milliers de malades se réunirent à Djokké pour se faire soigner par Aminata. Parmi eux il y avait des gens d’Arabedji : le juge, qui avait demandé qu’on fouette Aminata, la femme du chef du village d’Arabedji, mère de la jeune fille assassinée, l’homme qui avait été chargé de fouetter Aminata, puis l’homme avec lequel elle avait voyagé et qu’elle avait abandonné pendant son sommeil. Parmi les malades il y avait aussi Mamadou, son mari.
On organisa les séances de consultation. Les malades étaient rassemblés devant la maison du chef de Djokké. Aminata en sortit et s’adressa aux malades en ces termes :
— Chers malades. Je m’appelle Aminata, je suis à la recherche de mon mari. Quand je suis arrivée ici, j’ai trouvé la ville de Djokké en guerre. Je les ai aidés et leur ai fait du bien. Maintenant je guéris les malades. Alors vous passerez un à un pour m’expliquer comment vous êtes tombés malades.
Puis elle rentra dans la cour de la maison du chef.
Le premier malade visité était d’Arabedji, c’était l’homme qui l’avait fouettée. Elle lui demanda :
— Comment es-tu tombé malade ?
Il répondit :
— Dans mon village, j’étais dans la maison du chef et j’étais chargé de fouetter les malfaiteurs. Un jour, une femme est venue au village. Elle avait égorgé la fille de notre chef et on a appliqué la loi. J’ai été chargé de la fouetter et quelques moments après, je suis devenu aveugle.
Aminata lui dit :
— Merci, vous pouvez partir, vous êtes guéri.
Et sa cécité disparut instantanément. Aminata fit entrer le second patient. C’était le juge du village d’Arabedji. Elle lui demanda :
— Comment êtes-vous tombé malade ?
Il répondit :
— Je suis le juge du village d’Arabedji. J’avais jugé une jeune femme qui était chez notre chef puis après, je fus sérieusement malade.
Aminata le remercia et le guérit. Ensuite elle demanda à la troisième personne, qui était la femme du chef du village d’Arabedji :
— Comment êtes-vous tombée malade ?
Elle répondit :
— Une jeune femme, venue de je ne sais où, a assassiné mon unique fille. J’ai demandé à ce que la loi soit appliquée et depuis, je suis malade.
Aminata la remercia et la guérit aussi. Elle demanda au quatrième malade d’approcher.
— Monsieur, comment êtes-vous tombé malade ?
Il répondit :
— Chez le chef de mon village, vivait une jeune fille que j’aimais, mais qui ne voulait pas de moi et j’ai voulu l’égorger. Malheureusement ce n’était pas la fille que j’aimais que j’ai égorgée, mais la fille de notre chef, car elles couchaient dans la même chambre et cette nuit-là, elles avaient échangé leur couchette. La fille que j’aimais a été sévèrement punie car on la croyait coupable et depuis, je suis malade, voilà tout.
Comme il était très honnête, Aminata lui dit :
— Monsieur, cette fille que vous aimiez, c’est moi, mais vous pouvez partir, votre lèpre est guérie.
On lui amena le cinquième malade. Il dit :
— J’étais en voyage et j’ai rencontré une belle dame. Ensemble, nous avons fait route et je lui ai déclaré mon amour. Elle m’a dit que si je pouvais faire l’amour avec elle à l’insu de Dieu, que je le fasse. Cela étant impossible, j’ai beaucoup réfléchi, puis je me suis découragé et me suis endormi. Quand je me suis réveillé, elle n’était plus là et je suis devenu fou.
Aminata lui dit :
— Tu as parfaitement raison. Cette dame, c’est moi. Va-t’en, tu es guéri.
Aminata lui donna une bague en or et continua à traiter ainsi les malades un à un. À la tombée de la nuit, on arrêta les traitements. Aminata était fatiguée de sa journée de labeur. Le chef lui demanda :
— Aminata, que puis-je faire pour vous ? Aujourd’hui je suis votre esclave.
Aminata répondit :
— Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous voulez me donner. Vous n’êtes pas mon esclave. Vous restez chef de votre ville. Aujourd’hui plus que jamais, je continue à chercher mon mari, c’est tout ce que je désire.
Le lendemain, les traitements recommencèrent et le premier patient était un aveugle. C’était en fait Mamadou. Aminata l’avait aussitôt reconnu grâce à une bague qu’il portait. Lors de leur mariage, leur père adoptif leur en avait donné une semblable à chacun. Alors Aminata lui demanda :
— Comment es-tu devenu aveugle ?
Il répondit :
— J’avais été adopté, en même temps qu’une autre jeune fille par le chef du village d’Arrameini, alors que j’étais encore en bas âge. Quand j’ai eu trente ans, le chef du village m’a demandé de rechercher la femme que j’aimais. Je n’ai vu qu’Aminata, celle avec qui j’avais été adopté et nous nous sommes mariés. Nous avions beaucoup de richesses et nous avons essayé de créer un petit commerce, mais ça n’a pas marché. J’étais dans un village voisin et j’ai tout perdu. Alors j’ai eu honte de revenir chez ma femme les poches vides. J’étais misérable. Je mendiais et j’ai fini par devenir esclave du chef du village, puis je suis devenu aveugle.
Aminata lui demanda en ces termes :
— Et votre femme, depuis combien de temps l’avez-vous quittée ?
— En réalité, je ne sais pas exactement, ce que je sais, c’est que je l’ai quittée il y a très longtemps, répondit-il.
Aminata lui demanda :
— Si vous voyiez votre femme, la reconnaîtriez-vous ?
Il répondit :
— Oui.
Aminata lui dit encore :
— Moi qui vous parle, si je vous redonne la vue, m’accepteriez-vous comme épouse ?
Mamadou répondit :
— Non, car j’ai promis à ma femme de ne jamais prendre une autre femme tant qu’elle vivrait.
Aminata lui dit :
— Donc, même si je vous donne la vue, vous ne m’épouserez pas ?
Il répondit :
— Non, non et non. Je ne trahirai jamais la confiance de ma femme.
Alors Aminata lui redonna la vue. Il la reconnut et ils s’embrassèrent aussitôt. C’était une grande joie. Ils se demandèrent des nouvelles.
Le lendemain, ils quittèrent la ville en direction de leur village. Arrivés là, Aminata continua à y soigner les malades.
Ce conte est l’un des plus appréciés des Songhay ; il est généralement conté aux nouveaux mariés lors des mariages afin qu’ils puissent juger de l’importance de la fidélité dans le foyer.
_______________
[1] Papa.
[2] L'une des particularités de Tombouctou est de posséder des maisons construites en pisé avec un étage, une rareté dans cette région du monde.
[3] Mutukal ou mithkal (en arabe) désigne environ cinq grammes d'or.
[4] « Il n'y a de dieu que DIeu » : profession de foi des musulmans.
Pourquoi l’hyène marche-t-elle en boitillant ?, par Touré Aminata. Tombouctou
Un jour, l’hyène et le lièvre traversaient une grande famine. Tandis que l’hyène dépérissait et que les siens se languissaient, on voyait le lièvre tout luisant et les siens n’arborant aucune ride. L’hyène vint alors trouver le lièvre pour savoir comment il faisait, mais ce dernier refusa de lui révéler son secret. Mais l’hyène insista tellement, que le lièvre lui confia que quelque part dans la brousse vivait une vieille vache et que, chaque jour, il s’introduisait dans son ventre par l’anus pour y découper des morceaux de graisse qu’il rapportait à la maison.
L’hyène voulut s’y rendre tout de suite mais le lièvre lui dit :
— Pas maintenant, demain et demain seulement !
L’hyène, qui chaque jour ne rapportait que des vers et des crabes, était très impatiente d’arriver au lendemain. Elle rentra chez elle afin d’attendre que les vieilles hyènes toussent comme à leur habitude chaque matin. Mais, gagnée par la nervosité, elle eut une idée : elle alla taper sur sa vieille mère qui se mit à tousser et revint trouver le lièvre. Celui-ci lui dit :
— J’ai rêvé que quelqu’un tapait sur sa vieille mère, va donc attendre le chant du coq.
L’hyène s’en retourna alors effrayer les coqs du poulailler qui se mirent à chanter. Elle revint trouver le lièvre qui lui dit :
— J’ai rêvé que quelqu’un avait cogné sur le poulailler et sur les coqs, va attendre la lueur du jour.
L’hyène rentra chez elle et mit le feu à son grenier, ce qui produisit une grande lueur. Quand elle revint chez le lièvre, celui-ci lui donna un grand tamis et lui demanda d’aller puiser de l’eau pour se laver le museau. Ainsi, ils purent attendre que les femmes commencent à se rendre au marigot.
Les deux compères vinrent trouver la vieille vache et s’introduisirent dans son ventre par l’anus. Le lièvre conseilla à l’hyène de ne pas toucher à la graisse qui abonde autour de l’anus. Mais comme l’hyène n’a jamais pu résister à la tentation de son estomac, elle découpa un morceau de graisse à l’endroit interdit et la vieille vache s’écroula, morte, refermant son anus sur les deux compères.
Dans le ventre du cadavre, les deux prisonniers s’affairèrent à trouver une cachette. Le lièvre entra dans la vessie et l’hyène dans l’estomac. Bientôt, les villageois accoururent pour dépecer leur bête, l’éventrèrent et coupèrent la vessie qu’ils donnèrent aux enfants pour en déverser le contenu. Chaque fois que les jeunes essayaient de la vider, le lièvre leur disait d’aller plus loin et, croyant obéir aux paroles des plus âgés, ils s’éloignèrent de plus en plus. Ils arrivèrent ainsi derrière un arbuste et déversèrent le contenu de la vessie. Le lièvre en sortit et donna une gifle à un enfant qui se mit à pleurer. Entendant cela, les villageois accoururent et demandèrent aux enfants ce qui se passait. Alors le lièvre prit la parole et répondit :
— Les enfants m’ont trouvé assis sous cet arbuste et m’ont uriné dessus.
Pour réparer la faute, les villageois promirent au lièvre un morceau de viande. Lorsqu’ils coupèrent l’estomac pour le vider, il était lourd et les gens s’étonnèrent de son poids anormal. Ils découvrirent que quelque chose bougeait à l’intérieur. Alors le lièvre dit aux enfants d’aller chercher des bâtons. Quand on ouvrit l’estomac et que l’hyène voulut s’échapper, on l’assomma à coups de gourdins, tant et si bien qu’elle s’étala, raide. Le lièvre s’approcha alors et, lui qui connaissait bien l’hyène, se mit à dire :
— Ah que ce morceau de viande est gras, si grand frère hyène était vivant, je le lui aurais donné !
Alors l’hyène ouvrit les yeux et d’autres coups s’abattirent sur son dos.
Ainsi, depuis ce jour, l’hyène marche toujours en boitillant.
Abarbarba. Danse des bouchers.
Durée : 02:33. © Patrick Kersalé 1998-2024.
Que justice soit rendue, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Il y avait jadis, dans une ville du Mali, un homme très riche qui portait des colliers d’or. Il en possédait tellement, qu’il en ornait ses montures et sa maison. Dans cette même ville, vivait un pauvre homme qui, tous les matins, allait de village en village vendre des fruits sauvages afin de nourrir sa femme et son enfant. Bien qu’il fût très pauvre, pas un seul jour il ne s’était plaint de son sort au point de baisser les bras, restant toujours vaillant et courageux.
Un matin comme tous les autres, au moment où les portes des maisons s’ouvrirent, un vieux lépreux se présenta chez le richard de la ville et demanda l’hospitalité. Celui-ci fit appeler ses serviteurs qui s’occupèrent du vieux malade en le jetant loin dans la rue. Mais le vieux lépreux était en fait un être d’un autre univers, venu sonder le comportement des hommes d’ici-bas. Il se présenta tour à tour chez les gens aisés de la ville. De menaces en injures, en passant par de méprisants silences, le vieil homme erra en vain, ne trouvant aucun être généreux pour l’héberger. Alors, d’un pas trébuchant et d’une brève salutation, il se présenta chez l’homme le plus pauvre de la ville. Il fut accueilli comme un ami et on l’installa dans une case. Ce vendeur de fruits sauvages s’occupa tellement bien de son étranger, que celui-ci en était tout étonné. Le vieux lépreux, qui n’avait d’homme que l’apparence, ne mangeait ni ne buvait ce qu’on lui apportait. Il le déversait dans un trou qu’il avait creusé sous son lit de bambou.
Il passa sept jours et sept nuits chez son hôte et le septième jour, il décida de partir au moment où le soleil déclinait vers les ténèbres de l’horizon.
Le pauvre du village prit le sac de son étranger et le raccompagna comme il se doit pour un visiteur. C’est alors que le lépreux lui confia :
— À ton retour, tu regarderas sous le lit que tu m’as fait installer, j’y ai laissé quelque chose. Maintenant que nous sommes loin du village, retourne chez toi. Je ne te remercie pas, le ciel le fera à ma place. À présent, va et ne regarde pas derrière toi jusqu’à ce que tu arrives dans ta case.
Les deux hommes se retournèrent après les adieux et le prétendu lépreux, telle une fumée, monta dans les cieux. Sur les traces du pauvre homme hospitalier se bousculèrent des milliers de têtes de bœufs, de chameaux, de chevaux, de moutons, d’ânes et de chèvres. Des bêtes ne cessèrent de sortir de terre et la poussière envahit l’atmosphère. L’homme jadis le plus pauvre de la ville se précipita sous le lit en bambou et trouva, dans le trou creusé par le lépreux, or, diamants et pierres précieuses. Quel beau jour fut ce jour. Les plus pauvres d’ici étaient les plus heureux, les plus riches les plus tristes.
Les jours suivants, se constituèrent de longues files de riches gens de jadis, venus quémander chez le pauvre d’hier, un travail de berger ou de serviteur.
Les griots chantèrent sur leur monocorde des grandes occasions, le partage et la bonté.
Au pays de Sa, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Il était une fois, au pays de Sa, un redoutable chef de guerre qui faisait trembler les guerriers des autres contrées, simplement en imprimant son image ou son nom dans leur esprit. Personne dans le pays n’avait une seule fois osé défier ses foudres et nul ne répondait à ses défis. Pourtant, dans de lointains territoires, régnaient de terribles chefs de guerre et de tribus tels Garba Mama, Amadou Foulah ou Garba Dicko. Tous excellaient dans l’art et le métier des armes, faisant fuir les envahisseurs les plus acharnés, mais même ces héros n’osaient défier les démoniaques guerriers de Sa.
Au-delà des frontières du pays de Garba Mama, il y avait une très belle jeune fille, particulièrement convoitée par les héros des dizaines de royaumes du pays. Elle y vivait mi-reine, mi-déesse. Les jeunes l’adoraient et la vénéraient. Elle s’appelait Aminata. Souvent, Garba Mama se rendait à son village pour lui faire la cour. Quand il dépêchait son fidèle captif pour lui annoncer sa venue, Aminata lui envoyait une de ses bagues en souvenir, car elle était trop précieuse pour accepter de s’asseoir auprès du premier venu. Elle faisait de même avec tous les chefs qui venaient demander ses faveurs.
La mère d’Aminata était une commerçante réputée qui fréquentait les foires les plus florissantes des pays prospères. Elle était riche et cherchait la richesse partout où elle se réfugiait. Aminata l’encourageait dans sa quête, mais lui conseillait d’éviter les foires de Sa, afin de n’avoir jamais à essuyer les colères du redoutable chef de ces lieux. Mais la vieille femme n’en faisait qu’à sa tête et décida, un jour, d’aller aux foires de Sa.
Ce jour arriva, un jour de foire comme les autres. Les denrées et le bétail affluaient de partout. La foire s’animait. On y trouvait de tout : le sel du nord, le poisson séché ou frais des bords du fleuve, les perles d’Orient et les étoffes de soie venant de l’autre côté de l’océan. La mère d’Aminata étala ses précieuses épices tandis que ses captifs les surveillaient.
Le chef de Sa avait un garçon des plus choyés qui possédait un chien. Quiconque osait toucher l’animal déclenchait la colère du seigneur incontesté des lieux. Ce matin-là, le prince adulé avait détaché son compagnon. Celui-ci se précipita dans les allées du marché, se dirigea vers les étalages de la vieille mère d’Aminata et croqua ses épices. Celle-ci ne badinait pas avec ses biens. Elle lui asséna des coups de bâton. Les aboiements du chien déclenchèrent une panique générale car ici, chacun savait qu’il était intouchable. Alerté par les cris, le prince se précipita dans le marché et chercha à savoir qui avait osé porter un coup à son compagnon. Apeurés, les gens ne purent répondre à sa question, mais la vieille femme répondit que c’était elle, elle la mère de la belle Aminata. Le prince lui fit part de la gravité de son geste, ajoutant qu’il n’avait jamais entendu parler d’elle, mais que de toute façon, elle allait le regretter.
La mère d’Aminata ne tarda pas à être maîtrisée par les captifs du prince. On l’emmena et on lui rasa le crâne. Le prince demanda alors que l’on fît venir celui qui avait beaucoup voyagé et connaissait les scarifications. Celui-ci se chargea de dessiner sur la tête de la vieille femme un motif constitué de toutes les formes de scarifications qu’il connaissait. Impuissante et humiliée, la mère d’Aminata s’en retourna au village accompagnée de ses captifs. Au moment où la vieille femme, très abattue, tentait de s’engouffrer avec discrétion dans sa case, Aminata l’interpella pour lui demander des nouvelles de ses affaires. Elle eut tellement de peine à esquiver les questions, que sa fille comprit que quelque chose n’allait pas. Un des captifs lui raconta alors leur mésaventure à la foire de Sa. En entendant ces mots, Aminata décida de venger sa mère, elle, la convoitise des grands guerriers et des puissants rois, elle, l’unique, la seule que des milliers de héros vénéraient. Ainsi donna-t-elle ordre à ses captifs de fabriquer sept pirogues et de les couvrir d’une couche d’or. On en remplit une de noix de cola, une autre de tabac, une autre d’armes, une autre encore de munitions et le reste de captifs et de guerriers. Les sept embarcations naviguèrent cap à l’est avec à leur tête la belle Aminata.
Le convoi accosta sur les berges du village de l’Ardo Garba Dicko, Peuhl redoutable, héros de guerre et roi de sa tribu. Aminata envoya un messager pour annoncer sa visite à Garba Dicko. N’en croyant ni ses oreilles, ni la langue du messager, le chef de guerre envoya son captif de confiance vérifier la nouvelle, car il n’avait jamais eu droit, de la part de la belle, qu’à une bague symbolisant son amour. Le captif confirma la nouvelle.
Garba Dicko fit alors venir Aminata dans sa cour royale. D’une voix sereine, Aminata rassura l’Ardo et lui dit que s’il voulait sa main, elle la lui offrirait en échange d’une dot constituée de la tête du roi de Sa et de celle de son fils. Garba Dicko mesura la délicatesse de la tâche car il n’avait jamais oser imaginé affronter le roi de Sa, a fortiori l’attaquer. Il demanda à Aminata de lui accorder un délai de douze lunes pour parfaire ses préparatifs pour l’assaut de la citadelle de Sa. Aminata se releva brusquement et demanda à se retirer car elle n’était point satisfaite.
Elle et les siens se remirent en route vers le nord et se rendirent tour à tour chez Garba Mama et d’autres chefs des contrées nordiques. Ils arrivèrent enfin chez Amadou Foulah, l’Ardo Peuhl. Il était certes maigrelet, mais si on le terrassait, il griffait en se relevant. Il avait déjà été informé, car partout où Aminata était passée, elle n’avait pu obtenir satisfaction. Il avait fait poster des éclaireurs pour surveiller la berge nuit et jour afin de l’informer de l’arrivée de la belle Aminata. Mais sept jours avaient passé et les éclaireurs s’étaient lassés d’attendre celle qui ne viendrait peut-être jamais. Au huitième jour, une vieille femme qui se baignait, vit l’eau du fleuve s’illuminer d’un éclat jaune d’or. Elle comprit très vite ce qui se passait et s’empressa d’avertir le roi. Devant Amadou Foulah, elle resta bouche bée, tant elle était émue de pouvoir être récompensée par lui-même. Les gestes de la vieille femme firent comprendre que quelque chose venait du côté du fleuve et qu’elle avait peur. On fit construire une tente depuis la rive du fleuve jusqu’à la cour royale.
Aminata répéta à Amadou Foulah ce qu’elle avait déjà proposé à ceux qui convoitaient sa main. Lorsqu’elle prononça « la tête du roi de Sa », le chef de guerre, en soupirant, sentit une boule de sang lui traverser le thorax pour finir sa course sur les courtisans et les nobles de sa cour. Il dit :
— J’ai bien saisi votre proposition, Aminata, mais nous sommes en période de travaux champêtres. Après ceux-ci, je partirai et vous rapporterai la tête du roi de Sa et celle de son fils.
Aminata, inquiète, répondit :
— Dites-moi précisément à quel moment.
L’Ardo Peuhl, déjà sur les nerfs, griffa la belle Aminata avant de lui faire une confidence :
— Le jour où je lancerai mes guerriers à l’assaut du roi de Sa, même les animaux sauront qu’il se passe quelque chose, a fortiori les humains. Les fœtus se débattront dans le sein de leur mère, les animaux sauvages viendront chercher refuge jusque dans la demeure des hommes, les eaux du fleuve s’agiteront sous un cyclone.
Aminata s’en retourna alors avec les siens, attendant impatiemment le grand jour. Pendant ce temps, Amadou Foulah fit informer son frère cadet, son redoutable ministre de la guerre et son brave captif stratège, de ses projets. Ceux-ci lui renouvelèrent leur accord et leur fidélité.
Le jour de l’assaut contre Sa, il y avait dans la forêt plus de cavaliers que d’arbres, plus de flèches et de fusils que d’oiseaux. Lorsqu’Amadou Foulah et ses hommes approchèrent de Sa, celui-ci fit parler son fétiche protecteur et prédicateur :
— Les signes sont clairs, Amadou, vous n’avez ni le pouvoir, ni les forces nécessaires pour prendre Sa. Pas même votre regretté père, plus redoutable que vous, ni même votre grand-père lui-même, dont vous avez hérité vos dons de guerrier et votre bravoure de famille, n’en auraient eu les moyens
Amadou Foulah souleva le fétiche pour l’écraser contre le sol, mais il continua à parler :
— Non, Amadou, ne fais pas cela, il ne servirait à rien, je ne te dis que la vérité en réponse à ta question.
Mais le chef de guerre ne battit pas pour autant en retraite. Le vin était tiré, il fallait le boire, fût-il amer ou indigeste. Il lança ses troupes sur Sa. Le roi et son prince les accueillirent en ennemis. La défaite fut cuisante pour l’Ardo. Il perdit la vie, mais, en brave guerrier, il avait préféré la mort à la peur.
En pirogue sur les eaux peu profonde du fleuve Niger. Propulsion à la perche à travers les herbes affleurant.
Durée : 02:34. © Patrick Kersalé 1998-2024.
Un malheur n’arrive jamais seul, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Un jour, la mouche, le moustique et le gros-ventre se rendirent ensemble au fleuve pour faire la lessive. Les trois compagnons arrivèrent tôt au bord de l’eau pour une journée de grand nettoyage. Le linge était là et le travail pouvait commencer. Le moustique, voulant se montrer laborieux, entra dans l’eau jusqu’aux genoux pour remplir son récipient. Tandis qu’il ressortait avec son réceptacle, le poids de celui-ci lui arracha les deux bras.
La mouche, qui vit cette scène désolante, se mit à pleurer et à plaindre son ami le moustique. Elle pleura et pleura encore. Un instant, elle voulut essuyer ses larmes comme la mouche le fait toujours et sa tête roula à terre.
Le gros-ventre eut peur de pleurer, mais comme il ne pouvait se taire, il se mit à rire, à rire et à rire encore, quand soudain son ventre éclata.
« Un malheur n’arrive jamais seul, tâchons d’être modérés ».
Deux trouvailles providentielles, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Un jour, un vieil homme, qui était le plus pauvre du village, s’en alla en brousse chercher de quoi manger en attendant la saison des récoltes, mais il ne trouva rien à se mettre sous la dent. Il partit alors cultiver son champ le reste de la matinée et lorsque la faim plia les muscles de son ventre, il prit le chemin du retour. Son espoir de trouver à manger à la maison était à peine plus grand que les poils de ses orteils. Sur le chemin, il vit alors une calebasse toute neuve. Il la ramassa. Elle était trop lisse et trop jolie pour être naturelle et le vieil homme lui demanda :
— Calebasse, comment vais-je t’appeler ?
Alors la calebasse répondit :
— Je m’appelle « à boire et à manger autant que tu voudras ».
Une fois rentré à la maison, le vieil homme mit la calebasse dans ses effets personnels et interdit à quiconque d’y toucher. Ainsi, chaque jour, il l’utilisait et faisait festoyer sa famille qui se portait de mieux en mieux. Il avait conseillé à sa femme de n’en jamais parler à quiconque. Mais, comme la femme n’a jamais vraiment su garder un secret, la nouvelle parvint aux oreilles du roi qui fit amener le vieil homme et sa calebasse et lui échangea contre son pesant d’or. Le vieil homme, mécontent de perdre sa seule richesse, se résigna néanmoins et retourna dans sa demeure, revivre comme par le passé.
Un autre jour, toujours en revenant de son champ, il vit sur son chemin une jolie canne luisante et superbement dorée. Il la ramassa et lorsqu’il prononça « jolie canne », la canne lui répondit :
— Je m’appelle « caresseur de crâne ».
Et le vieil homme de lui demander alors :
— Caresse-moi le crâne car il me fait de plus en plus mal sous ce chaud soleil.
Aussitôt, la canne se mit à ricocher contre la tête du vieil homme qui cria en vain, puis elle finit par retomber. Il la ramassa et fit de même que pour la calebasse, à la différence près qu’il ne lui demanda rien.
Comme à son habitude, sa femme ne sut tenir sa langue et, sur le chemin menant au puits à la cour royale, le roi apprit la nouvelle. Il fit venir le vieil homme et il lui échangea la canne contre deux fois son pesant d’or. Cette fois, conscient de faire une bonne affaire, le vieil homme quitta le village avec les siens.
À force d’admirer et de caresser la canne, le roi se proposa de lui donner un nom, mais la canne répondit :
— J’en ai déjà un, je me nomme « caresseur de crâne ».
— Et bien, dit le roi, caresse-nous les nôtres que je vois !
La canne commença alors par le roi. Elle frappa les crânes rasés, les crânes chauves, les crânes gris, les crânes blancs, les crânes tressés et même ceux des innocents. Tout le village fut bientôt « caressé » et tout le monde courut hors de la ville sur les traces du vieil homme.
« Ne dépossédons jamais le pauvre de la providence qui l’a aidé à survivre ».
Famine dans le village des animaux, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Il était une fois, une grande pénurie de subsistance au village des animaux. Nulle part ne se profilait l’ombre d’un grain de céréale, sauf chez les chats. Aussi, les villageois y faisaient-ils la queue pour y échanger quelques grains.
Pendant ce temps, chez les souris, on se préoccupait de chercher le repas du jour. Monsieur souris demanda un sac à sa femme et pénétra dans le village dans l’espoir d’y trouver quelques grains. Il apprit bientôt l’existence d’une vente de céréales dans un lieu qu’on lui indiqua. Il s’y rendit aussitôt et fit la queue comme tout le monde. On se bousculait, on se disputait pour conserver sa place. Monsieur souris attendit ainsi du petit matin jusqu’au zénith. Quand arriva enfin son tour, il se rendit compte qu’il était chez les chats. Ayant aperçu le robuste matou moustachu qui mesurait le grain, il abandonna l’idée d’acheter ses céréales et quitta le rang pour disparaître dans la foule. Quand il arriva à la maison, madame souris s’enflamma d’une grande colère :
— Comment as-tu osé revenir sans un grain, alors que tous nos voisins en ont rapporté ?
Monsieur souris répondit :
— Ceux qui vendent les grains sont des gens discourtois avec lesquels nos ancêtres n’ont jamais été en bons termes.
Madame souris attrapa alors le sac et s’élança vers le lieu de la vente. Furieuse, elle bouscula le rang et s’approcha de la porte de la caverne des chats. Il y en avait qui portaient des robes à rayures, d'autres des robes grises, noires, blanches, tachetées comme la panthère, il y avait aussi des chats moustachus comme des lions. Elle s’arrêta un instant et vit sur le toit, deux yeux qui brillaient comme des feux de brousse après une nuit de tornade. Elle abandonna alors son sac et rentra en catastrophe dans son trou, renversant tout sur son passage. Monsieur souris s’exclama alors :
— Moi, au moins, j’ai rapporté mon sac, et en toute élégance !
L’ultime sacrifice, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Il était une fois, un village lacustre qui vivait avec bonheur et prospérité, mais aussi avec la peur d’un étrange monstre qui vivait dans les eaux du lac. Chaque année, à l’heure des récoltes, le village devait offrir au monstre, en sacrifice, sa plus belle fille en âge de procréer. Cette habitude était devenue tradition jusqu’à cette année-là, année où la fille du chef du village se trouva désignée pour le sacrifice, car il n’y avait jamais eu d’aussi jolie fille dans le pays. Ses seins remplissaient sa poitrine, ses hanches dorlotaient les regards, son sourire et l’expression de son visage faisaient perdre aux jeunes hommes le verbe. Elle était aimée de tous les jeunes gens d’ici mais, comme tout le monde savait qu’elle serait la prochaine jeune fille servie en sacrifice, personne ne s’était laissé emporter par sa beauté.
Cependant, il y avait dans le village, un jeune homme plus courageux et plus vaillant que tous, qui n’avait jamais accepté le mot « impossible ». Un soir, il était sorti de sa case et avait surpris, au clair de lune, une diablesse qui venait de traire, en cachette, une vache noire dans son enclos et s’apprêtait à se sauver. Alors, le jeune homme lui barra le chemin. Vainement, elle tenta de lui expliquer qu’elle avait un bébé à nourrir avec ce lait. Comme le garçon restait perplexe, la diablesse lui proposa un marché. Elle lui fit une promesse et lui prédit qu’un jour, et ce jour était proche, il aurait besoin d’un miracle et qu’elle lui apporterait son aide. Alors, le jeune homme la laissa passer.
Il commençait déjà à oublier cette aventure quand, un soir, le crieur public passa pour annoncer les préparatifs du sacrifice qui aurait lieu le lendemain. Alors, le jeune homme eut un sentiment hors du commun pour la belle créature du village et comprit les prédictions de la diablesse. La nuit venue, il attendit que le calme s’emparât des demeures et du rivage, que la vie fît semblant d’abandonner les cases et vint s’asseoir au dehors. Bientôt, un vent doux et frais vint le faire somnoler. Il résista désespérément quand la diablesse lui apparut, comme si elle sortait des ténèbres. Ce soir-là, elle était plus lumineuse que la lune et les étoiles réunies. Elle prit la parole :
— En arrivant, j’ai compris ta préoccupation. Demain, à l’heure du sacrifice, tu te proposeras de livrer toi-même la jeune fille. Tu seras alors transformé en un parfait sosie et moi, j’en serai un second, et personne, pas même le monstre, ne pourra distinguer celle qui lui est apportée en sacrifice. Je me jetterai à l’eau, le reste, je te laisse le deviner.
L’heure du grand sacrifice fut annoncée au son du tam-tam.
Comme d’habitude, on disposa les jeunes gens en ligne pour tirer au sort celui qui devrait livrer la jeune fille au monstre, à défaut de volontaire.
Comme convenu avec la diablesse, le jeune homme se porta volontaire. Son courage légendaire l’écarta de tout soupçon. Les pleurs et les cris fusèrent de partout. On amena la beauté du village et on la confia au sacrificateur qui la saisit avec grâce et lui demanda en chuchotant à l’oreille :
— Que ressens-tu ?
— De la peur et de l’angoisse, j’aurais préféré que ce jour ne me trouvât pas en vie, répondit la jeune fille.
Le jeune homme la rassura alors en lui disant :
— Je serai entre le monstre et toi.
Alors la jeune fille répliqua :
— Lorsque l’on fait un sacrifice, l’objet se retrouve entre celui qui reçoit et celui qui donne.
Le jeune homme lui dit enfin ceci :
— Aujourd’hui, le sacrifice sera fait à ma façon.
Tout le village sortit accompagner la jeune fille comme il était de coutume. Les berges étaient plus animées que les foires d’Orient et plus bruyantes que les jours de fête.
Après avoir prononcé les paroles rituelles, un sinistre silence envahit la foule. La jeune fille, richement parée, suivit le jeune homme dans l’eau. Lorsque, pour la dernière fois, elle souleva son voile afin de jeter un ultime regard vers la foule, les cris et les lamentations fusèrent de partout mais cessèrent aussitôt lorsque la demoiselle apparut simultanément en trois personnes semblables. Nul ne sut dire laquelle était la jeune fille offerte en sacrifice. Les trois créatures marchaient côte à côte et bientôt le monstre émergea. La jeune fille, pensant vivre un rêve, ne commandait plus ses sens. Le monstre, lui non plus, ne comprit rien mais ouvrit la gueule. À ce moment-là, l’une des trois jeunes filles sauta entre ses dents et le colosse se mit à brûler. La foule, sur la berge, se sauva à la vitesse de l’éclair. L’eau se mit à bouillir et le jeune homme redevint lui-même. Il chargea sur ses épaules la demoiselle et sortit de l’eau. Le monstre se consuma. La jeune fille pleura d’amour et de joie.
Ainsi prit fin l’énigme du monstre du lac. La diablesse s’était transformée en jeune fille, la jeune fille en feu d’enfer et le monstre en cendre. Le jeune homme avait emporté sa protégée au pays de ses rêves.
Le soir, si vous passez près du lac, vous entendrez le dernier soupir du monstre, vous verrez la lueur de ses cendres incandescentes et vous entendrez les pas du dernier sacrifié amené en ces lieux.
La femme infidèle, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Il était une fois, un couple, heureux couple, bon foyer, bon ménage. Mais, comme rien n’est parfait en ce bas monde, la femme, bonne épouse et bonne ménagère, tomba dans le piège des belles femmes, celui de se laisser convoiter par d’autres hommes.
Dans la société africaine, le principal intéressé par un événement est souvent l’un des derniers à le connaître. Ainsi, un jour, arriva aux oreilles du mari que sa femme avait des pratiques déshonorantes. Alors, il lui tendit un piège. En rentrant à la maison, il lui dit :
— Je dois partir d’urgence en voyage et ne reviendrai que dans quelques jours.
Certaine de se divertir librement, la femme informa rapidement ses amis. Elle mit ses plus beaux vêtements et fit tous les préparatifs nécessaires pour un accueil décent. Malheureusement pour elle, le mari revint rapidement à la maison, prétextant l’annulation de son voyage.
La femme chercha en vain un moyen de sortir, mais de toutes façons, il était trop tard pour se racheter.
Soudain, le second amant s’annonça avec un éclat de joie, mais grande fut sa surprise de trouver le mari de la femme assis à son côté. Au bord de la panique, il scruta la maison et prétexta qu’il avait été envoyé par une femme pour chercher le grand chaudron posé là. Cependant, il ignorait que le premier amant qui s’était présenté, s’y était caché précipitamment lors de l’irruption du mari. En emportant l’énorme et pesant chaudron fermé, son cou se tordit sous le fardeau. Il marcha péniblement jusque dans la rue en se plaignant sous la douleur. Il dit :
— Ô mon Dieu, quelle chance mais quelle mésaventure !
Puis il laissa tomber le chaudron d’où sortit le premier amant qui, avant de prendre ses jambes à son cou lui lança :
— Tu parles d’une chance et d’une mésaventure !...
La jeune fille et le taureau, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Par un jour de soleil torride, naquirent dans la cour d’un éleveur peul, un veau mâle et une jeune fille choyée. Curieuse coïncidence et joie intense pour une telle famille que le petit animal dans l’enclos et l’enfant dans la case.
Les longues journées et les ténébreuses soirées voyaient les petits grandir et animer la cour. Bientôt, ils trottinèrent et coururent l’un après l’autre, renversant les ustensiles et réveillant les dormeurs. Les deux compagnons étaient devenus tellement familiers, que jamais ils ne se séparaient.
Le petit veau devenait peu à peu taureau et la petite fille commençait à voir ses seins pousser. L’animal eut bien du mal à parcourir les pâturages loin de son amie et celle-ci voulut devenir bergère pour l’accompagner. Mais hélas, l’amitié d’un humain et d’un animal ne peut durer éternellement.
La petite Peule était belle, plus belle que les fleurs de nénuphar. Ses yeux ternissaient l’éclat de la lune, ses cheveux descendaient au-delà de ses hanches. Le taureau était puissant et majestueux, ses cornes défiaient les arbres, sa robe dissuadait le tigre, sa nuque effrayait le lion.
À la lisière du hameau, dans les bois touffus, vivait un jeune génie avec sa famille. Un jour, une tornade s’abattit sur la plaine et les eaux encerclèrent à moitié le hameau. Les troupeaux vinrent s’abreuver à côté des enclos. Sur les ordres de son père, la belle Peule sortit chercher quelques braises tandis que les bergers restaient dans leur case. Tout était humide. Nulle part la moindre flamme, nulle part la moindre fumée. Comme elle revint les mains vides, le vieux Peul la jeta dehors pour la punir. Alors, la belle aperçut un feu de camp à l’orée des bois, s’en approcha, mais lorsqu’elle voulut se servir, le jeune génie, qui se réchauffait là, fut foudroyé par cette merveilleuse créature et l’emporta dans sa caverne.
Depuis ce jour, la tristesse et la mélancolie s’étaient installées dans le cœur des habitants du hameau.
Les battues, les appels et les recherches étaient restés vains. La belle Peule était introuvable. L’espoir s’envola et l’oubli s’empara peu à peu des esprits. Le taureau se languissait. Plus de sel, plus de son, plus de caresses pour lui.
Un jour, parmi les centaines d’animaux de l’éleveur peul, le taureau alla s’abreuver là-bas, près de la lisière des bois. Alors, il aperçut dans le creux d’un tronc d’arbre, sa maîtresse disparue. Aucun œil humain n’aurait pu la voir. Il lança des meuglements sourds et infinis, creusa le sol de ses sabots puissants, traîna son museau dans la poussière.
La jeune Peule lança alors à son ami le taureau :
Taureau de mes pères et mères
Veau de mes journées d’enfance
Taureau de mes années de charme
Guerrier impuissant devant la capture de sa citadelle
Lorsque tu rentreras dans l’enclos
À papa et maman
Tu transmettras mes salutations.
Chaque jour, ce même scénario se répéta et le berger se lassa d’arracher le taureau des branchages du repère de la belle Peule enlevée par le génie. Il en parla au vieux Peul. Celui-ci, curieux par nature, vint à la rencontre du troupeau près de l’abreuvoir. Vaches et veaux se précipitèrent dans l’eau. Alors il emboîta le pas au taureau entre les branchages. La scène commença comme à l’accoutumée, mais cette fois, la jeune fille peule vit son père. Elle se débattit avec une telle rage, que ses ravisseurs ne purent l’empêcher de s’échapper et de se réfugier dans les bras paternels, qui l’emportèrent en hâte au hameau.
« L’amour des animaux sauve souvent celui des humains. »
Le chat et les souris, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Il était une fois, un chat et sa fidèle société des souris. Le chat était le chef incontesté de la communauté. C’était également lui qui tranchait les litiges, infligeait les corrections ou bien tordait le cou à certains pour emplir son assiette. Jusqu’au jour où le grand chef partit en pèlerinage. Alors les souris jouèrent sans cesse et sans crainte, veillèrent au clair de lune et quelquefois, lorsque l’intensité de leur joie leur tournait la tête, l’une d’elle se permettait une mauvaise plaisanterie en criant « au chat ! ». Alors tout le monde s’empressait de regagner son trou et ressortait aussitôt que l’alerte s’avérait fausse.
Un soir, tout le monde était aux anges, on sautait, on criait, on dansait, on battait des mains, les tambourinaires jouaient et personne ne pensait plus au chat qui arrivait, tout content de retrouver les siens. Bientôt, on le vit danser au milieu de la foule entre les souris envoûtées. Mais, petit à petit, ceux qui revenaient à eux, s’éclipsaient à la vue du chat qui se retrouva tout seul.
Le lendemain, le grand chef chargea le crieur public d’informer ses sujets, de la grande réunion qui se tiendrait dans sa cour. Aussitôt les souris se réunirent pour une mise au point avant la grande assemblée. Les sages s’accordèrent pour admettre que le véritable caractère de l’homme ne peut jamais le quitter, malgré le grain de confiance que l’on peut parfois lui accorder, aussi, valait-il mieux prévoir le pire.
Ainsi, chaque souris construisit un souterrain jusqu’à la cour du grand manitou et en dissimula l’issue par sa peau de prière. Lorsque la cour fut comble, le chat fit verrouiller en secret toutes les issues, puis il tint conseil :
— Maintenant, écoutez-moi bien. Il se passe ici un certain nombre de choses qui doivent prendre fin. Il y a des imbéciles toujours prêts à dérober les mies de pain et les morceaux de sucre d’autrui, d’autres toujours prêts à déranger le sommeil de leurs voisins par leurs bruits intempestifs dans nos plafonds et nos magasins de cuisine.
Les souris répliquèrent alors :
— Eh bien oui, il y a également des imbéciles toujours prêts à se coucher sur les litières avant leur propriétaire, d’autres toujours en train de se frotter et de laisser leurs poils dans les écuelles de lait et d’autres enfin toujours prêts à empêcher autrui de se distraire.
Le chat se sentit visé. Alors, certain d’avoir trouvé le prétexte pour festoyer, il bondit pour croquer les souris, mais toutes disparurent en un clin d’œil dans leur souterrain de secours.
Vaincu, le chat comprit enfin que les souris n’étaient pas aussi naïves qu’il le pensait.
Le cultivateur et le lièvre, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Il était une fois, un cultivateur et un lièvre. Chaque jour, quand le cultivateur revenait dans son champ, il trouvait que ses plantes et ses fruits avaient servi de repas à un oisif. Il se creusa la cervelle afin de trouver un piège car tous ceux qu’il avait tendus jusqu’alors étaient restés inefficaces.
Un jour, il vint voir une vieille femme du village qui lui conseilla de confectionner un épouvantail en gomme arabique représentant un garçon et à le planter quelque part dans le champ, ce qu’il n’eut aucune peine à faire.
Comme à son habitude, le lièvre arriva sur le lieu habituel de ses exactions. Il fut effrayé et surpris par ce garçon. Il s’en approcha néanmoins pour le chasser de là et se régaler. Toutes ses grimaces restèrent vaines. Il s’approcha alors, nerveux, pour corriger ce garçonnet arrogant et lui lança :
— Hors du champ de mon père avant que je ne t’inflige ce que les enfants de ton espèce méritent.
Il sauta et frappa la figure du garçonnet, mais il ne put retirer ses cinq doigts. Une nouvelle fois, il tenta de gifler son adversaire et l’autre main s’immobilisa. Il essaya en vain de se dégager en répétant sans cesse :
— Gare à toi, mes jambes sont plus redoutables que mes mains et mon ventre beaucoup plus encore que mes jambes.
Ainsi, le pauvre voleur se retrouva-t-il complètement collé contre la gomme arabique.
Le lendemain, le cultivateur tout triomphant, vint trouver son captif qui criait au garçonnet :
— Mon père arrive, lâche-moi, sinon il va te découper en menus morceaux.
Le cultivateur attrapa le lièvre par les oreilles et se dirigea vers la rivière. Mais le lièvre murmura :
— Oui, dans l’eau, cela me fera du bien, je suis resté trop longtemps sous le chaud soleil par la faute de ce misérable garçonnet. Mais de grâce, pas entre ces épines qui me transformeraient en tamis !
Le cultivateur, qui voulait punir le lièvre, le jeta dans les épines. Alors, avant de s’enfuir, le malicieux animal se retourna et se moqua de l’homme qui écumait de rage :
— Tu viens de rater une belle occasion de me châtier !
Le lièvre et l’hyène font du jardinage, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Il était une fois, un lièvre et une hyène qui cultivaient le même potager. Ils y travaillaient ardemment et eurent bientôt de belles plantes fleurissantes. Chaque jour, le lièvre se méfiant de la gourmandise de l’hyène, proposait de faire le partage des plants afin que chacun sache ce qui lui revenait dans le potager. Mais l’hyène, ne voulant pas choisir, refusait toujours.
Le potager mûrissait peu à peu et l’odeur des fruits commençait à parfumer l’atmosphère. Chaque jour, l’hyène comptait les fruits mûrs, ceux encore verts et même les fleurs. La nuit, elle revenait pour cueillir les fruits en cachette et le lendemain, disputait le lièvre.
Une nuit, le lièvre se cacha dans le potager, et quand il vit l’hyène entreprendre sa récolte, il sortit de sa cachette et en fit autant. L’hyène, surprise et éhontée, ne put rien lui reprocher. Mais soudain, elle vint heurter le lièvre qui laissa tomber ses fruits et il s’exclama :
— Alors voyou, tu me bouscules pour t’emparer de mes fruits, toi qui n’a rien voulu faire au moment des semailles !
L’hyène attrapa le lièvre par les oreilles et se mit à le battre.
Celui-ci cria, mais personne ne vint à son secours. Pour finir, elle le mit dans un vieux panier et le balança derrière la haie.
Le pauvre lièvre se mit à pleurer, à pleurer encore, lorsque le lion, qui passait par là, entendit ses cris. Il chercha et trouva le lièvre enfermé dans le vieux panier au pied de la haie. Il s’en approcha et lui demanda :
— Pourquoi pleures-tu ? Qui t’a mis dans cet état ?
Le lièvre répondit :
— C’est l’hyène, à cause de quelques fruits que j’ai cueillis dans le champ commun.
Alors, le lion délivra le lièvre qui se hissa en haut d’un arbre. Celui-ci se mit à proférer des injures à l’hyène :
— Sotte, vaurien, paresseuse, je suis prêt maintenant, tu peux venir, je te ferai manger ton crottin !
Alors l’hyène, furieuse, arriva au galop près de l’arbre où se tenait le lion qui lui dit :
— C’est toi que je recherche.
Alors l’hyène rebroussa chemin, laissant derrière elle le champ libre au lièvre de faire seul la moisson.
Le lièvre et l’hyène vendent leur mère, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Un jour, l’hyène et le lièvre décidèrent d’aller vendre leur propre mère afin d’avoir à manger, car ils avaient bravé en vain tous les recoins de la forêt sans y trouver de nourriture. L’hyène, toujours aussi sotte, avait passé la nuit à fabriquer une belle corde tandis que le lièvre, qui ne manque jamais d’un tour dans son sac, se contenta d’un vieux cordage peu solide.
Ainsi, le lièvre confia-t-il à sa vieille mère, sur le chemin de la boucherie :
— Tu t’appliqueras à tirer sur la corde et à prendre la clef des champs.
Et voilà nos deux compères sur le chemin du marché. L’hyène tirait sur sa solide corde, traînant sa vieille mère de toutes ses forces, tandis que le lièvre avançait par bonds réguliers, accompagnant docilement la sienne. Ne se doutant de rien, l’hyène ne cessait de s’exclamer :
— Avance vieille crapule, avance tête de bonne à rien !
À mi-chemin, le lièvre s’écria :
— À l’aide, elle s’est échappée !
Comme convenu, la vieille mère lièvre venait de disparaître parmi les herbes. Le fils malicieux se mit à courir et à pleurer quand l’hyène l’appela. Elle lui dit :
— Ne t’en fais pas, aide-moi à traîner cette crapule au marché, elle n’est pas trop vieille tu sais, elle pourra nous procurer suffisamment de quoi nous nourrir.
Ainsi dit, ainsi fut fait.
L’hyène présenta sa vieille mère à un berger qui cherchait de la peau d’hyène pour se faire une cape. Il leur proposa en échange un bœuf dans son enclos. L’hyène s’y présenta, observant tour à tour chaque bête. Elle fit tellement de tours qu’elle y trouva enfin, dans un recoin, la plus vieille vache. Son museau et ses narines laissaient couler un liquide gluant et clair. Elle s’exclama :
— Ah, voilà ce que je veux. Elle est tellement grasse que ça lui sort par les narines. Rien qu’à la voir, j’en ai l’eau à la bouche !
L’échange fut fait et nos deux compères emmenèrent leur vache. Ils arrivèrent dans une clairière et y creusèrent une fosse. Tour à tour, ils allaient chercher du bois mort et s’affairaient à cuire leur viande. L’hyène, tellement gourmande, s’impatientait déjà. Le lièvre lui proposa alors d’aller chercher une bûche qu’elle avait oubliée plus loin. L’hyène s’empressa tel un éclair et s’éloigna toujours plus pour chercher l’objet de sa quête. Pendant ce temps, le lièvre s’était occupé de la viande et en avait mangé une grande partie. L’hyène revint en boitillant, chargée de son fagot de bois et, ne se donnant même pas le temps de poser sa charge, s’exclama :
— Tu as osé manger de ma viande en mon absence !
Le lièvre répondit :
— Attends que je t’explique, ce n’est pas moi, c’est le lion qui est passé par ici et a mangé de notre viande.
— Mais où sont ses traces ? Tu vas me le payer petit filou, tu vas me le payer, rétorqua l’hyène furieuse.
Alors, elle attacha solidement le lièvre et mangea goulûment sa vache. À la fin du repas, elle emmena son prisonnier chercher des piques à brochettes afin qu’il compensât, par sa propre chair, son insuffisance de viande. Elle le poussa contre un arbre et lui donna une hache afin qu’il les taillât. Le lièvre, ne manquant jamais d’un tour dans son sac, s’arrêta de couper et, prêtant l’oreille, s’écria :
— Je te réponds, vas-y !
L’hyène furieuse le somma de continuer son travail, mais le lièvre lui dit :
— Le lion me demandait si par hasard, je ne t’avais pas vue.
L’hyène répondit :
— Je ne suis pas là et tu ne m’as jamais vue !
Du haut de l’arbre, le lièvre s’écria :
— Oui, elle est là sous moi, d’ailleurs je coupe des piques à brochettes pour elle.
Sur ces mots, l’hyène prit ses pattes à son cou et le lièvre s’en retourna bondissant, fier de son exploit.
Le lièvre, l’hyène et le chasseur, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Un jour, le lièvre se promenait dans les bois. Il bondissait, sautillait, se terrait entre les herbes et les buissons. Mais, dans les branchages, le chasseur était aux aguets. Il se faufilait en retenant son souffle, évitait de marcher sur les feuilles mortes craquant sous ses pieds. Tout à coup, le lièvre vit un appât de chasseur, mais il continua son jeu, faisant mine de l’ignorer et dit :
— Ah quelle abondance, je m’en vais dire à tous les miens que dans la clairière il y a de quoi nous régaler !
Et il partit en bondissant. Dans les branchages, le chasseur attendit et attendit encore. Plus loin, le lièvre croisa l’hyène qui cherchait de quoi manger :
— Eh voyou, petit lièvre, toi qui est partout, n’as-tu pas vu quelque cadavre de bonne chair par-là ?
Le lièvre répondit :
— Si si, j’en ai vu.
— Alors viens me le montrer, rétorqua l’hyène.
Le lièvre s’arrêta à l’écart et montra du doigt l’appât. L’hyène, aussi sotte que gourmande, avait à peine allongé le museau qu’une flèche vint à se planter au milieu du leurre.
Comme d’habitude, elle lança un grand jet d’excréments et se sauva.
Le lièvre était déjà bien loin mais l’hyène le poursuivit à toute vitesse. Elle l’attrapa bientôt par la queue mais celle-ci lui resta entre les mains et le lièvre s’échappa. Elle continua cependant sa course effrénée.
Le lièvre, à bout de souffle, atteignit enfin un groupe de congénères qui jouait là. Il leur cria :
— Regardez-moi ! Plus de queue, a dit le lion, plus de queue pour les lièvres !
Ainsi tous les lièvres se débarrassèrent de cet attribut. Quand l’hyène arriva, elle trouva tout un troupeau de lièvres sans queue. Le fugitif s’écria alors :
— Sire le roi veut se faire un collier en queues de lièvres. Je lui ai dit que la mienne était restée avec toi. Aussitôt, l’hyène disparut des lieux et le lièvre lui courut après en disant :
— Le lion est devant toi, non, derrière, pas par là...
Ainsi, il fit courir l’hyène dans tous les sens, de sorte qu’elle tomba raide morte.
Le lion, l’hyène et le lièvre, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Le lion, maître des buissons, redoutable chasseur qui jamais ne traîne sa proie, qui jamais ne dévore les restes et les cadavres qui ne sont de son fait, est le roi dans la société des animaux. L’hyène, sotte et boitillante et le lièvre, rusé et malin, sont des sujets du maître.
Un jour, le roi lion chargea l’hyène et le lièvre d’engranger son énorme récolte d’arachides. Ils transportèrent des sacs à n’en plus finir. Le lièvre, toujours rusé, cherchant le moyen de croquer cette arachide fraîche et délicieuse, trouva une belle perspective. Il se mit à grimacer et dit à l’hyène :
— Je vais faire mes besoins et je reviens.
Ainsi contourna-t-il le grenier, choisit le dernier sac d’arachides dans le rang et s’enfouit entre les graines. L’hyène, ayant fini de rentrer les sacs, alla trouver le roi pour toucher sa récompense.
En quelques jours, le lièvre était venu à bout des arachides du roi. Il ne restait dans les sacs que les coques, mais de l’extérieur tout paraissait normal.
Arriva un matin, où le lion voulut sortir quelques sacs d’arachides pour les vendre au singe. Il les trouva très légers et s’en étonna. Il les ouvrit un à un et constata qu’il n’y avait plus de graines dans les coques. Il fit alors rappeler l’hyène et l’interrogea. Elle répondit que les sacs étaient pleins d’arachides, comme sire le lion l’avait lui-même constaté le jour de la récolte. Le roi demanda où était passé le lièvre ce jour-là. Alors, l’hyène lui rapporta les faits.
Le lion comprit rapidement le tour que celui-ci n’avait pas manqué de lui jouer. Il découvrit d’ailleurs, dans le grenier, un trou débouchant sur l’extérieur, par lequel le lièvre s’était échappé. Le roi ordonna à l’hyène de lui ramener ce maudit animal afin de lui infliger une bonne correction. L’hyène, de peur de réveiller la colère du lion, ne manqua pas d’arguments pour lui ramener le lièvre. Elle alla le trouver et lui dit :
— Oh, quel beau temps aujourd’hui, allons jouer dans l’herbe au cavalier et au coursier.
Le lièvre, toujours rusé, émit une réserve. L’hyène devrait se précipiter la première lorsqu’ils arriveraient devant la cour du roi. Elle accepta et ils partirent jouer sur l’herbe tendre. Lorsque ce fut le tour de l’hyène de servir de monture, elle se précipita avec le lièvre jusque devant le lion. On le fit ligoter. Le roi ordonna de bouillir de l’eau et de la lui faire consommer. Le grand chaudron chauffait sur le foyer tandis que chacun vaquait à ses occupations, quand soudain, le lièvre se mit à crier :
— Non, je vous en supplie, c’est trop pour moi, je ne pourrai jamais manger ça tout seul !
L’hyène, qui passait par là, entendit les lamentations du lièvre et s’en approcha en disant :
— Qu’est-ce qui t’inquiète ?
Le lièvre répondit :
— Je dois manger seul ce plein chaudron de chair grasse de mouton.
Alors l’hyène s’empressa :
— Ce n’est pas un problème, si ce n’est que cela, je vais te remplacer.
L’hyène délivra alors le lièvre et se mit dans les cordes. Aussitôt, celui-ci disparut dans la nature. Quand on voulut le punir, on retrouva à sa place l’hyène et le lion s’écria :
— En voilà des preuves, vous étiez complices, alors faites-lui consommer l’eau bouillante.
— Non, s’écria l’hyène de toutes ses forces, je vais vous expliquer !
Mais personne ne l’écouta. Lorsque les bourreaux approchèrent l’eau, l’hyène arrosa tout le monde de ses excréments blancs et chauds, avant de s’élancer parmi les buissons à la recherche du lièvre.
Depuis ce jour, l’hyène court après le lièvre.
Le mariage du monstre de la brousse, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Il était une fois, une jeune fille d’une beauté légendaire. Devant l’admiration dont elle était l’objet, elle décida de se marier avec un homme qui ne porterait ni tache, ni cicatrice, ni bouton sur le corps.
Elle avait une mouche, fidèle servante, qui inspectait les hommes des diverses contrées se bousculant devant sa demeure. Tour à tour, la mouche observait les postulants jusque dans leurs parties les plus intimes et revenait vers sa maîtresse annoncer le verdict. Tous avaient au moins une petite tache quelque part. Ils repartaient alors, dépités.
Les jours et les lunes se succédèrent et la nouvelle parvint aux oreilles du monstre de la brousse. Celui-ci se lécha tout le corps, se rendit plus saint qu’un nouveau-né et se transforma en un jeune homme beau et vigoureux. Il vint trouver la belle et lui exprima son désir de l’épouser. Comme à son habitude, la jeune fille envoya sa mouche scruter les recoins de son étranger. L’insecte ne décela aucun défaut sur sa peau et revint confier la nouvelle à sa maîtresse qui accepta d’épouser l’homme sans tache.
On organisa de grandioses cérémonies et les noces durèrent plusieurs semaines. Tous mangèrent et burent à leur guise. Puis la fête prit fin. Le nouveau marié décida d’emmener sa femme dans son pays. Toute la tribu sortit alors pour les accompagner hors du village. Lorsque les villageois regagnèrent leur maison, le monstre de la brousse mit son cheval au galop. Les deux voyageurs traversèrent mares et rivières, contournèrent dunes et montagnes, pénétrèrent dans les forêts les plus éloignées. La belle jeune femme, qui ne reconnaissait ni les plaines, ni les forêts, perdit tous ses repères. Épuisés, les deux cavaliers s’arrêtèrent dans une vallée broussailleuse, à l’entrée d’un immense gouffre.
— C’est ici ma demeure ! gronda le monstre travesti.
La belle jeune femme, se sentant perdue, se résigna. Dans le gouffre, elle trouva tout, sauf ce qui lui était naturel.
Chaque jour, de bonne heure, le monstre quittait son antre pour ne revenir que le soir, avec sa pitance. Redoutable braconnier, il était le maître des lieux et son territoire se trouvait loin des excursions des hommes. Nul n’osait troubler sa tranquillité.
La belle femme, loin de sa famille et de toute vie humaine, commençait à prendre des habitudes sauvages, jusqu’au jour où les siens, inquiets et désolés, envoyèrent sa sœur cadette à sa recherche. Celle-ci alla trouver le vieux féticheur du village qui lui donna son petit oiseau noir.
Ce dernier survola la terre et les eaux et revint dans sa cage le troisième jour. La sœur cadette et l’oiseau noir s’engouffrèrent alors dans la forêt, à travers les sentiers tortueux, dans les marécages où jamais l’eau ne tarit. Le matin du troisième jour, ils se retrouvèrent devant le gouffre du monstre de la brousse.
La belle jeune femme qui vivait là sentit une odeur humaine et s’empressa de sortir. À la vue de sa sœur, elle fondit en larmes. Ensemble, ils descendirent dans la demeure. La femme du monstre raconta à sa sœur ses tristes aventures et lui décrivit les pouvoirs maléfiques de son mari :
— Lorsque le retour du monstre s’annoncera, les signes ne tromperont pas. Sur la vallée tombera un brouillard qui assombrira le paysage et le tonnerre grondera. Des tourbillons violents balaieront son passage et des éclairs éclateront dans sa direction. Et il en sera ainsi chaque jour que Dieu créera.
Enfin, la belle jeune femme expliqua à sa sœur qu’elle devait la cacher afin que le monstre, qui fait disparaître toute vie humaine traversant son territoire, ne puisse lui nuire.
Ainsi dit, ainsi fut fait.
L’heure du retour s’annonçait et les phénomènes habituels se manifestèrent. Le monstre arriva avec sa pitance au bord du gouffre. Lorsqu’il y pénétra, il renifla violemment et s’exclama :
— Je sens une odeur humaine, je sens un corps étranger, je sens la chair tendre !
La femme rétorqua :
— Tu as enfin décidé de mon sort. Tu as enfin décidé de me dévorer. Alors vas-y ! Qu’attends-tu ? Vas-y !
Alors, le monstre alla s’étaler sur sa couchette, désolé mais tout de même soupçonneux. Le lendemain, lorsqu’il repartit à la recherche de sa pitance, la jeune femme sortit sa sœur de sa cachette et les deux femmes décidèrent de fuir le joug du démon. Elles coururent sans répit toute la journée. Dès leur départ, elles avaient lâché le petit oiseau noir afin qu’il avisât leur famille. Celle-ci ne tarda pas à venir à leur rencontre, à cheval et en armes.
Lorsque le monstre revint, le soir, il entra dans une colère sans précédent. Il engagea alors une course effrénée contre ses fugitives. Mais lorsqu’il les aperçut, les chevaux de la tribu s’intercalaient déjà entre lui et les deux femmes. Il se sentit contraint à renoncer. Il gronda et fit trembler ciel et terre, enflamma les herbes du feu de son regard. Mais il rebroussa chemin, vaincu.
Le poisson d’or, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Il était une fois un pêcheur, vieil homme misérable, qui chaque jour faisait le tour des points d’eau afin de trouver de quoi composer son repas quotidien. Certes cet homme était pauvre, mais ô combien courageux.
Un jour, l’homme faisait le tour des points d’eau, lançant sa ligne dans tous les endroits qu’il connaissait, mais en vain. Après que la lassitude l’eût gagné, il décida, au bout de l’effort, de plier sa ligne et de rentrer. Mais il se dit soudain qu’il devait essayer une dernière fois. Il lança alors sa ligne à l’eau. Tout à coup, il vit son flotteur vibrer. Il tira sur le fil et au bout de celui-ci, était accroché un grand poisson à la queue dorée qui se débattait, un poisson comme il n’en avait jamais vu.
Fier de sa prise, il décida d’emmener sa prise chez le roi qui l’achèterait certainement à un prix très intéressant. Il se présenta à la porte de son palais et demanda à entrer pour lui présenter sa trouvaille. Mais le portier, qui avait toujours été discourtois avec les pauvres gens, lui demanda de voir le poisson. À son tour, il crut rêver. Il retira au pêcheur son trésor et alla le présenter au roi. Celui-ci, très heureux, lui donna une forte récompense et le félicita. Il s’en retourna à la porte mais ne donna au pauvre pêcheur, aucune des pièces d’or qu’il avait reçues et l’envoya promener.
Dans les cuisines royales, la cuisinière s’occupa en personne du poisson à la chair dorée et aux écailles éclatantes comme l’or pur.
On le fit frire avec des épices d’Orient et on l’apporta à la princesse, friande de poisson, qui s’en délecta.
Mais le lendemain, elle se sentit mal, très mal, au point que les guerriers qui s’affairaient autour d’elle, n’étaient guère confiants. Elle souffrait de plus en plus quand le roi, se rappelant du poisson de la veille, fit venir le portier. Il lui dit :
— Ma fille souffre de coliques et c’est toi, qui hier m’a apporté ce poisson hors du commun. Tu es donc responsable de ce qui arrive à ma princesse.
Le portier désemparé s’écria :
— Non, ce n’est pas ma faute, je vais vous ramener ce maudit pêcheur qui me l’a apporté ici.
Ainsi on ramena le vieil homme.
Le roi lui fit part de ce qui se passait et le somma de soigner au plus vite sa fille. Il accepta, mais dit ceci :
— Seul le cœur de celui qui a apporté le poisson de ses mains jusqu’au roi pourra guérir les maux de ventre de la princesse.
Instantanément, les gardes immobilisèrent le portier qui, dans un mouvement désespéré, tenta d’échapper à son sort. Il supplia le vieil homme et lui remit aussitôt toutes les pièces d’or que lui avait donné le roi, en récompense. Le portier devait être sacrifié pour la santé de la princesse quand, miraculeusement et instantanément, elle recouvra la santé. Elle vint alors trouver le portier qui criait et se débattait. On le libéra et il n’oublia jamais cette leçon.
Le secret dévoilé, par Touré Seydou M’Barakou. Tombouctou
Les Zarma et les Songhay ont toujours vécu dans l’empire comme deux tribus ennemies. Les premiers étaient des commerçants, fervents musulmans et les seconds des guerriers féticheurs conquérants, mais les uns et les autres partageaient l’art de la guerre qu’ils se livraient fréquemment. Cependant, les Songhay possédaient un puissant secret du combat leur permettant de vaincre à chaque fois.
Le roi songhay avait une fille unique à laquelle il enseigna tout, y compris le grand secret du royaume. Le prince héritier zarma, n’ayant d’yeux que pour cette princesse, finit après moult efforts à obtenir sa main. Malgré cela, les deux royaumes ne purent mettre un terme définitif à leurs habituelles querelles. Les Zarma, bien que toujours vaincus, ne cessèrent d’opposer à leur adversaire une résistance constante et farouche, qui jamais ne leur ôta la défaite.
Les deux royaumes vécurent longtemps ainsi, jusqu’au jour où la princesse, qui avait eu deux enfants, les vit partir à la tête de leurs troupes, condamnés à les conduire en croisade contre les Songhay qui n’avaient jamais baissé le glaive.
Entre la vie de ses enfants et le serment de ne point violer le secret paternel, entre le renom des princes et la supériorité des siens, la princesse songhay dévoila à ses enfants le grand secret des vainqueurs.
Les deux princes disposèrent leurs troupes sur les hauteurs de la vallée séparant les territoires et leur recommandèrent de ne tirer leurs flèches qu’en direction du ciel et jamais sur les guerriers songhay. Les ordres tombèrent dans les oreilles des combattants comme une alerte au retrait.
Ainsi dit, ainsi fut fait.
Les flèches tirées en l’air retombaient sur la tête des ennemis et pour la première fois, les Zarma prirent le dessus sur les Songhay, surpris et désemparés par leur défaite. De retour au palais, les deux princes zarma s’agenouillèrent devant leur mère qui les avait sauvés.
Ce jour servit de leçon au grand roi songhay qui décréta dans son royaume, que plus jamais un secret ne soit confié à une femme, fut-elle princesse héritière.