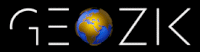© Michelle Brière 2000-2024.
Viêt Nam - Parole d'ancêtre Viêt 3/3
SOMMAIRE
Satire de la nature humaine (suite)
. L’argent des immortels
. L’âme de Trương Ba dans le corps du boucher
. Mais il a deux fois raison
. Le témoin
. Flatteries
. Je suis tellement heureux !
. Un choix difficile
. Le serviteur avisé
. Cuội le menteur
. Pâtés de soja
. Le bambou à cent entre-nœuds
Contes satiriques de Trạng Quỳnh
. Les dieux roulés par Trạng Quỳnh
. Le chat du roi et le chat du peuple
. Les pêches de la longévité
. Tentative d’empoisonnement du roi
Le diable et les rois des enfers
. L’arbre nêu du Tết
. La vertu récompensée
. Tentation
. Méprise
. Toutes les places sont prises
. Les trois barbus parlant vietnamien
. Trạng Quỳnh, peintre de génie
Satire de la nature humaine (suite)
L’argent des immortels
Deux fieffés menteurs vont prendre un bain ensemble. L’un, voulant éblouir l’autre, emporte sur lui une demi-ligature de sapèques et plonge dans l’eau. Lorsqu’il refait surface, il présente les sapèques et dit :
— J’ai nagé sous l’eau et rencontré deux immortels en train de jouer aux échecs. J’ai voulu rester voir la partie. Ils m’ont donné de l’argent en me disant de m’en aller. Bien content, je suis revenu ici.
L’autre décide de l’avoir à son tour. Il fait semblant de croire et demande :
— Tiens donc, je vais aller voir, avec un peu de chance, je vais pouvoir récupérer encore un peu d’argent !
À ces paroles, il plonge. Un moment après, il réapparaît :
— J’ai rencontré comme toi les joueurs d’échecs. Je me suis approché doucement, dans l’intention de demander de l’argent mais ils m’ont réprimandé en disant : « Celui qui vient de descendre a déjà reçu une demi-ligature qu’il devait partager. À quoi sert-il de descendre encore nous déranger ? »
L’âme de Trương Ba dans le corps du boucher
Il était une fois, un jeune homme du nom de Trương Ba qui était passé maître au jeu d’échecs. Il battait tous ses adversaires et remportait tous les prix lors des festivités printanières. Sa réputation franchissait les frontières du pays. À la même époque, se trouvait en Chine un excellent joueur d’échecs qui portait le nom de Kỳ Như. Ayant entendu parler de Trương Ba, Kỳ Như se rendit au pays du Sud et vint le défier lors d’un tournoi. Pendant un long moment, les forces furent égales puis, par une manœuvre habile, Trương Ba accula son rival dans une impasse. Pendant que ce dernier réfléchissait pour s’en sortir, Trương Ba dit fièrement :
— Même si Đế Thích[1] descendait du ciel, il n’arriverait pas à s’en tirer.
Lorsque ce dernier entendit ces paroles, il décida de descendre sur terre pour donner une leçon à l’orgueilleux. Transformé en vieillard, il vint se placer auprès de l’échiquier. Ses suggestions permirent à Kỳ Như de renverser la situation. De vaincu, il devint vainqueur. La présence du vieillard déplaisait à Trương Ba, mais ce vieil homme à l’allure majestueuse, aux cheveux et à la barbe blancs comme la neige, ne pouvait être qu’un être surnaturel. Trương Ba le comprenant se jeta à ses pieds en disant :
— Vous êtes sans doute le dieu Đế Thích. L’humble mortel que je suis demande que vous lui pardonniez.
Le dieu des échecs lui dit sur un ton familier :
— Comme tu te vantes de ton talent, je suis simplement venu voir comment tu joues.
Trương Ba reçut le dieu des échecs de bonne grâce. Il acheta de l’alcool et tua une poule pour le régaler. Il lui fit bonne impression. Comme il lui demandait avec empressement d’être son disciple, Đế Thích lui dit :
— Je vois que tu es sincère. Prends ce paquet de bâtonnets d’encens, lorsque tu veux m’appeler, brûles-en un.
Ceci dit, il monta sur un nuage et retourna au ciel. Ensuite, Trương Ba invita de temps à autre Đế Thích à descendre faire ripaille chez lui. Une grande affection les liait.
Un beau jour, Trương Ba mourut de mort subite. Sa femme, en nettoyant l’autel du défunt, y trouva le paquet de baguettes d’encens et en brûla une. Dans le ciel, le dieu des échecs reconnut l’odeur de l’encens et descendit aussitôt sur terre. Ne trouvant pas Trương Ba, il demanda à sa femme :
— Où est ton mari ?
— Il est mort il y a un mois, répondit la veuve.
— Malheur ! Pourquoi ne pas m’avoir averti plus tôt ! s’écria Đế Thích.
Après quelques minutes de réflexion, il reprit :
— Y a-t-il quelqu’un qui vient de trépasser dans le village ?
— Oui, le boucher vient de mourir.
Đế Thích demanda à la femme de la conduire chez le mort. Il examina le cadavre puis, prenant la femme à part, il lui dit :
— J’essaierai de ressusciter ton mari…
Puis il disparut dans le ciel.
Dans la maison du boucher régnait une atmosphère funèbre. Près du cercueil, on pleurait, on criait, on s’arrachait les cheveux lorsque soudain, le mort se releva, rejeta son linceul et partit d’une traite à la maison de Trương Ba. La femme de Trương Ba, à la vue du boucher, comprit que son mari avait été ressuscité. Au même moment arrivèrent la femme et les enfants du mort. Une bruyante dispute éclata entre les deux femmes, l’une voulant ramener son mari, l’autre le tenir. Les gens du village étaient abasourdis. L’affaire fut portée à la connaissance du mandarin de la région. Une audience fut tenue. Tous les voisins questionnés affirmèrent que le mort ressuscité était bel et bien le boucher mais la femme de Trương Ba persistait à déclarer que c’était son mari. Le juge lui demanda :
— Quelle profession exerce votre mari ?
— Mon mari excelle dans le jeu d’échecs.
La même question fut adressée à la femme du boucher qui répondit :
— Mon mari est boucher.
Sur ce, le mandarin donna l’ordre d’apporter un cochon vivant dans la salle d’audience et dit au mort ressuscité de l’égorger, lequel ne sut pas le faire. Ensuite, il lui opposa quelques bons joueurs d’échecs qui furent tous battus. Alors, il prononça sa sentence :
— Que le mort ressuscité retourne à la maison de Trượng Ba.
Depuis, on dit que l’âme de Trương Ba s’est incarnée dans le corps du boucher.
_____________
[1] Le dieu des échecs.
Mais il a deux fois raison
C’était un chef de village célèbre pour ses jugements dans les procès.
Un jour, Cái et Ngô se battirent et chacun mit l’autre en accusation. Cái versa au chef de village un pot-de-vin de cinq sapèques, tandis que Ngô lui offrit le double. Au procès, le chef dit :
— Cái, tu as frappé Ngô. Tu es condamné à dix coups de rotin.
Cái, lui montrant ses cinq doigts, lui dit à voix basse :
— Réfléchissez, Votre Honneur, le bon droit est pour moi !
Le chef, montrant alors ses deux mains, les doigts largement écartés, répondit :
— Je sais… mais lui a deux fois plus de bon droit que toi !
Le témoin
Un vieil usurier avait prêté trente ligatures de sapèques à un paysan miséreux. Avec les intérêts qui s’étaient amoncelés, il fut impossible au paysan de rembourser son redoutable créancier.
Un jour, l’usurier vint chez ce dernier réclamer son argent pour la énième fois. La maison était vide. Seul jouait dans la cour un petit enfant.
— Où sont tes parents ? demanda le richard.
Silence de l’enfant.
— Je te demande où sont tes parents ? Gare à toi si tu persistes à faire la forte tête !
L’enfant répondit alors avec une lenteur étudiée :
— Mon père est allé décapiter les plantes vivantes et en planter des mortes. Ma mère est partie faire commerce du vent !
L’usurier se creusa la cervelle sans comprendre un traître mot de la réponse de l’enfant. Il le supplia d’expliquer le sens de ses paroles.
— Si tu me le dis, je vous tiendrai quitte de la dette ! lâcha-t-il à la fin en guise d’appât.
Vous cherchez à me corrompre, Monsieur !
— Mais non, parole d’honneur !
— Qui sera témoin de votre promesse ?
— Le margouillat qui rampe sur le rebord de ce bol !
— Bon, va pour le margouillat ! Mon père est allé repiquer le riz et ma mère vendre des éventails.
Or, le vieux renard qui n’avait pas plus l’intention de faire un cadeau au père que de tenir sa parole au fils, revint réclamer ses ligatures.
— Tu ne lui dois plus rien, papa, dit l’enfant. L’autre jour, il m’a fait solennellement remise de notre dette.
— Sacré menteur ! rugit l’usurier.
— J’ai un témoin, ne l’oubliez pas !
Le vieil avare s’en fut porter plainte.
— Je ne nie pas la dette, déclara le paysan au mandarin enquêteur, mais mon fils soutient formellement que monsieur l’usurier lui a donné sa parole de nous en tenir quittes.
On convoqua l’enfant qui raconta ce qui s’était passé.
— As-tu la preuve de ce que avances ? lui demanda le mandarin.
— J’ai un témoin !
— Amène-le ici, menteur ! ricana l’usurier.
Excellence, répondit l’enfant imperturbable, monsieur que voici a pris lui-même à témoin un margouillat qui rampait sur une colonne de la maison !
— Il ment, monsieur le mandarin, le margouillat était sur le bord d’un bol et non sur une colonne !
Le mandarin, qui savait apprécier l’esprit et cultivait l’équité, se mit à rire :
— Tu t’es trahi, usurier parjure, les coups de rotin que tu vas recevoir t’apprendront à respecter ta parole, même celle donnée à un enfant !
Flatteries
Un riche dit à un pauvre :
— J’ai des milliers d’onces d’or, pourquoi ne te montres-tu pas flatteur avec moi ?
— Toi, tu as de l’or, répondit le pauvre, qu’as-tu besoin de mes flatteries ?
— Si je te donne la moitié de mon or, le feras-tu ?
— Alors, je serai aussi riche que toi, pourquoi devrai-je te flatter ?
— Et si je te donne tout ?
— Alors c’est toi qui devra me flatter !
Je suis tellement heureux !
Un paysan glouton redoutait sa femme. Un jour où celle-ci était partie au marché, il prit des patates à la hâte pour les griller dans le foyer. Elles étaient tout juste cuites que sa femme entra. La voyant arriver à la porte de la cuisine, notre homme, éperdu, glissa rapidement une patate dans la bordure de son pantalon, mais celle-ci était tellement chaude qu’il ne pouvait tenir en place.
Il rentrait le ventre, se penchait d’un côté et de l’autre, sautait et ressautait en l’air pour échapper à la brûlure. Devant ce manège, sa femme pouffa de rire et lui demanda :
— Pourquoi sautilles-tu dans tous les sens ?
Le mari, grimaçant un sourire :
— C’est de te voir rentrer, je suis tellement heureux !
Un choix difficile
Il était une fois, un paysan marié et gourmand qui avait un enfant de trois ans. Un jour, il va à la rizière pour attraper des poissons. Rentré chez lui, il allume le feu et commence à les griller. À ce moment, son fils affamé se met à pleurer dans le giron de sa mère. Apercevant son mari en train de griller les poissons, celle-ci le console :
— Oh ! Regarde le poisson comme il tourne au jaune ! Calme-toi et papa t’en donnera.
Le petit se calme aussitôt mais notre homme se met en colère :
— Comment cela, jaune ? Ce n’est pas du safran !
Le petit se remet à pleurer. La mère le console à nouveau :
— Calme-toi ! Regarde le poisson comme il est gras. Calme-toi et papa t’en donnera.
Le petit se calme de nouveau. Notre homme se renfrogne :
— C’est du poisson, ce n’est pas de la viande, gras, il ne risque pas de l’être !
Le petit, de nouveau, éclate en sanglots. Sa mère tente de la consoler par tous les moyens mais rien n’y fait. Il ne lui reste plus qu’à montrer la brochette de poissons
— Regarde, calme-toi et papa te choisira un petit poisson.
Mais le mari s’écria :
— Tous les trois sont semblables, il n’y en a pas de petit !
Berceuse (ru con) septentrionale accompagnée du luth à manche long đàn đáy.
Interprètes : Phó Kim Đức (chant, cỗ phách), Nguyễn Văn Khuê (đàn đáy).
Lieu & date : Viêt Nam, vill. de Hanoi. 29 mars 1997.
Durée : 03:17. © Patrick Kersalé 1997-2024.
Le serviteur avisé
Un homme riche, chaque matin, prenait une tasse du meilleur alcool. Pour se préserver des voleurs, il engagea un serviteur dont la bêtise était, paraît-il, proverbiale.
Un jour, alors qu’il était sur le point de sortir, il l’appela :
— Veille avec soin sur le gigot suspendu à cette poutre et au chapon sur le perchoir. Quant à ces deux bouteilles, garde-toi d’y toucher, c’est de la mort-aux-rats.
Sur ce, il s’en alla. Aussitôt, le serviteur descendit le gigot, tua le chapon et mangea à satiété, arrosant son festin des deux flacons d’alcool.
Quand le maître rentra à la maison, notre homme était étendu sur le sol, endormi.
Le maître le secoua :
— Où sont donc le gigot, le chapon et l’alcool ?
— Maître, supplia le serviteur sortant de sa torpeur, j’ai veillé mais le chien et le chat ont profité d’un moment d’inattention pour dérober la viande. Alors, désespéré et craignant votre courroux, j’ai bu tout le poison. Hélas, je suis encore en vie !
Cuội le menteur
Il était une fois un petit gars qui portait le nom de Cuội. Orphelin dès l’enfance, il fut élevé et nourri par son oncle. Fieffé menteur, il prenait plaisir à abuser de la crédulité des gens, quand un certain nouveau riche voulut l’éprouver. Il le fit venir et lui dit :
— J’ai entendu dire que tu es habile à tromper autrui. Me voici bien campé dans mon siège. Si tu arrives à me faire sortir dans la cour, tu recevras cinq ligatures de sapèques.
Cuội se gratta l’oreille et dit :
— Prévenu que vous êtes, que puis-je faire ! Mais si vous sortez dans la cour, je pourrai vous faire rentrer dans la maison.
Ce que fit le nouveau riche. À peine fut-il dans la cour que Cuội battit des mains en s’écriant :
— Vous voilà pris à mon piège !
Le nouveau riche dut, à contrecœur, lui donner la somme promise.
L’oncle de Cuội possédait un superbe cochon. Un jour où il se trouvait seul à la maison, Cuội le vendit à vil prix à un boucher en se réservant la queue. Il creusa un petit trou tout près de la porcherie dans lequel il y planta cet attribut. Lorsque la tante fut de retour, il simula l’affolement et se répandit en lamentations :
— Catastrophe ! On nous a pris notre cochon, on nous a pris notre cochon, il est descendu en enfer !
Aussitôt, il conduisit sa tante à la porcherie, désigna la queue et ajouta :
— Regardez, ma tante ! Ses pattes de derrière sont déjà sous terre, mais il montre encore sa queue. Retenez-la bien et ayez soin de ne pas la tirer car elle se casserait. Je vais creuser la terre pour récupérer le cochon.
La bonne dame pressa son neveu de le faire. Cuội, alors, se mit à creuser la terre qui se réduisait en miettes, de sorte que la queue se détacha d’elle-même du trou. Le petit futé n’attendait que cela pour s’écrier :
— C’est trop tard ! Le cochon est parti en enfer, il n’y a plus rien à faire.
Un jour, Cuội allait au marché avec son oncle, un panier sous le bras. Soudain, il pressa le pas, dépassa ce dernier d’une bonne distance et retourna son cabas sur un tas de bouse de vache. Lorsque l’oncle arriva, il serrait entre ses bras le panier retourné. Il dit :
— Mon oncle, vous arrivez bien à propos. J’ai enfermé une tourterelle dans ce panier, mais si j’y introduis ma main, elle s’en échappera. Retournez à la maison et apportez-moi un filet qu’on tendra autour du panier pour l’attraper. On en fera un bon plat !
L’oncle, qui aimait la bonne cuisine, se hâta d’aller chercher le filet qui fut tendu aux quatre coins du panier. De nombreuses personnes se pressaient autour. Lorsqu’on ouvrit le panier... point de tourterelle, seulement un tas de bouse répugnante. Ce mauvais tour coûta cher au coquin ; son oncle lui asséna tant de coups de rotin qu’il était plus mort que vif.
Une autre fois, Cuội et son oncle travaillaient dans les champs sous un soleil de plomb. Comme l’oncle avait soif, il dit à Cuội de rentrer chercher de l’eau. Arrivé à la maison, le neveu fit une mine de déterré et dit à sa tante d’une voix étouffée :
— Ma tante, mon oncle est mort. Un taureau l’a encorné et étripé.
La nouvelle bouleversa la bonne femme qui se précipita vers le champ en poussant des cris de douleur. Cuội emprunta un raccourci et arriva avant elle. Il prit une tête d’enterrement et dit à son oncle :
— Le Ciel nous maudit ! Ma tante est tombée de l’étage et est morte sans que personne s’en aperçoive.
Le croyant sur parole, l’oncle se frappa la poitrine à coups de poing et se précipita sans plus tarder à la maison. Dans leur élan, aveuglés par la douleur, le mari et la femme se heurtèrent de plein fouet et s’affalèrent. Ils comprirent alors que le neveu leur avait encore joué un de ses mauvais tours et voulurent s’en débarrasser une fois pour toutes. Ils l’enfermèrent dans une cage de bambou que le mari porta au fleuve pour l’immerger.
Arrivés au bord de l’eau, Cuội supplia son oncle :
— Je reconnais ma faute et mérite la mort. Seulement, si j’ai pu survivre jusqu’à présent, c’est grâce à un manuel de mensonges qui se trouve sur l’étagère de la cuisine. Mon oncle, ayez la bonté de me l’apporter. Je l’emporterai dans l’enfer pour y gagner ma vie.
Ces paroles finirent par émouvoir l’oncle qui retourna volontiers à la maison pour chercher le bouquin, d’autant plus, pensa-t-il, que le neveu était bien enfermé dans la cage.
Recroquevillé dans sa prison de bambou, Cuội vit passer un mendiant lépreux. Il l’interpella :
— Eh ! toi, là-bas. J’avais comme toi la chair rongée par la lèpre. J’ai eu la chance d’être mis dans cette cage et plongé dans l’eau d’où je suis ressorti complètement guéri. Veux-tu bien essayer ?
Le lépreux se hâta de faire sortir Cuội et lui dit :
— J’ai de la chance, je vais m’y mettre à votre place. En guise de reconnaissance, je vous offre ces quelques ligatures de sapèques que des gens charitables m’ont données.
Le lépreux entra dans la cage, Cuội la ferma, prit l’argent et disparut.
Pendant ce temps, l’oncle fouillait l’étagère de la cuisine. Bien entendu, il ne trouva point de livre de mensonges. Irrité, il retourna au bord du fleuve et, d’un coup de pied, envoya au fond de l’eau et la cage et sa charge.
Cuội n’ayant pas envie de rentrer chez son oncle, il longea la rive du fleuve. Un moment, il s’arrêta, enleva ses vêtements et plongea. De peur d’être volé, il emporta avec lui la somme d’argent que le lépreux lui avait donnée. En passant sur le pont, un mandarin à cheval le vit s’agiter dans l’eau en tenant dans une main quelque chose qui lui semblait être des pièces de monnaie. L’homme cupide voulut s’en emparer. Il s’arrêta et éleva la voix :
— Eh petit ! Que fais-tu là ?
Feignant de chercher quelque chose, Cuội répondit :
— Mon père m’a donné un lingot d’or, un lingot d’argent et plusieurs ligatures de sapèques que je viens de laisser tomber dans le fleuve. Je n’ai trouvé que mes sapèques. Je crains fort qu’il ne me batte à mort.
Ce disant, il se mit à pleurer bruyamment. Le mandarin descendit de cheval, enleva ses vêtements et s’écria :
— Sors de là que je prenne un bain et file en vitesse !
Voulant rester seul pour chercher les précieux lingots, il entra dans l’eau. Mais sur la rive, Cuội enfila les vêtements du mandarin.
— Qu’est-ce que tu fabriques ? demanda l’officier du roi.
— J’ai froid, je me réchauffe.
— Quel est ton nom et d’où viens-tu ?
— Je m’appelle Bái Dưng[1], originaire de la commune de Nulle Part, district Sans Destination.
Il attendit que le mandarin eût disparu sous l’eau pour monter sur son cheval et filer au galop. L’homme cupide plongea pour trouver ce qu’il cherchait, mais en vain. Lorsqu’il revint sur la rive, il n’y trouva ni ses vêtements ni sa monture et se mit à maudire le menteur. Nu comme un ver, il dut mettre les guenilles laissées par le fuyard et s’élança à sa poursuite. À tous ceux qu’il rencontrait, il posait la même question : « Avez-vous vu un nommé Bái Dưng passer par ici ? », ce qui faisait rire les gens. Une femme le prit pour un méchant galant et le tança vertement. Et ce fut dans cet accoutrement qu’il regagna sa demeure.
Vêtu des beaux habits du mandarin, Cuội retourna à la maison de son oncle et de sa tante. Ceux-ci furent surpris, surtout le mari qui se demandait comment il avait pu survivre après le coup de pied qui l’avait envoyé au fond du fleuve. Cuội leur dit en souriant :
— Dans l’enfer, j’ai rencontré tout le monde : mon père, ma mère, mes grands-parents du côté paternel et maternel. Mes parents sont très riches. Comme vous me manquiez, je suis revenu vous voir.
Puis il ajouta :
— Mes grands-parents parlent souvent de vous et me chargent de vous inviter à descendre les voir.
— Mais comment ? s’empressèrent de demander les deux époux.
— Rien de plus facile. Faites deux cages de bambou semblables à celle que vous avez faite pour moi. Emportez-les au bord du fleuve et mettez-vous dedans, je m’occuperai du reste.
Et voilà l’oncle parti dans l’enfer. En voyant les bulles d’air qui s’élevaient à la surface de l’eau, Cuội battit des mains et s’écria :
— Ah ah ! Mon oncle a acquis une grosse fortune !
La tante pressa Cuội d’une voix impatiente :
— Vite, fais-moi descendre !
Ce qui fut fait.
Cuội devint l’héritier des biens de son oncle et sa tante. Mais comme il était grand dépensier, il dilapida en peu de temps tout cet héritage.
Un beau jour, il partit pour un long voyage. Chemin faisant, il arriva dans une région de forêts peuplée d’éléphants. Il lui vint l’idée d’en capturer un. Il creusa sur leur passage une fosse aussi large que profonde qu’il couvrit de cloisons en bambou tressé et d’un tapis d’herbes. Trois jours plus tard, l’un d’entre eux y tomba. Il combla la fosse, puis fit un trou dans l’arrière train de l’animal. Il se dit : « Dans quelques jours, j’aurai un éléphant volant pour voyager de par le monde ».
L’odeur de chair pourrie ne manqua pas d’attirer les rapaces qui, à travers le trou pratiqué par Cuội, pénétrèrent en grand nombre dans le corps de l’animal. En quelques jours, corbeaux, milans, vautours, vidèrent le corps de tout ce qui était mangeable. Il ne restait plus de l’animal que la peau. Alors Cuội boucha le trou, déterra l’éléphant, monta sur son dos et lui donna un petit coup de bâton sur le ventre. Alertés, les volatiles battirent des ailes et prirent leur envol, soulevant dans l’air et la peau et sa charge.
Vautré sur le dos de l’éléphant, Cuội survola les monts et les fleuves, contemplant à loisir le beau paysage qui défilait sous lui. Il arriva au-dessus d’une grande cité, riche en beaux édifices, débordant de gens et de véhicules. Curieux de la voir de plus près, il donna quelques tapes sur le dos de l’éléphant. De nouveau alertés, les oiseaux replièrent leurs ailes. La monture descendit lentement et vint atterrir dans la cour du palais royal où le roi était en train de donner une audience à ses sujets.
Lorsque ceux-ci aperçurent cet être descendu du ciel à dos d’éléphant, ils le prirent pour une divinité et tous se prosternèrent devant lui. Le roi en personne le conduisit dans son palais, le fit s’asseoir et se mit sur le côté.
Le pouvoir magique de l’éléphant émerveilla le souverain qui demanda à Cuội d’une voix hésitante :
— Pourriez-vous me faire monter sur le dos de votre animal ? Je voudrais bien voir mon pays du haut du ciel.
— Absolument… Mais, à deux conditions : tout d’abord, que nous échangions nos vêtements car l’animal est habitué à l’odeur de mon corps et ensuite que vous retiriez le bouchon de son derrière lorsque vous serez au-dessus de la mer afin qu’il puisse se désaltérer.
Les mandarins eurent beau détourner le roi de son projet aventureux, celui-ci n’en démordit point. Il fut emporté dans les airs. Arrivé au-dessus de la mer, il se rappela la recommandation de Cuội et enleva le bouchon, libérant le passage aux oiseaux enfermés dans le corps de l’éléphant. Comme un ballon dégonflé, la peau de l’animal se ratatina et tomba lourdement dans l’eau, emportant avec elle le pauvre roi crédule.
Vêtu du manteau royal, Cuội le Menteur monta sur le trône.
________________
[1] Lorsque les deux mots Bái Dưng deviennent Dái Bưng, ils prennent un sens très vulgaire à caractère sexuel : c’est ce qui faisait rire les passants.
Pâtés de soja
Le supérieur d’une pagode s’était enfermé pour manger à son aise de la viande de chien[1].
Le bonzillon, de la porte, lui demanda :
— Maître, qu’êtes-vous en train de manger ?
— Des pâtés de soja, lui répondit le bonze.
Sur ce, de furieux aboiements éclatèrent au dehors.
— Allez voir, dit le maître d’un ton autoritaire, qui fait un tel vacarme ?
Le bonzillon sortit et revint quelques instants après :
— Maître, ce sont les pâtés de soja du voisinage qui se battent avec les pâtés de soja de la pagode.
______________
[1] Selon les préceptes du bouddhisme, les bonzes ne doivent pas manger de viande.
Le bambou à cent entre-nœuds
Il était une fois un homme aussi riche que méchant. Tous les procédés lui étaient bons pour exploiter ses domestiques. Il avait ainsi accumulé la plus grande fortune de la région. Sa dernière fille n’était pas encore mariée. Khóai, un de ses domestiques sans famille le servait depuis l’enfance. Il venait d’avoir dix-huit ans. C’était un jeune homme courageux. Craignant qu’il ne le quitte, le maître le fit appeler et lui dit :
— Si tu n’épargnes pas ta peine et travailles du matin au soir, je t’accorderai la main de ma benjamine.
Khóai, aussi naïf que son maître était rusé, se mit au travail avec ardeur et vaqua trois années durant à toutes les tâches de la maison.
Út, la fille du maître, était devenue d’une grande beauté. Un chef de canton fort riche en demanda la main pour son fils. Le père, oubliant la promesse qu’il n’avait jamais eu l’intention de tenir, la lui accorda et on prépara aussitôt la cérémonie.
Se voyant berné, Khóai vint trouver son maître et lui reprocha de manquer à sa parole. Le maître eut envie de répondre à son domestique en lui donnant une bonne raclée, mais il se ravisa : « Khóai peut encore m’être utile » pensa-t-il et, une fois encore, il fit appel à la ruse.
— C’est vrai, je prépare le mariage de Út, mais si tu veux que pour toi il devienne une réalité, va dans la forêt et rapporte-moi un bambou à cent entre-nœuds. Nous en tirerons les plus belles baguettes du monde. Alors tu seras le mari de Út.
Khóai, naïf, le crut et partit dans la forêt. Il chercha, chercha, mais où découvrir un bambou à cent entre-nœuds ? Découragé, il se laissa tomber au pied d’un arbre et se mit à pleurer. Soudain, un vénérable vieillard lui apparut :
— Pourquoi pleures-tu mon enfant ? demanda-t-il.
Et Khóai lui raconta son histoire.
— Va couper des bambous ! Compte cent entre-nœuds et apporte-les moi !
Khóai alla, brandit sa cognée et revint bientôt avec les cent entre-nœuds demandés. Le vieil homme se pencha et murmura à voix basse :
— Joignez-vous tout de suite, joignez-vous tout de suite !
À peine ces mots étaient-ils prononcés que les cent tronçons de bambou laissés pêle-mêle sur le sol roulèrent les uns vers les autres et se rejoignirent, formant un immense bambou à cent entre-nœuds.
Khóai voulut se jeter aux pieds du vieillard pour le remercier mais le Bouddha, car c’était le Bouddha, avait déjà disparu. Alors il prit le bambou sur l’épaule pour l’emporter. Mais comment emporter un bambou d’une telle longueur à travers les fourrés. Il s’assit et pleura de nouveau. Alerté par ses pleurs, le vieillard lui apparut de nouveau :
— Pourquoi pleures-tu ?
Et Khóai raconta une seconde fois ses malheurs. Le vieillard étendant la main sur le bambou répéta tout bas :
— Disjoignez-vous tout de suite, disjoignez-vous tout de suite !
Et le bambou de se morceler en cent tronçons dont Khóai fit immédiatement deux fagots.
À la maison, il trouva les deux familles en pleines agapes. Dans la cour, des plateaux de victuailles et des nattes chargés de mets et de cadeaux attendaient la mariée. Khóai, rouge d’une juste colère, s’élança vers son maître mais celui-ci, méprisant, lui lança :
— Je ne t’ai pas demandé cent entre-nœuds de bambou séparés, mais un bambou à cent entre-nœuds.
Les invités, s’arrêtant de manier les baguettes, éclatèrent d’un rire méprisant. Khóai, ayant repris ses esprits, pria son maître de sortir pour voir son bambou et, se penchant, souffla très vite :
— Joignez-vous, joignez-vous de suite !
Le bambou se noua instantanément, ligotant le maître qui se débattait rageusement sans pouvoir se libérer. Le chef de canton et son fils voulurent lui venir en aide mais furent ligotés à leur tour. On n’entendait plus que leurs cris et leurs hurlements de douleur. Les invités, blêmes de peur, restaient figés sur place. Finalement, ils vinrent s’agenouiller devant Khóai, implorèrent son pardon et demandèrent la libération des coupables.
Khóai les fit attendre un instant puis murmura :
— Disjoignez-vous, disjoignez-vous de suite !
Le chef de canton et son fils, heureux de s’en tirer à si bon compte, s’en allèrent sans demander leur reste. Le maître, roulé pour la première fois de sa vie, ne put qu’accorder à Khóai la main de sa fille.
Contes satiriques de Trạng Quỳnh
Trạng Quỳnh (Docteur Quỳnh), personnage du XVIIIe siècle, probablement originaire de la province de Thanh Hóa, est très populaire pour ses prouesses, ses traits d’esprits et plus particulièrement ses tours pendables dont les victimes sont surtout les riches et les puissants. Certains de ces récits se moquent de l’ignorance des rois Lê, d’autres tournent en ridicule le seigneur Trịnh, d’autres attaquent l’arrogance des ambassadeurs chinois, d’autres encore critiquent les superstitieux. Il est l’incarnation même de l’intelligence, du bon sens, du courage et de l’esprit populaire.
Les dieux roulés par Trạng Quỳnh
Dans l’ancien Viêt Nam, la coutume voulait que les candidats aux concours des grandes écoles universitaires fissent, avant le jour des épreuves, des offrandes aux génies[1] afin de solliciter leur protection.
Trạng Quỳnh ne croyait guère aux génies, mais ses parents ne voulaient pas que leur fils encourût leur colère divine et qu’à cause de cela, le chemin des honneurs lui fût fermé. Il fit donc ce que ses parents souhaitaient. Cependant, il avait déjà mangé tout l’argent qu’on lui avait donné pour acheter le nécessaire. Il entra alors les mains vides dans le temple qui abritait un génie réputé puissant, se prosterna et fit cette prière : « Ô puissant Génie, pauvre que je suis, je ne puis rien t’offrir pour le moment, mais si tu daignes étendre sur moi ta protection pour que je passe brillamment mes examens, je t’offrirai une vache, foi de Quỳnh. »
Et il fut reçu “licencié”.
Se souvenant qu’il avait à s’acquitter envers son génie protecteur, Trạng Quỳnh alla emprunter une vache avec son petit, qu’il amena au temple. À la table sur laquelle était placée l’idole, il attacha la vache et laissa le veau en liberté. Puis il se prosterna devant l’autel en disant :
— Merci, ô Génie, qui par ta protection efficace a assuré mon succès aux examens ! Voici la vache que je t’ai promise. Accepte-la !
Ceci dit, il se retira en emmenant le veau. La vache, voyant son petit s’éloigner d’elle, s’élança à sa poursuite, entraînant la table à laquelle elle était attachée. Les objets de culte, y compris la statuette du génie, dégringolèrent avec fracas.
— Comment, s’écria Trạng Quỳnh en se retournant, tu as pitié de ma pauvreté et tu me renvoies l’offrande ? Alors, que ta volonté soit faite !
Il remit la table sur ses pieds, releva les objets de culte et la statuette, détacha la vache et l’emmena.
_____________
[1] Au Viêt Nam, les croyances sont syncrétiques : bouddhisme, culte des ancêtres, culte de la Mère Divine, culte du Génie du village, culte aux Saints-Héros… Chaque Vietnamien célèbre, au cours de l’année et en fonction de ses convictions, quelques-uns de ces différents cultes en des lieux dédiés tels qu’autel des ancêtres de la maison familiale, pagode, maison communale, temple… Il existe de nombreux génies “spécialisés” auxquels on peut s’adresser en fonction des circonstances.
Le chat du roi et le chat du peuple
Le roi possédait un fort joli chat. Un jour, Trạng Quỳnh conçut l’idée de le lui enlever. Le matou devint bientôt son hôte et le voleur ne tarda pas à en devenir le propriétaire légal.
Pour avoir gain de cause dans le différend qu’il subodorait survenir bientôt, l’astucieux Trạng Quỳnh se mit à dresser spécialement l’animal. Chaque jour, il le mettait entre deux plats, l’un rempli de mets recherchés, l’autre, de restes sordides.
L’animal, qui était bien nourri chez le roi, ne se faisait pas faute, on le pense bien, de s’attaquer immédiatement à celui des plats qu’il jugeait le mieux approprié à son goût. Mais ce à quoi il ne s’attendait nullement, c’est un formidable coup de baguette que lui administrait en pleine épine dorsale son nouveau maître, en même temps qu’une main brutale le ramenait par l’oreille vers le plat dédaigné.
Ce manège se répétait chaque jour et, comme tout chat échaudé craint l’eau froide, celui de Trạng Quỳnh, au bout d’un certain temps, finit par renoncer définitivement à ses habitudes aristocratiques.
C’était le moment que le farceur attendait pour montrer son chat au grand jour.
Le roi ne tarda pas à apprendre en quelles mains se trouvait son bien disparu.
Il fit ramener de force Trạng Quỳnh et le chat. Aucun doute n’était possible, l’animal qu’il voyait était bien le sien.
Trạng Quỳnh fut donc accusé de vol au préjudice du roi. On sait ce qui l’attendait.
— Il est possible que mon chat ressemble à celui de Votre Majesté, mais il est bien à moi, protesta Trạng Quỳnh. Preuve bien fragile qu’une ressemblance de pelage ! C’est par centaines que se comptent les chats semblables les uns aux autres. Pour établir définitivement à qui il appartient, il faudrait des preuves autrement concluantes.
— Et quelle preuve pourras-tu donner pour nous convaincre que ce chat est à toi, effronté coquin ?
— La voici ! Votre Majesté a de quoi bien nourrir son chat, qui doit être un grand gourmet. Le mien, qui doit adapter son train de vie à celui de son maître, un pauvre bougre qui tire le diable par la queue, a évidemment des goûts plus plébéiens. Ordonnez qu’on apporte deux plats différents par la qualité de leur contenu, et Votre Majesté s’en convaincra sur-le-champ.
Le roi consentit et l’examen eut lieu. Inutile de vous dire que l’animal traversa l’épreuve à sa gloire.
Trạng Quỳnh ramena son chat, laissant le roi tout penaud.
Les pêches de la longévité
Un jour, l’empereur de Chine fit cadeau au roi d’Annam de pêches d’une grosseur peu commune, appelées pêches de longévité. Le présent fut apporté au cours d’une audience royale. Les courtisans admiraient à qui mieux mieux les merveilleux fruits. Trạng Quỳnh, qui était présent parce qu’il était lui aussi dignitaire, s’approcha des pêches, en saisit une, la porta à sa bouche et la croqua à belles dents.
— Qu’on arrête ce misérable et qu’on lui coupe la tête ! ordonna le monarque, pâle de colère.
Les officiers de la cour se saisirent de Trạng Quỳnh qui se mit alors à pleurer comme un veau.
— Toi qui as eu la témérité de goûter à ces fruits destinés à ton souverain, crime que tu dois payer de ta vie, as-tu peur de mourir, vile et lâche canaille ? s’écria le roi.
— Non Sire, répondit Trạng Quỳnh, sanglotant de plus belle, si je pleure, c’est que je crains pour votre auguste personne, car vous allez mourir bientôt.
— Quelle sottise me racontes-tu encore là, espèce de fou ! Qui t’a dit que je cesserai bientôt de vivre ?
— Eh bien, Sire, voyant ces pêches qui s’appellent pêches de longévité, j’ai voulu en manger une, car je tenais à vivre aussi longtemps que possible. Mais je n’en ai pas encore fini le quart, que déjà la mort, sans crier gare, vient me cueillir. D’où je conclus que si Votre Majesté commet la fatale imprudence de manger toutes les pêches qui restent, elle n’en mourra que plus vite.
— Qu’on relâche ce coquin ! dit le roi, amusé de cette audacieuse plaisanterie.
Tentative d’empoisonnement du roi
Trạng Quỳnh se retrouvait souvent avec la poisse, mais il savait toujours se tirer d’affaire. Une fois, de sa province natale, il se rendit à la capitale. Le voyage demandait plusieurs jours, donc coûtait cher. Trạng Quỳnh n’avait de l’argent que pour deux jours de route. Le troisième jour, quand les ressources destinées au voyage furent épuisées, il se trouva dans une situation assez précaire. En chemin, il ne rencontra personne de connaissance. Alors voici l’expédient qui le sauva.
Cette nuit-là, au lieu de dormir, il sortit et ne rentra que fort tard avec, sous sa tunique, un paquet. L’hôtelier qui l’attendait, l’examina d’un œil méfiant : « Ce doit être un voleur, se dit le bonhomme, je vais le surveiller de près ». Trạng Quỳnh gagna sa chambrette, alluma la lampe à huile et se mit à faire des paquets. L’aubergiste, qui s’était promis de le surveiller, ne dormait pas lui non plus. Par une fente de la cloison qui séparait sa chambre de celle de Trạng Quỳnh, il épia. Le présumé malfaiteur écrivait sur chaque paquet des caractères qu’il épelait à voix assez basse, mais suffisamment distincte pour qu’une oreille attentive pût entendre. Et voici ce que l’hôtelier entendit : « Poison pour le roi et la reine…, poison pour le seigneur Trinh…, poison pour son Altesse le frère cadet du roi… »
L’aubergiste quitta son poste d’observation et sortit secrètement. À l’aube, la maison fut cernée par de nombreux gardes armés de lances, de coupe-coupe et de sabres. On secoua violemment Trạng Quỳnh qui dormait encore et, avant qu’il eût ouvert les yeux, on le ligota solidement puis on le jeta sur une charrette qui se mit en route pour la capitale.
Arrivé dans la cour du ministre de la justice, on le fit agenouiller à côté des paquets suspectés et l’interrogatoire commença.
— Merci pour la sollicitude dont je fus l’objet pendant tout le voyage, dit-il. Sans l’état qui a pris à sa charge tous les frais, me faisant transporter en voiture et veillant à ma sécurité en chemin, je serais mort de faim deux jours après avoir quitté mon village natal.
Ce disant, il défit les paquets et en croqua à belles dents le contenu. Des baies sauvages comestibles, mais que peu de personnes connaissaient.
On chassa alors le mauvais plaisant qui, en sortant, salua courbé en une parfaite révérence.
Le diable et les rois de l’enfer
L’arbre nêu du Tết
Cette histoire se passait en des temps anciens où le Diable régnait en maître sur le monde. Toutes les terres lui appartenaient et il les louait à l’Homme qui devait payer une taxe agraire de plus en plus lourde. Une fois, il l’avait même doublée et depuis l’augmentait peu à peu chaque année. Un jour, il décréta une nouvelle loi : « Le sommet de la plante au Diable et la racine à l’Homme ». Ce dernier protesta mais, finalement, dut se plier à la raison du plus fort. Après la moisson du riz, il ne restait plus à l’Homme que les chaumes. La disette sévissait partout. Le Diable exultait tandis que l’Homme mourait de faim. Sur ces entrefaites arriva Bouddha, venu de l’ouest, qui voulait aider l’Homme à le libérer de ce joug. Il lui dit de planter, à la saison prochaine, des patates douces, ce qu’il fit. Le Diable, ne s’attendant pas à ce mauvais tour, continua à dicter sa loi : « À moi le sommet de la plante, à toi la racine ». Après la récolte, il fut fort dépité de voir l’Homme transporter à tour de bras les patates vers sa demeure, ne lui laissant que les tiges et les feuilles qui n’étaient point comestibles. Mais le Diable ne pouvait faire autrement, c’était la règle du jeu, sa règle du jeu.
Arriva une nouvelle saison. Le Diable modifia la loi : « La racine au Diable, le sommet à l’Homme ». Bouddha conseilla alors à ce dernier de cultiver du riz. Résultat : les épis de riz s’entassaient dans sa maison et il ne restait plus au Diable que les éteules. Fou de rage, le Diable décréta : « À moi le sommet et la racine ». Satisfait, il se dit : « Quelle que soit la plante que l’Homme cultivera, le tout me reviendra ! » Cette fois, Bouddha conseilla à l’Homme d’essayer une plante d’une autre espèce. Il lui remit des graines de maïs et put bientôt se réjouir de voir de pleins paniers s’amonceler dans le grenier de l’Homme. Le Diable ne s’avoua pas vaincu pour autant : « Plutôt tout perdre que de laisser accaparer tous mes biens », pensa-t-il. Il réclama à l’Homme toutes ses terres.
Sur les conseils de Bouddha, l’Homme demanda au Diable de lui céder un terrain d’une superficie égale à l’ombre que projetterait une robe de bonze. Il y planterait un bambou surmonté de cette robe et seule la zone d’ombre créée par ce corps sur le sol serait en sa possession. Il ajouta qu’il serait bien payé.
Le Diable acquiesça, trouvant la proposition intéressante. Ainsi, les deux parties convinrent que la zone ombragée appartiendrait à l’Homme et que la zone éclairée reviendrait au Diable.
Lorsque le bambou fut planté, Bouddha se plaça à son sommet, faisant en sorte que la robe se déployât en cercle. La plante se mit alors à s’allonger jusqu’à toucher la voûte du ciel. L’ombre de la robe couvrit ainsi toute la surface de la Terre, si bien que le Diable fut refoulé à la Mer de l’Est, d’où son appellation de Diable de l’Est.
Le Diable furieux, regrettant bien que toutes ses terres fussent aux mains de l’Homme, voulut les reconquérir par la force. Il leva une puissance armée composée d’éléphants, de chevaux, de serpents blancs, de tigres noirs, de cerbères...
Comme l’Homme avait à faire face à un redoutable adversaire, Bouddha lui vint de nouveau en aide en repoussant les attaques du Diable avec son bâton magique. Après plusieurs tentatives infructueuses, le Diable envoya ses soldats auprès de Bouddha pour chercher à savoir ce qu’il craignait. Il leur fit croire qu’il redoutait les fruits, les gâteaux de farine de riz, les boules de riz tassé et les œufs durs. En revanche, il apprit à son tour que les troupes du Diable avaient peur du sang de chien, des feuilles d’ananas, de l’ail et de la chaux en poudre.
À la seconde offensive, les troupes du Diable jetèrent à profusion des fruits à la tête de Bouddha qui ordonna à l’Homme de les ramasser et d’en faire des provisions. La divinité répandit alors du sang de chien sur le sol, mettant ainsi en déroute les assaillants.
Les troupes du Diable revinrent avec des gâteaux de farine de riz qu’elles envoyèrent sur leurs adversaires qui en firent là encore de bonnes réserves. Quant à Bouddha, il lança dans l’air de l’ail pilé dont l’odeur éloigna l’ennemi.
Une troisième fois, le Diable chargea le Bouddha avec des boules de riz et des œufs durs. L’Homme s’en régala et, sur les recommandations de la divinité, saupoudra le Diable de chaux et le fouetta avec des feuilles d’ananas, le clouant sur place. Il fut ensuite exilé dans la Mer de l’Est avec sa nombreuse famille, des vieux, des jeunes et des petits diables, mâles et femelles. Vaincus, ils se prosternèrent devant le Bouddha en le suppliant de les autoriser à retourner sur la terre ferme à l’approche du Tết pour rendre hommage à leurs morts. Par compassion, il accepta.
Depuis ce temps-là, à l’approche de la nouvelle année, lorsque le Diable retourne sur le continent, l’Homme plante l’arbre nêu devant sa demeure pour l’éloigner. Sur l’arbre est accroché un gong de terre dont les sons servent d’avertissement au Diable. Une poignée de feuilles d’ananas ou une branche de banian y est attachée pour l’effrayer. On dessine encore, sur le sol, la figure d’un arc dont la flèche est pointée vers l’est et l’on répand de la chaux en poudre, toujours dans la même intention. De là, le dicton populaire :
Les branches d’ananas et de banian suspendues bien haut
Et la chaux en poudre répandue sur le sol
Servent d’avertissement au Diable.
S’il se montre et ne reste pas sage,
On lui fendra la bouche avec les branches de banians et d’ananas[1].
________________
[1] Auparavant, selon la croyance populaire, on suspendait, en cas d’épidémie, une poignée de feuilles d’ananas devant sa porte et on répandait du sang de chien sur le sol pour repousser le Diable qu’on croyait l’auteur de l’épidémie. Pour la même raison, les femmes portaient toujours quelques gousses l’ail aux cordons de leur cache-seins.
La vertu récompensée
Un jour, le Diable arrête trois âmes errantes qu’il remet au Roi des Enfers[1]. Ce dernier procède tout de suite aux interrogatoires :
— Quel métier exerciez-vous de votre vivant ?
L’âme du voleur répond :
— J’étais très pauvre. Je ne pouvais pas faire l’aumône, mais je rendais des services à ma façon. Chaque nuit, je faisais le tour des maisons et, si quelque chose n’était pas en sécurité, je le mettais à l’abri.
Le Roi des Enfers le félicite :
— Tu as mené une vie méritante. Je vais te réincarner en grand mandarin.
L’âme de la prostituée, interrogée, répond :
— Je n’avais pas de mari, mais j’ai toujours éprouvé de la compassion pour les veufs, je les accueillais comme des maris.
Le Roi des Enfers la loue pour son abnégation :
— Tu es vraiment d’une grande générosité. Tu seras réincarnée en grande dame.
L’âme du médecin dit alors :
— Il me manquait la générosité de mes compagnes. Tout ce que je peux dire, c’est que dans le monde des vivants, j’ai sauvé de nombreux malades.
Le Roi des Enfers, en colère, s’écrie :
— Ainsi, quand j’envoyais un émissaire sur la Terre pour ramener des âmes, c’est toi qui défiais mon ordre. Qu’on le jette dans l’huile bouillante !
L’âme du médecin, toute en larmes, se prosterne :
— Accordez-moi, Sire, un sursis d’une nuit pour que je puisse rentrer dire à mon fils et à ma fille de se faire voleur et prostituée.
________________
[1] Après la mort, le corps est détruit mais l’âme monte au paradis, descend en enfer ou revient dans le monde des mortels dans un autre corps (humain ou animal) selon le bilan des bonnes et des mauvaises actions de la vie. Le chemin qui mène en enfer ou à la renaissance passe d’abord par le pays de Phong Đổ. Le premier Roi des Enfers (Diêm Vương), nommé Tận Quáng Vương, y reçoit les âmes en regardant dans sa glace où apparaissent tous les actes de la vie du défunt. Les juges et les démons sont donc en mesure de faire le bilan des actes en vue du verdict. Après un arrêt prononcé par Tận Quáng Vương, les âmes coupables sont emmenées par les démons aux différents enfers. Chez les autres Roi des Enfers, il y 8 grandes et 128 petites prisons. Les châtiments varient d’une prison à l’autre, le condamné pouvant être éventré, avoir le cœur arraché, être jeté dans l’huile bouillante, avoir les membres coupés, le tronc scié en deux… Tận Quáng Vương ne gère lui-même aucune prison ; il dispose seulement d’un Office de Prières complémentaires où les religieux qui n’ont pas récité le nombre de prières prescrit doivent payer leur dû. Le dixième Roi des Enfers, Chuyển Luận Vương, ne gère, lui non plus, aucune prison, mais est occupé à répartir les renaissances et oblige les assassins, les brigands et autres scélérats, à traverser un pont en arc-boutant sur la Rivière de la Résignation (Nại Hà), pont terriblement glissant, gardé à ses extrémités par des cerbères, surplombant un cours d’eau rempli de serpents et de crocodiles. Les âmes désignées pour une renaissance sous forme humaine doivent passer par le Pavillon de l’Oubli (Cháo Lú) qui effacera dans leur esprit jusqu’au moindre souvenir de leur vie antérieure. Il permet aussi aux femmes qui ne veulent pas renaître, de rester dans l’enfer et d’attendre la mort de ceux qui les ont martyrisées afin de se venger d’eux.
Tentation
L’âme courroucée du cochon porte plainte devant Diêm Vương, le Roi des Enfers.
— Sire, on m’a assassiné !
— C’est grave, ça ! dit le monarque. Raconte comment cela s’est passé.
— Ils m’ont ligoté et égorgé.
— Aïe !
— Et puis ?
— Ils m’ont versé de l’eau bouillante sur tout le corps.
— Les barbares !
— Ensuite ?
— Ensuite, ils m’ont dépecé en petits morceaux, m’ont jeté dans une marmite, y ont ajouté de la graisse parfumée…
— Ça suffit ! Ça suffit ! L’eau me vient déjà à la bouche.
Méprise
Un jour, Diêm Vương, le Roi des Enfers, tomba malade comme le commun des mortels. Un émissaire fut envoyé dans le monde des vivants pour faire venir un médecin.
— Il faut choisir celui qui a le moins de morts à son actif, recommanda le sage monarque.
— Comment peut-on le savoir ? demanda l’émissaire.
— Facile ! Amène-moi celui qui a le moins d’âmes furieuses rôdant devant chez lui.
L’émissaire consciencieux parcourut les rues sans trouver l’oiseau rare.
Devant la porte de chaque praticien, une foule d’âmes se lamentaient en réclamant justice. Aussi s’empressa-t-il d’emmener celui qui n’avait qu’un seul esprit devant sa porte.
Diêm Vương traita l’homme de science avec tous les égards dus à son talent. Il daigna lui adresser la parole :
— Votre réussite exceptionnelle doit être le fruit d’une longue pratique. Depuis combien de temps exercez-vous ?
— Sire, répondit le médecin, je n’ai ouvert mon cabinet que depuis ce matin et vous êtes mon second patient !
Toutes les places sont prises
Un mendiant décharné et dépenaillé vint chez un gros richard demander la charité. Ce dernier le tança vertement :
— Disparais de ma vue, espèce de fainéant crasseux, il est clair que tu arrives tout droit de l’enfer !
À ces paroles, le mendiant répondit :
— C’est juste, je reviens de l’enfer.
Le richard demanda :
— Puisque tu étais descendu dans l’enfer, pourquoi n’y es-tu pas resté ?
Le mendiant répondit :
— C’est bien simple, je n’ai pas pu y rester car il n’y avait plus de place pour moi, les riches les avaient déjà toutes prises.
Contes (texte & audio)
Les deux textes suivants sont disponibles avec l'audio original en langue vietnamienne. Écoutez et lisez simultanément. Une expérience étonnante.
Les trois barbus parlant vietnamien
Interprète : M. Việt. Lieu & date : Viêt Nam, vill. de Hanoi. 1999.
Durée : 03:00. © Patrick Kersalé 1999-2024.
Trois messieurs barbus étaient en train de savourer leur cigare après un repas bien arrosé. Monsieur A se plaignait :
— Ah ces Annamites ! Ils ont un parler bizarre. Quand nous parlons leur langue, ils se mettent à rire[1], pis, à se tordre de rire . Et quand on leur demande : « Pourquoi riez-vous ? », il ne ré-pondent même pas et se mettent à rire de plus belle.
Monsieur B et monsieur C demandent :
— Eh bien, racontez-nous ça !
Monsieur A se lance :
— Un jour, après être arrivé ici, je ne savais pas encore bien me rendre d’un endroit à un autre. Quel que soit le lieu où je devais aller, j’étais obligé de prendre un pousse-pousse. Et puis, le pousse-pousse, vous savez ce que c’est, derrière deux roues et devant deux brancards et un coolie trotteur entre ces deux brancards. Hier soir, au crépuscule, je ne savais plus comment rentrer. J’ai donc appelé un pousse-pousse. Le coolie m’a demandé : « Où allez-vous ? ». J’ai répondu : « À l’église[2] ! ». J’étais heureux et je me suis même endormi… Mais tout à coup, au moment où le pousse-pousse s’est arrêté, je me suis réveillé en sursaut. Le coolie avait posé ses brancards et attendait que le paie. C’est alors que j’ai entendu des voix de femmes, de filles riant aux éclats. Elles vinrent m’accueillir, les unes me prenant par la main, les autres me poussant dans le dos, d’autres encore me tirant la barbe, il y en a même une qui a osé m’embrasser très gentiment sur les deux joues.
Toutes avaient les lèvres maquillées de rouge, une grande jupe de soie. Il y en avait qui relevaient un peu leur jupe et me montrait leur “jambon”.
Monsieur B (un peu sourd d’oreille) s’exclama alors :
— Ah, c’est parfait, c’est parfait, il y avait même du jambon ! Moi j’aime beaucoup le porc fumé, noir noir, fumé fumé !
Monsieur C vient alors à la rescousse :
— Mais alors, quel chanceux êtes-vous, tant de gens venir vous saluer ! Moi aussi, cela m’est arrivé une fois. Alors que j’étais en train d’entrer dans un hameau, il y avait des femmes qui sont venues me saluer, toutes maquillées. Ma nature de bon matelot s’est alors réveillée. Elles me saluaient : « bonjour père, bonjour père ». Moi, très heureux, je lissais ma barbe et, une bonne tape sur les fesses, très bien, très gentil… Alors elles se sont sauvées en criant : « Non ce n’est pas un prêtre, non ce n’est pas un prêtre, c’est un diable, c’est un diable barbu ! ». C’est alors que les garçons du village ont pris des bâtons pour me poursuivre. Heureusement j’ai pu leur expliquer…
______________
[1] On rencontre, au Viêt Nam, trois parlers différenciés : nord, centre et sud. Même si l’écriture est uniformisée, la prononciation des mots (monosyllabiques) est fort variable. De plus, bien que la langue possède six accents écrits, dans certaines régions, on n’en distingue que cinq au plan de la prononciation. Si ceux-ci ne sont pas prononcés avec précision, soit l’interlocuteur ne comprend pas, soit le sens réel est erroné et le propos peut conduire à une situation cocasse. Ainsi cette histoire se joue-t-elle des accents de ces différentes régions, exercice de style dont les Vietnamiens raffolent…
[2] La traduction de église est nhà thờ. Mais comme ce missionnaire ne savait pas encore très bien distinguer un accent d’un autre, il a prononcé nhà thổ, ce qui signifie “maison de joie” !
Trạng Quỳnh, peintre de génie
Interprète : M. Việt. Lieu & date : Viêt Nam, vill. de Hanoi. 1999.
Durée : 02:37. © Patrick Kersalé 1999-2024.
Autrefois, quand l’empereur de Chine voulait conquérir un pays voisin, il cherchait d’abord à savoir si ce dernier avait à sa tête des hommes talentueux. Pour cela, il avait pour habitude d’envoyer des mandarins en ambassade chargés d’obtenir du gouvernement convoité une réponse satisfaisante à une question-jeu de mots, un tour d’esprit ou encore à une énigme difficilement déchiffrable pour le commun des mortels. Tout problème resté sans solution était considéré comme une preuve de carence du peuple choisi comme victime, et l’agression, généralement, s’ensuivait. Au contraire, on n’avait rien à craindre si l’on pouvait fournir les bonnes réponses.
Un jour, un envoyé céleste vint à la cour d’Annam, porter un message de son auguste maître, qui exigeait que celle-ci trouvât un peintre assez habile pour lui dessiner, le temps de trois coups de tambour, c’est-à-dire en moins de cinq secondes, un animal.
Tous les peintres du royaume furent réunis, mais aucun n’osa assumer une telle mission.
Trạng Quỳnh fut alors mandé.
— Dépenser tant de temps pour dessiner un animal ? Fi, j’en dessinerai dix, moi !
On allait procéder à l’épreuve. Trạng Quỳnh ayant barbouillé d’encre ses deux mains, attendit avec une feuille de papier devant lui. Trois coups de tambour retentirent : « boum, boum, boum ! ». Le dessin était prêt. Sur le papier apparaissaient dix formes étranges rappelant des vers de terre.
— Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda l’envoyé du Céleste Empire, ébahi.
— Mais ce sont dix dragons ! répondit Trạng Quỳnh avec le plus grand sérieux du monde.