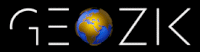© Michelle Brière 2000-2024.
Viêt Nam - Parole d'ancêtre Viêt 2/3
SOMMAIRE
. Le génie reconnaissant
. Le buffle est plus gros que la souris
. Tu vas crever, oui ou non ?
. Le cochon miraculeux
. Payer la moitié
. Un médecin consciencieux
. Ma tonnelle va aussi s’effondrer
. Le comble
. Concours de vantards
. Erreur d’interprétation
. La femme avisée
. Une bonne élève
. Le gardien de la pagode…
. De fil en aiguille
. Perte de soi-même
. Le tailleur fou
. Le plus courageux
. Radical
. Ma femme a raison
. Toujours la même chose
. Je ne souhaite que ça
. Un fameux mathématicien
. Le message
. Trois générations d’originaux
. Simple déplacement
. Le son du monocorde
. Échange
. Un champion
. Prévoyant
. Poisson de bois
. Je préfère mourir
. Un fameux flemmard
. Plus fort
que son maître
. Pris à son propre piège
. Qui me nourrira ?
. Assaut de vanité
. Le serpent carré
Histoires de mandarins
Autrefois les mandarins étaient l’objet de critiques acerbes de la part du peuple. À travers eux, c’est tout le système politique qui est passé au crible. Ils sont présentés comme des êtres vantards, corrompus et pingres.
Le génie reconnaissant
Ce grand militaire d’aspect farouche, toujours flanqué de son fusil, était en réalité un piètre tireur. De fait, il n’avait encore jamais réussi à faire mouche sur sa cible d’entraînement secrètement posée dans son jardin.
Survint la guerre. Ses troupes se débandèrent à la première escarmouche, mandarin en tête. Cerné de près et sur le point de s’évanouir, il vit surgir du néant un génie qui l’emporta dans la forêt, au nez et à la barbe de ses poursuivants.
Dès qu’il se sentit en sécurité, le mandarin se hâta de se jeter aux pieds de son sauveur :
— Ô bonté incarnée ! dit-il. Qui êtes-vous pour me tirer de ce mauvais pas ?
Le génie regarde d’un œil attendri son interlocuteur et dit :
— Je te devais bien ça, c’est moi le génie de ta cible !
Le buffle est plus gros que la souris
Ce mandarin était vraiment une perle, l’exception qui confirme la règle, car jamais on ne l’avait jamais vu accepter le moindre pot-de-vin. Aussi, lorsqu’il eut atteint l’âge de la retraite, la population reconnaissante décida-t-elle de lui offrir un souvenir digne de sa haute fonction.
N’osant s’adresser directement à l’intéressé, les délégués supplièrent sa femme de leur faire savoir ce qui pourrait faire plaisir à leur mandarin.
— Puisque vous insistez, dit l’épouse du mandarin, un petit bibelot fera l’affaire.
— Bonne idée ! Sauf votre respect, Madame, pourriez-vous nous dire en quelle année Monsieur le grand mandarin a vu le jour ?
— Dans l’année de la souris[1]. Pourquoi donc ?
— Eh bien ! Nous allons lui faire présent d’une souris en argent massif, grandeur nature !
La femme du mandarin reçut le cadeau sans oser rien dire à son mari.
Quelques années plus tard, notre mandarin connut des jours difficiles. Sa femme fit découper la souris en petits morceaux qu’elle vendit au fur et à mesure des besoins de la famille. Ayant découvert la chose, Monsieur s’étonna :
— D’où te vient cette souris en argent ? demanda-t-il.
La dame lui raconta l’histoire en tremblant, s’attendant à une vertueuse indignation. Mais lui soupira :
— Ma pauvre amie ! Pourquoi avoir dit la vérité ? C’est buffle qu’il aurait fallu répondre ! Ainsi aurait agi tout mandarin digne de ce nom !
________________
[1] Le calendrier lunaire divise le temps en cycle de douze années symbolisées chacune par un animal : la souris, le buffle, le tigre, le chat, le dragon, le serpent, le cheval, le singe, la chèvre, le coq, le chien, le porc.
Tu vas crever, oui ou non ?
La famille célébrait l’anniversaire de la mort d’un ancêtre. Selon la coutume, la femme avait déposé un plateau de victuailles sur l’autel quand une mouche vint se poser sur la viande. Indignée, la femme apostropha son mari :
— Quel malheur ! Ne peux-tu donc pas être vigilant ? Tu as laissé une mouche souiller les offrandes sacrées !
Aussitôt, l’homme s’en prend à la mouche :
— C’est avec toute notre âme que nous avons préparé ce repas et tu le profanes. Les aïeux ne viendront plus jouir du festin donné en leur honneur !
De ce pas, il alla trouver le mandarin du district pour se plaindre :
— Monsieur le Grand Mandarin, nous avons trimé tout au long de l’année pour pouvoir offrir aujourd’hui un repas de culte. Mais voilà qu’une mouche insolente a souillé notre offrande. Je m’en remets à vous pour juger cette affaire.
Le mandarin écouta jusqu’au bout et dit :
— Je t’autorise à la tuer quel que soit l’endroit où tu la vois.
Mais à peine eut-il jeté cette phrase qu’une mouche se posa sur sa joue droite.
Le plaignant serra alors les lèvres et envoya une gifle monumentale dans la figure du mandarin tout en jurant :
— M…! Tu vas crever, oui ou non ?
Le cochon miraculeux
Il était une fois deux amis. L’un d’eux devint mandarin et oublia aussitôt son compagnon d’infortune. Celui-ci avait beau venir et revenir chez le grand homme, l’intraitable garde de service trouvait chaque fois un prétexte pour lui refuser l’entrée.
Il fit alors l’acquisition d’un cochon de lait rôti bien doré et l’apporta sur un plateau à la résidence mandarinale.
Les portes s’ouvrirent comme par miracle et il fut introduit séance tenante auprès de Monsieur le Grand Mandarin. Négligeant de répondre au salut dont le mandarin le gratifiait, il posa en silence la bête sur la table et se prosterna devant elle en disant :
— À toi, ô sacré cochon, qui viens d’opérer le miracle de rafraîchir la mémoire de mon ami, grâces te soient rendues !
Le cochon miraculeux
Autrefois, les mandarins ne payaient que la moitié du prix sur toute chose qu’ils achetaient, sauf l’or. Un mandarin nouvellement promu demanda à un orfèvre de lui vendre deux onces d’or. Le boutiquier, qui craignait la dureté du mandarin, lui dit :
— Grand mandarin, une once[1] vaut soixante sapèques[2] , mais je ne vous en demande que la moitié.
Tranquille, le mandarin en empocha une, remit l’autre au boutiquier et s’en alla. Pensant que le mandarin allait lui payer, l’orfèvre attendit sans impatience. Réapparaissant un long moment après, le mandarin s’en étonna :
— Les comptes sont faits, pourquoi restes-tu là ?
— J’attends que vous me payiez.
Mais c’est fait ! Que me demandes-tu encore ?
— Mais vous me devez le prix de l’or que vous avez pris.
Alors le mandarin s’indigna :
— Que c’est drôle ! Tu m’as demandé de payer la moitié. Disons que j’achète les deux onces, je retiens l’une et je te rends l’autre. Ne t’ai-je pas alors payé la moitié ?
_________________
[1] Une once = 30,6 grammes.
[2] Unité monétaire. Pièce ronde percée d’un trou carré (Đồng). 1 Đồng = 10 Phận = 3,83 g.
Un médecin consciencieux
Un jour, un malade fut pris d’un violent mal au ventre. En pleine nuit, on courut chercher le guérisseur. Celui-ci alluma la lampe, consulta son vade-mecum et prescrit d’acheter quelques centaines de grammes de ginseng, de les faire bouillir et de donner ce breuvage au malade.
Le malade suivit la prescription et mourut au matin. La famille porta plainte et le guérisseur dut comparaître devant le mandarin qui demanda :
— Que lui avez-vous donné pour qu’il s’en aille aussi vite ?
Le guérisseur répondit d’un air assuré :
— Monsieur le Mandarin, j’ai fait exactement ce que dit le manuel de médecine.
Il lui présenta le livre. Le médecin ouvrant le vade-mecum à la page du ginseng, lut : « Boire du ginseng en cas de mal au ventre ». Mais la phrase n’étant pas terminée, il tourna la page et vit qu’il restait encore trois mots : « entraîne la mort ».
Un médecin consciencieux
Le secrétaire d’un mandarin de district, mari peureux, s’est vu griffé par sa femme à en avoir le visage tout égratigné. Au bureau, son supérieur lui demande :
— Pourquoi votre visage est-il ravagé ?
Le secrétaire répondit :
— Hier après-midi, j’étais assis, en train de prendre un peu le frais sous la tonnelle, quand elle s’est effondrée. Encore un peu et j’y passais !
Le mandarin, qui n’était pas dupe, interrogea de nouveau :
— Vous me mentez, c’est encore votre femme qui vous a griffé n’est-ce pas ? Allons, dites-moi la vérité, je dirai à mes domestiques de me la traîner jusqu’ici. Les femmes, il faut les corriger sans scrupule, sinon vous verrez, on leur donne la main et elles réclament le bras !
Sa femme qui, sans qu’il s’en doute, avait tout entendu de l’intérieur de la maison, s’avança, le visage hargneux. À cette vue, le mandarin dit à son secrétaire, la langue figée par la peur :
— Écoutez… Reculez un peu… Ma tonnelle à moi va aussi s’effondrer !
Le comble
Sa solide réputation de farceur joua à cet homme un tour pendable, puisque le nouveau mandarin qui se piquait d’intelligence, le convoqua à son bureau et lui dit :
— Tu vois sur ma table un tael[1] d’argent qui sera pour toi si tu réussis à me mettre en boîte. Sinon, ta réputation étant surfaite, je te ferai donner trente coups de ce gros rotin pour t’apprendre à ne plus te moquer des imbéciles !
L’homme, tout en jetant des regards effrayés vers l’instrument de supplice, se gratta les oreilles, en proie à la plus grande perplexité.
— Vous êtes père et mère du peuple, se décida-t-il de répondre, je vous dois toute la vérité. Mais jamais je n’ai menti de ma vie !
— Ça ne prend pas ! dit le mandarin en souriant avec condescendance. J’ai tous les témoins que je désire !
— Ce sont des imbéciles, comme vous venez de le dire.
Toutes les histoires que je leur ai racontées se trouvent dans un livre que mon grand-père a rapporté de Chine. Les ignorants croient que je les invente, mais un érudit comme vous…
— Apporte-le moi ! J’ai fait pas mal de lectures et je voudrais bien savoir si je l’ai déjà lu…
— Quoi donc, monsieur le mandarin ?
— Ton livre !
— Mais je n’en ai jamais eu, ou plutôt, ce tael d’argent que vous avez perdu m’aurait permis d’en acheter un, si j’avais su lire !
La présence des miliciens que le mandarin avait pris soin de réunir pour l’éventuelle bastonnade l’empêcha de se dédire. Et c’est ainsi qu’un mandarin fut obligé d’y aller de sa poche pour rejoindre les rangs de ceux qu’il traite d’imbéciles.
________________
[1] Lạng = 38,3 g.
Concours de vantards
Un jour de congé, quatre mandarins réunis se dirent, l’alcool[1] aidant :
— Organisons le concours du plus grand vantard d’entre nous.
Tous s’exprimèrent avec ou sans esprit.
— J’ai vu, dit le premier, un buffle si puissant que d’un coup de langue, il tondait l’espace d’un sào[2] de riz.
— Ce n’est pas pour vous étonner, mais j’ai vu moi-même une corde grosse comme dix colonnes de notre maison communale[3], s’écria aussitôt un second mandarin.
Le premier, s’avouant vaincu, un troisième entre en lice.
— Il existait jadis, un pont dont la longueur était telle que deux personnes à l’un et à l’autre bout ne pouvaient s’apercevoir et l’on m’a conté cette histoire : un fils marié à l’une des extrémités du pont, apprit que son père qui habitait de l’autre côté venait de mourir. Il partit aussitôt mais n’arriva, hélas, qu’après la période de deuil qui avait duré trois ans.
Le quatrième renchérit :
— J’ai bien vu, moi, un kapokier si haut que des œufs échappés d’un nid éclosaient en chemin et parvenaient à terre avec des oiseaux parfaits qui s’envolaient.
Et nos mandarins de rire aux éclats, satisfaits de leur esprit :
— Espèces de menteurs ! tonne une voix forte. Holà, gardien, qu’on les enchaîne tous les quatre.
Nos mandarins, tremblants de peur, mirent du temps à se remettre. Reconnaissant un simple serviteur, ils reprirent aussitôt leur morgue habituelle.
— Eh bien coquin, tu oses nous parler ainsi !
— Messeigneurs, répondit notre homme, je vous ai vu instituer un concours de vantardise, j’ai simplement voulu vous en servir une, à ma façon !
_______________
[1] L’alcool le plus consommé au Viêt Nam est l’alcool de riz gluant (rượu gạo).
[2] 1 sào = 489,44 m2.
[3] La maison communale est le plus important ouvrage architectural du village. On y rend le culte au génie tutélaire de la communauté, le thần thành hoàng (littéralement “citadelle-fossé-génie” c’est-à-dire le génie des remparts).
Erreur d’interprétation
Chaque fois que ce petit écolier passait devant le temple, la statue de pierre du génie se hâtait de se lever.
— C’est signe que mon fils sera un grand mandarin, se réjouissait le père. Le génie tutélaire du village lui-même n’ose rester assis devant lui !
Hélas, avec l’âge, le petit cancre ne devint rien d’autre qu’un parfait voleur. Le père s’en prit au génie :
— Cruel génie, vous m’avez scandaleusement trompé !
— Comment cela ?
— Pourquoi vous leviez-vous au passage de mon chenapan de fils ? Ça m’a fait croire qu’il était rompu à une haute destinée !
— Funeste erreur ! s’esclaffa le génie prévoyant, je craignais tout bonnement qu’il ne dérobât mes babouches !
La femme avisée
Un homme avait fait fortune, mais son jeune frère sombrait de plus en plus dans la misère. Au lieu d’aider son cadet, l’aîné faisait ripaille tous les jours avec de joyeux lurons attirés par ses largesses.
— Tu devrais songer à ton frère, plutôt que de jeter l’argent par les fenêtres et d’engraisser des étrangers qui n’aiment que ta fortune ! lui lança sa femme.
— Parle plus poliment de mes amis ! répliqua-t-il. À chacun sa destinée, que mon frère se débrouille tout seul !
La femme se résolut à ouvrir les yeux de son mari.
Un soir, profitant de son absence habituelle, elle tua un chien, l’enveloppa dans une natte et le plaça dans un coin du jardin.
Au retour de son mari, elle joua l’affolement :
— Que faire ? J’ai tué un enfant !
— Ciel, comment est-ce arrivé ? demanda le mari subitement dégrisé.
— Il était venu mendier à notre porte. Comme je cherchais quelque chose pour lui, il m’injuria, me trouvant trop lente à son gré. Je lui ai alors asséné un coup de bâton et il est tombé raide mort !
— Où as-tu caché le cadavre ?
— Dans un coin du jardin. Il nous faut quelqu’un pour le faire disparaître avant le jour !
— Bon, c’est facile ! dit le mari. Je cours chercher mes amis.
Tous ceux qui venaient de lui jurer éternelle amitié se dérobèrent. Sa femme lui souffla alors :
— Adresse-toi à ton frère.
— Je crains qu’il ne refuse aussi.
— Essaie toujours ! J’ai entendu dire que les frères sont comme les doigts d’une main !
La femme avait raison. Le frère ne se fit pas prier. Soucieux de tirer son aîné d’un mauvais pas, il vint, creusa une tombe et y enterra ce qu’il croyait être le cadavre d’un enfant.
Le lendemain, les faux amis arrivèrent et essayèrent de faire chanter le ménage. Éconduits, ils le dénoncèrent à la justice dans l’espoir de toucher quelque prime.
La femme avoua alors au mandarin la supercherie à laquelle elle avait eu recours pour convaincre son mari. On déterra le cadavre et chacun put se rendre compte que c’était celui d’un chien.
Le mandarin félicita la femme et jeta les dénonciateurs déconfits en prison. Quant au mari, trouvant la leçon pertinente, il ne marchanda plus à son jeune frère ni affection ni aide.
Une bonne élève
Autrefois, vivait un couple de jeunes mariés. Le jeune homme était intelligent, mais la jeune femme était à la fois maladroite et sotte. Elle touchait rarement à quelque objet sans le détériorer.
Un jour, ayant acheté deux jarres de terre cuite, elle les montra à son mari, espérant que, pour une fois, il serait content d’elle.
« C’est l’occasion de lui donner une leçon, se dit le jeune homme. Ce sera bien dommage pour les jarres neuves, mais elle sera au moins guérie de sa détestable habitude de tout casser. »
Et, devant sa femme, il donna aux jarres deux copieux coups de pied qui les firent voler en éclats.
— Qu’as-tu fait ? Es-tu fou ? s’écria la femme affolée.
— Je les brise pour t’éviter la peine de les briser plus tard, rétorqua le mari.
Après cet événement, l’homme dit un jour à sa femme d’aller au marché pour acheter un grand poisson pour le souper. De retour, elle lui montra la marchandise puis courut à une mare située derrière leur maison pour y lâcher le poisson encore vivant.
— Qu’as-tu fait, malheureuse ? s’écria le mari indigné.
— C’est toi qui me l’as appris. J’ai lâché le poisson pour t’éviter la peine de le lâcher après !
À quelques jours de là, ils reçurent la nouvelle qu’un parent octogénaire, mandarin en retraite qu’ils n’avaient pas vu depuis longtemps, les honoreraient bientôt de sa visite.
— Sais-tu comment il faut parler avec les personnes âgées et titrées, tête de linotte ? demanda le mari.
— Non, apprends-moi, répondit la femme.
— Avec ces respectables vieillards, il faut être très poli. Tu ne prendras la parole que lorsqu’il t’aura interrogée. S’il te demande des nouvelles de ta famille, il faut lui demander aussi des nouvelles de la sienne. Bref, il faut rendre politesse sur politesse et même surenchérir. Quand il viendra, je feindrai d’être absent pour un moment et te laisserai parler seule avec lui pendant une demi-heure. Mais attention, je me cacherai derrière le rideau et prêterai l’oreille à tes moindres paroles.
Le vénérable visiteur arriva.
— Je suis heureux de te voir, ma petite nièce ! Comme tu as grandi depuis trois ans que je ne t’ai pas vue. Je me rappelle t’avoir connue toute petite, pas plus haute qu’une botte.
— Je suis très heureuse de vous voir aussi, grand-oncle. Vous avez poussé de plusieurs coudées depuis que je vous ai perdu de vue. Je me rappelle vous avoir connu tout petit enfant, quand vous n’étiez pas plus haut que mon genou.
— Comment vont tes grands-parents ? Ils étaient mes bons amis.
— Merci, ils se portent très bien. Et à propos, comment se portent vos aïeux ? Ils étaient pour moi d’excellents camarades d’enfance.
Croyant que cette petite écervelée le mystifiait, le vieux mandarin demanda d’un ton courroucé :
— Où est ton mari ? Appelle-le moi tout de suite !
— Il est là, derrière le rideau. Il écoute si je sais causer avec vous comme il me l’a recommandé.
Le gardien de la pagode, le chef du village et le mandarin du district se laissent duper par une veuve
Dans un district, vivait une jeune veuve de belle d’allure et vive d’esprit. Nombreux étaient les prétendants qui venaient la solliciter et l’importuner. Parmi ceux-ci, le gardien de la pagode, le chef du village et le mandarin du district rivalisaient d’ardeur pour plaire aux yeux de la belle. Cependant, les propos galants, les paroles allusives, les œillades amoureuses la laissaient indifférente. Mais un jour, elle se dit : « Tous les trois sont des personnages importants qui, plus d’une fois, ont apporté assistance à la famille. Il ne faut pas les repousser avec brusquerie ». Aussi leur réserva-t-elle un accueil bienséant, ce qui aviva encore l’espérance des trois amoureux. À la fin, lasse de jouer la comédie, elle décida de leur donner une bonne leçon, surtout au chef du village qui se montrait particulièrement entreprenant avec d’elle.
Un jour, elle vit arriver le gardien de la pagode. Après les premières paroles d’accueil, celui-ci avança timidement :
— Je souhaiterais avoir un petit entretien en tête-à-tête avec vous.
La veuve s’empressa de répondre :
— Mais bien sûr ! Pourquoi pas ce soir ?
Le gardien de la pagode, qui n’en croyait pas ses oreilles, redemanda :
— Est-ce sérieux ce que vous venez de dire ?
— C’est on ne peut plus sérieux, venez cette nuit à la veillée.
Après le départ du gardien de la pagode, la veuve se rendit tour à tour chez le chef du village et le mandarin du district pour les inviter eux aussi, ce qui les rendit fous de joie.
Cette nuit-là, au moment où la lune descendait à l’horizon, le gardien de la pagode vint frapper à la porte de la veuve qui le fit entrer.
— Y a-t-il quelqu’un dans la maison, s’enquit-il sans tarder ?
— Soyez tranquille, je suis seule.
Il n’attendait que cela pour se livrer à des familiarités. L’attitude consentante de la veuve l’enhardit. Au moment où il allait jouir du bonheur suprême, on appela à la porte. Quelle douche pour le pauvre homme qui se mit à trembler comme une feuille ! La femme feignit l’étonnement :
— Il me semble que c’est la voix du chef village. Que vient-il faire ici à pareille heure ?
Le gardien de la pagode, ahuri, chercha un endroit où se cacher. La femme le fit se glisser sous son lit et alla ouvrir la porte au chef du village. Après les échanges de politesses, la femme dit :
— Je profite de votre visite pour vous demander d’éclairer un doute.
— Dites.
— Humble femme que je suis, j’ignore les lois du pays et les coutumes du village. Je me demande quelle peine on peut infliger à un gardien de pagode qui passe son temps à courir le jupon.
Le chef du village répondit sans réfléchir :
— Ce vilain mérite la peine de mort.
En tête à tête avec la veuve, le chef du village trouva l’occasion favorable pour donner libre cours à ses tendres épanchements, d’autant que son interlocutrice ne semblait point réticente. Soudain, des appels se firent entendre à la porte. Il reconnut la voix du mandarin du district et s’écria :
— Ciel ! Que diable vient-il faire ici ? Où vais-je me cacher ?
— N’ayez crainte, dit calmement la femme. Suivez-moi !
Elle le conduisit dans sa chambre, le dissimula dans un coin et alla recevoir le mandarin.
Elle lui fit bon accueil en lui offrant du thé et une chique de bétel, selon l’usage ancien :
— Permettez, Excellence, que je formule une question.
— De quoi s’agit-il donc ? demanda le mandarin sur le ton le plus suave.
Quelle peine mérite le gardien de la pagode qui, la nuit, abandonne son poste pour aller conter fleurette ?
— Oh, tout au plus la bastonnade et quelques corvées, dit négligemment le mandarin.
À ces paroles, le gardien de la pagode bondit de sa retraite et vint se jeter aux pieds du défenseur de la loi en disant :
— Que le ciel vous bénisse, je vous dois la vie car, pour la même faute, le chef du village qui est là, m’avait condamné à mort !
Satire de la nature humaine
Les travers de la nature humaine ont de tout temps inspiré la moquerie. Nous en présentons quelques uns sous des titres de rubriques plutôt évocateurs : de l’inculture et de la folie, de l’avarice, de la paresse, de la vantardise, de la corruption, de l’usure, de la flatterie, de la gourmandise, du mensonge.
De fil en aiguille
Un serviteur avait l’habitude de dire tout ce qui lui passait par la tête sans suite. Son maître, un vieux richard, l’appela pour le sermonner :
— Tu racontes toujours des histoires sans queue ni tête et l’on rit autant de moi que de toi. Dorénavant, il faudra montrer plus de logique dans tes conversations, tu entends ?
Le serviteur, docile et plein de respect, accepta les reproches.
Un jour, un vieillard assis sur une natte était en train de fumer une cigarette. Son serviteur apparut et, un moment après, les mains jointes, il débita d’une voix solennelle :
— Maître, le ver à soie donne du fil que l’on vend aux Chinois, lesquels en font de la soie qu’ils nous vendent. Vous avez acheté cette soie et en avez fait faire un habit. Aujourd’hui vous avez mis cet habit, vous fumez. La cendre est tombée sur votre habit et votre habit est en train de brûler.
Alors le maître sursauta, baissa les yeux, découvrant que la partie consumée de son habit était déjà large comme la main.
Perte de soi-même
Sur l’ordre d’un mandarin, un bonze est conduit à la prison de la province par un milicien. Ce dernier, d’un esprit faible, ne cessait de se répéter, de peur d’oublier : « Voici le sac, voici le parapluie, voici la cangue, voici le bonze, me voici moi-même. Voici le sac, voici le parapluie… ». Chemin faisant, toujours obsédé par la peur d’oublier, il répétait sans arrêt à voix basse : « Voici le sac, voici le parapluie, voici la cangue… »
S’étant aperçu de cela, le bonze chercha à en profiter. Il proposa à son gardien de faire ripaille dans une auberge afin de le faire boire jusqu’à ce qu’il soit ivre mort.
Alors, le bonze se sauva après avoir rasé la tête du gardien et lui avoir mis la cangue au cou.
Quand le milicien fut dégrisé, il chercha dans tous les sens en marmonnant :
— Voici le sac, voici le parapluie, (en palpant ses poches) voici l’ordre, (puis les épaules) voici la cangue. Mais où est le bonze ?
Affolé, il chercha à s’arracher les cheveux, mais ses mains ne rencontrèrent qu’une tête complètement rasée. Il poussa alors un cri de joie :
— Ah ! Le voilà le bonze !
Le tailleur fou
Cet apprenti tailleur avait de bonnes raisons de n’être pas content. Chaque fois qu’ils allaient travailler au domicile d’un client et que l’hôte leur servait un gentil repas, son patron avait coutume de répondre que son aide venait de se restaurer en route. Résultat : il s’attablait tout seul.
Le jeune homme décida de se venger dignement. Un jour où la même comédie recommençait à ses dépens, il prit l’hôte à part et lui glissa à l’oreille :
— Faites attention, mon patron est sujet à des crises de folie furieuse !
— Pardon, un si merveilleux tailleur ?
— C’est ainsi. Il saccage tout, assomme les gens, sans aller jusqu’au meurtre toutefois !
— Il ne manquerait plus que ça ! Je vais le mettre à la porte pour préserver mes précieux tissus.
— Gardez-vous en bien ! Vous précipiteriez la crise… et vous ne trouveriez jamais son pareil dans la région ! La meilleure chose à faire est de vous tenir prêt à intervenir.
— Comment savoir ?
— Quand vous le voyez qui se lève, regarde la natte de près, lui donne de petites tapes, les yeux hagards et la mine inquiète, c’est que sa folie le gagne. C’est le moment de le maîtriser et de cogner ferme ! Quand il reprendra ses esprits, il sera délivré de son mal pour toute la journée et vous remerciera !
Le repas terminé, le tailleur, qui ne se doutait de rien, se mit au travail. Après une petite pause, n’ayant pas retrouvé ses aiguilles, il se leva, examina la natte, la gratta, frappa doucement pour voir si elles ne s’étaient pas introduites entre les interstices. Toute la maisonnée lui tomba alors dessus.
L’apprenti qui, on s’en doutait, avait caché les aiguilles, court toujours.
Le plus courageux
Les maris jobards d’un village s’étaient donné rendez-vous dans un coin retiré d’un verger. Tous se mirent d’accord qu’il fallait secouer l’intolérable joug féminin, et pour ce, décidèrent de mettre sur pied une solide association d’entraide. Ils étaient en train de peser les mérites de chacun pour l’élection d’un président, quand le guetteur donna l’alarme :
— Les ennemies, sauve qui peut !
Tous détalèrent comme s’ils avaient le feu aux trousses. Mais ce n’était qu’une fausse alerte. En revenant sur leurs pas, ils virent l’un d’eux tranquillement assis à sa place.
— Voilà le plus courageux de nous tous, c’est notre président tout trouvé !
— Ils s’approchèrent pour l’acclamer. Hélas, le brave homme était déjà mort d’effroi.
Radical
Un mari jobard est surpris par sa femme en train de rire de contentement alors qu’il fait la sieste. Elle le réveille et lui demande à brûle-pourpoint :
— Pourquoi ris-tu dans ton sommeil ?
— Je viens de rêver que tu me laissais prendre une concubine.
La femme sort de ses gonds :
— Pas possible, comment oses-tu… ?
— Mais ce n’est qu’un rêve, ma chérie !
— Il n’est pas permis de faire tels rêves !
— Bon, bon, je m’en abstiendrai désormais !
— Ne fais pas le malin, comment le saurais-je si tu ne ris plus ?
Ne trouvant aucun stratagème pour prouver sa sincérité, le pauvre homme dut jurer de ne plus jamais faire la sieste.
Ma femme a raison
En train de labourer sa rizière, un homme pauvre d’esprit est tellement absorbé qu’il en oublie de rentrer prendre le déjeuner. Sa femme, impatiente, va le chercher. Elle le hèle de loin. Notre homme répond bien haut :
— Attends, je cache la charrue dans le buisson !
Quant il arrive à la maison, sa femme irritée lui reproche :
— Tu caches la charrue, mais tu le cries à la ronde. Que quelqu’un entende et elle est perdue !
Le repas terminé, le mari va chercher la charrue dans le buisson et ne la retrouve pas. Effrayé, il court jusque chez lui et murmure à l’oreille de sa femme :
— On a volé la charrue !
Toujours la même chose
Un homme a mis par mégarde une paire de souliers dépareillés. L’un est plat et l’autre, à talon haut. Surpris de sa marche claudicante, il se plaint :
— Que c’est drôle ! Qu’est-ce qui cloche ? Mes jambes ou bien le chemin raboteux ?
— Mais non, monsieur, lui dit un passant, vous vous êtes trompé de souliers, l’un est plat et l’autre à talon haut.
Il se hâte donc de rentrer chez lui pour changer de souliers. Il examine minutieusement l’autre paire puis secoue la tête, désespéré :
— C’est toujours la même chose, l’un est plat et l’autre à talon haut.
Je ne souhaite que ça
C’est un pauvre idiot, bête comme un âne. Sa femme est obligée de lui apprendre dans les moindre détails, la manière de se conduire chaque fois qu’il doit sortir. À cause de cela, on l’appelle “Idiot” et personne ne se rappelle plus son vrai nom.
Un jour, il se rend en ville pour voir de proches parents et sa femme, une fois de plus, lui recommande :
— Une fois arrivé, si on te demande : « Est-ce bien l’Idiot qui nous rend visite ? », il faut répondre : « Oui, c’est bien moi l’Idiot ». Si on te demande : « Tu es tout seul ? », tu diras : « Oui, je suis tout seul ». Si on te demande : « Alors, veux-tu rester quelques jours avec nous ? », tu diras : « Je ne souhaite que ça, c’est très bien et j’en suis heureux ».
En route, pour ne pas s’exposer à la risée de tous, l’Idiot, marchant et gesticulant, s’applique à retenir les recommandations de sa femme en les répétant sans cesse.
Arrivé au marché, il tombe sur une foule massée autour d’un cadavre alors que l’assassin a pris la fuite.
Quand les autorités arrivent pour le constat, la foule se disperse rapidement afin d'éviter les ennuis. Seul l’Idiot s’approche hardiment pour mieux voir et il est saisi brutalement par le mandarin.
— Eh dis-moi, qui est l’assassin, tu le sais ? demande le mandarin.
Se rappelant tout à coup les recommandations de sa femme, l’Idiot répond :
— Oui, c’est bien moi, l’Idiot !
— Tu étais seul ou y en a-t-il d’autres ?
— Je suis tout seul, rétorque l’Idiot en toute tranquillité.
Sur ce, le mandarin ordonne qu’on le ligote et qu’on l’emmène. L’Idiot pense alors qu’il est temps de placer la dernière recommandation de sa femme et déclare posément :
— Je ne souhaite que ça, c’est très bien et j’en suis très content.
Un fameux mathématicien
Un idiot va au marché et y achète six bœufs. Il monte sur le premier et emmène tout le troupeau. À mi-chemin, il se retourne pour compter les bêtes qui marchent derrière lui : un, deux, trois… un, deux, trois, quatre… cinq. Il compte et recompte, sept fois et n’en trouve toujours que cinq. Effaré, il tourne et retourne la tête de tous les côtés, mais ne comprend pas.
L’idiot aperçoit sa femme l’attendant devant la porte. Toujours assis sur le dos du bœuf, il dit, des larmes dans la voix :
— C’en est fait de moi, j’ai perdu un bœuf !
Sa femme l’interroge :
— Combien en as-tu acheté pour en perdre un ainsi ?
Le mari montre, derrière lui, les cinq bœufs et dit :
— J’en ai acheté six et il n’en reste que cinq.
Sa femme se met à rire :
— Dis plutôt qu’il y en a de trop !
Le message
Il possédait beaucoup de rizières, mais peu de culture. Un jour où il recevait des visiteurs, son domestique lui apporta un pli :
— Une missive du chef de canton.
N’osant avouer devant le monde qu’il ne savait pas lire, il déplia le papier, fit semblant de le parcourir rapidement des yeux et dit :
— Fais venir le messager !
Celui-ci arriva et s’entendit ordonner :
— Va dire à monsieur le chef de canton que je suis d’accord pour me rendre chez lui tout à l’heure.
Interloqué, l’homme se gratta l’oreille et répondit respectueusement :
— Je ne sais si vous avez bien lu ce qu’a écrit mon maître, il vous prie simplement de lui prêter votre étalon !
Trois générations d’originaux
Ils avaient tous plus ou moins de raisonnement dans la famille. Le grand-père remit un jour deux sapèques à son petit-fils et lui dit :
— Achète-moi une sapèque de saumure et une autre de jus de soja !
L’enfant prit l’argent, deux bols, courut chez le boutiquier mais revint, perplexe.
— Grand-père, avec quelle sapèque dois-je payer la saumure et quelle sapèque le soja ?
— N’importe laquelle, voyons, répondit le vieillard ennuyé !
Nouveau départ de l’enfant et nouveau retour bredouille :
— Grand-père, dans quel bol faut-il mettre la saumure et dans quel bol le soja ?
Le grand-père exaspéré se saisit du rotin.
Survint alors le père de l’enfant qui s’indigna :
— Eh bien, si tu fouettes mon fils, moi je vais corriger le tien !
Et de se donner la bastonnade.
Le vieillard bondit :
— Ah c’est comme ça, je vais pendre ton père, moi !
Sans le secours des voisins, le vieillard se serait pendu aux poutres.
Simple déplacement
Rentré de promenade, un richard était tout en eau, le soleil étant particulièrement accablant ce jour-là. Affalé dans un fauteuil, il se laissa éventer par un petit domestique.
— Plus fort, plus vite ! dit de temps en temps le maître pour empêcher le serviteur de se laisser aller.
Une demi-heure après :
— Merveilleux, dit-il, la sueur a complètement quitté mon corps !
Le domestique se mit alors à rire en haletant :
— Mais elle est venue sur le mien, maître !
Le son du monocorde
Un homme jouait fort mal du monocorde (đàn bầu) mais, persuadé d’avoir du talent, il continuait à gratter son instrument.
Un jour, il rencontra sa voisine, une jeune veuve, toute en pleurs. L’homme crut que les larmes étaient causées par sa musique et son talent. Dès lors, il se mit à jouer toutes les nuits, espérant séduire la belle. Quand il eut acquit la certitude que son art avait bien servi son destin, il l’aborda.
— Madame, quel chagrin vous ronge-t-il donc si fort ? J’ai remarqué que vous pleurez dès que je joue du monocorde. S’il en est ainsi, je suis prêt à tout abandonner.
— Monsieur, dit-elle en baissant les yeux, quand vous jouez votre instrument, je ne puis m’empêcher de penser à feu mon époux.
Notre musicien réjoui, demanda :
— Votre mari était sans doute un joueur des plus renommés ?
— Mais non, lui rétorqua la dame, il était cardeur de coton. Quand vous pincez votre monocorde, je crois entendre son métier et c’est pourquoi je pleure, Monsieur !
Ensemble instrumental “traditionnel rénové” — selon la conception du Conservatoire National de Musique de Hanoi — interprétant de la “néo musique traditionnelle”. Il est composé d’une cithare monocorde (đàn bầu), d’une cithare trapézoïdale à trente-six cordes frappées (đàn tám thập lục), d’un luth pyriforme à trois cordes (đàn tỳ bà) et d’un luth trapézoïdal à quatre cordes (đàn tư bass).
Interprètes : Bùi Lệ Chi (đàn bầu), Đặng Hoài Thu (đàn tỳ bà), Nguyễn Thị Minh Lê (đàn tư bass), Nguyễn Thu Thủy (đàn tám thập lục).
Lieu & date : Viêt Nam, vill. de Hanoi. 20 mars 1993.
Durée : 02:12. © Patrick Kersalé 1993-2024.
Échange
Un homme riche, qui n’aimait pas les dépenses, reçut un jour la visite d’un ami de longue date.
— Hélas, se plaignit-il, tu me vois dans le désespoir ; je voudrais bien te garder à dîner, mais mon buffet est vide !
— Qu’à cela ne tienne, dit l’ami, fais abattre mon cheval et l’on aura de quoi festoyer comme deux rois !
— Mais comment rentreras-tu ? demanda l’avare par acquit de conscience.
— Pas difficile, avec ta permission, je prendrai comme monture une de tes oies dodues qui se promène dans la cour, elle saura bien remplacer mon cheval, que diable !
Un champion
Il était une fois un père aussi despote que spéculateur qui maria ses deux filles à deux avares. La coutume voulait que les jours de fêtes traditionnelles, les enfants offrent, en témoignage de leur piété filiale, des présents à leurs parents et leurs beaux-parents.
Nos deux gendres, tout avares qu’ils étaient, ne pouvaient cependant se soustraire aux prescriptions de la morale traditionnelle. Ils firent alors tout ce qui était en leur pouvoir pour les rendre aussi clémentes que possible pour leur bourse. Les présents consistaient ordinairement en porcs, chèvres, poulets, canards vivants et autres choses semblables. Le premier gendre imagina un stratagème qu’il mit aussitôt à exécution. Il se rendit chez un fabricant d’objets de culte et acheta un dessin colorié représentant tout ce qui pouvait satisfaire les exigences les plus implacables d’un beau-père : bœufs, cochons, oies, coqs et poules, fruits et alcool, etc…[1] Notre garçon rapporta triomphalement chez le père de sa moitié ces richesses dues au talent d’un peintre religieux et à l’avarice d’un gendre fesse-mathieu.
Quand il arriva, il vit venir en même temps l’autre gendre qui cachait quelque chose sous sa robe, tout en se donnant des airs mystérieux. Le premier était dévoré par la curiosité, mais aux questions qu’il posa, le mari de sa belle-sœur n’opposa qu’un mutisme solennel.
Le beau-père s’assit cérémonieusement sur sa natte pour recevoir les présents de ses gendres. Au premier, il demanda :
— Toi, que m’apportes-tu comme présents, mon fils ?
— Cette année, répondit le gendre, je me suis appauvri et ne puis, ô père, vous apporter qu’un bœuf, une vache, des oies, des fruits et de l’alcool. Les voici. Ayez la bonté de ne pas rejeter ce modeste témoignage de la piété d’un fils qui vous aime plus que sa vie et qui formule pour vous les vœux les plus ardents pour l’année qui s’ouvre.
Cette tirade lancée, il sortit de sa poche le dessin et l’offrit des deux mains à son beau-père tout en feignant de s’affaisser sous le poids des présents imaginaires.
— Bien, approuva le beau-père tout ému, je te remercie. Cependant, permets-moi de te faire une observation. Malgré ta pauvreté, tu m’as acheté beaucoup trop de choses. À mon avis, tu es trop prodigue.
— Et toi, mon fils, en s’adressant au second gendre, quelles choses agréables m’apportes-tu à l’occasion du Tết ?
C’est alors que le mari de sa fille cadette s’avança et, sortant de dessous sa robe une baguette qu’il avait tenue soigneusement cachée jusque là, dessina rapidement sur la terre battue du plancher des figures représentant grosso modo des animaux qui, par leur taille, dépassaient de loin ceux qui étaient représentés sur le dessin du premier gendre.
— Voilà, ô père, ce que je puis vous offrir tout en vous souhaitant heureuse année. Je vous prie très humblement de m’excuser de ne pouvoir vous apporter, à cause de l’étroitesse du sol de votre maison, des bœufs, des vaches et des cochons plus gros et plus gras !
— Parfait ! approuva le beau-père. Tu es certainement plus avancé que ton frère. Mais je trouve tout de même que c’est encore de la prodigalité. Et moi, en remerciement des marques de piété filiale que vous me témoignez, je vous invite, mes chers fils, à boire une tasse d’alcool que voici.
Et il fit le geste de leur verser à boire. Ayant “bu”, les gendres avouèrent qu’ils étaient indignes de leur beau-père, un génie exceptionnel.
_____________
[1] Ces marchands d’objets votifs fleurissent aujourd’hui encore. On peut y acheter du simili papier monnaie, des représentations d’objets usuels en cartonnage, notamment, pour l’anecdote, des postes de radio, de télévision, des motos, des voitures… que l’on offre aux ancêtres en les incinérant !
Prévoyant
Un vieil avare fut pris dans la gueule d’un tigre. Voyant son fils épauler le fusil, il s’écria :
— Vise les pattes ! Si tu l’atteins au corps, la peau sera abîmée et ce sera autant de perdu pour la vente !
Poisson de bois
Un homme riche mais avare devant l’éternel, ne mangeait jamais que du riz sans condiments. Un poisson de bois était suspendu au-dessus même de la table. Notre avare recommandait à ses enfants de claquer la langue une fois après chaque bouchée de riz, pour entretenir l’illusion de la saveur du poisson.
Un jour, le benjamin, âgé de quatre ans, fit entendre plusieurs claquements après chaque bouchée de riz. L’aîné, qui venait d’avoir ses six ans, rapporta la chose à son père. L’avare indigné dit :
— Qu’il mange donc salé et qu’il en meure !
Je préfère mourir
Un jour, un ami vint chercher un avare pour l’emmener faire un tour en ville. Au début, l’homme refusa. Mais l’ami insistant, il alla prendre dans sa chambre trois ligatures de sapèques qu’il glissa dans sa ceinture avant de partir.
Arrivé en ville, il fut tenté par tout ce qu’il voyait mais, par peur de dépenser de l’argent, il n’acheta rien. Il faisait un soleil de plomb et malgré un désir ardent de boire quelque chose, il n’entra dans une aucune auberge pour ne pas avoir à inviter son ami.
L’après-midi, au moment de rentrer, les deux compagnons empruntèrent le bac. Arrivé au beau milieu du fleuve, l’avare, assoiffé, ne put plus résister : il se baissa pour boire de l’eau.
Par malchance, il tomba dans le fleuve, tête la première. L’ami se mit à crier :
— Celui qui sauve mon ami aura cinq ligatures de sapèques comme récompense !
L’avare, au milieu du fleuve, réussit à sortir la tête de l’eau pour crier :
— Cinq ligatures, c’est trop cher !
L’ami se reprit :
— Trois alors !
L’autre sortit à nouveau la tête hors de l’eau :
— Trois, c’est encore trop, je préfère mourir !
Un fameux flemmard
Un vieux richard était père d’un beau brin de fille. L’homme, qui avait répugné à tout effort sa vie durant, prisait si fort la paresse qu’il refusait tous les beaux partis, s’obstinant à déclarer n’accorder la main de la demoiselle qu’à plus paresseux que lui.
La fille commençait à s’impatienter et son père à déplorer la dégradation des bonnes habitudes, lorsqu’un jour, prenant le frais sur le perron de la maison, il vit arriver un jeune homme hirsute qui marchait à reculons. Le vieux ne put s’empêcher de rire :
— Qu’est-ce que tu fais là ? s’enquit-il.
— Je viens vous demander la main de Mademoiselle votre fille.
— Mais pourquoi marches-tu à reculons ?
— Pour n’avoir pas la peine de tourner les talons en cas de refus.
Le richard, estimant qu’il avait trouvé son maître, lui donna sa fille en mariage.
Plus fort que son maître
Ce maître d’école méritait si bien sa réputation de paresseux qu’il n’avait plus aucun élève. Un jour, à sa grande stupéfaction, un adolescent vint lui demander à s’inscrire.
— Eh bien, dit le précepteur fort ennuyé, puisque tu y tiens, cours emprunter une table !
— Pourquoi faire, maître ?
— Pour mettre dessus le bétel et les noix d’arec et te présenter à Confucius selon les rites.
— Hum, hum, grommela le jeune homme en se grattant l’oreille. Puis-je plus simplement me tenir à quatre pattes avec les offrandes sur le dos, cela nous épargnera à tous les deux bien des désagréments !
À ces mots, le maître salua jusqu’à terre le jeune prodige :
— Mon ami, lui dit-il, qu’as-tu besoin de prendre des leçons, tu es déjà beaucoup plus paresseux que moi !
Pris à son propre piège
Un précepteur avait l’habitude de dormir dans la journée, mais il battait son élève pour le même forfait. Agacé, l’étudiant lui demanda :
— C’est si fatigant d’assimiler vos caractères cabalistiques, pourquoi ne me laissez-vous pas m’assoupir un peu alors que vous dormez sans rien faire ?
Ce à quoi le précepteur répondit d’un ton péremptoire :
— Mais je ne dors pas dans la journée, j’entre en communication avec les grands maîtres défunts !
Un jour, alors que le précepteur dormait, l’élève s’endormit à son tour. Le précepteur, qui se réveilla le premier, secoua l’élève et le réprimanda :
— Fainéant, tu laisses tomber ton livre pour dormir ?
L’élève répondit :
— Monsieur le professeur, je ne dormais pas, j’entrais en songe pour me présenter aux grands maîtres défunts.
Piqué, le précepteur répliqua :
— Tu t’es présenté à eux et qu’est-ce qu’ils t’ont dit ?
L’élève répondit :
— Ils m’ont dit : « Cela fait longtemps que ton précepteur ne nous a pas rendu visite. » Je leur ai alors fait savoir que vous leur aviez rendu visite hier. Alors, très mécontents, ils m’ont dit : « Rentre et dis à cet imposteur qu’il ne doit plus mentir ! »
Qui me nourrira ?
Il a vingt ans, mais tellement paresseux qu’il ne connaît aucun métier et vit aux crochets de son père. Une voyante lui prédit :
— Votre père vivra jusqu’à quatre-vingt ans et vous, jusqu’à soixante-deux.
À ces mots, le jeune homme éclata en sanglots. La voyante étonnée :
— Mais quoi ? Une aussi longue vie ne vous plaît pas ?
Et lui de se lamenter :
— À vous croire, mon père mourra deux ans avant moi. Alors dites-moi, pendant des deux années, qui me nourrira ?
Assaut de vanité
Il était une fois, un richard qui ne laissait passer aucune opportunité de vanter son abondance. Un jour, il prépara, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de son père, un grand festin auquel il voulut convier tous ses amis et parents. Il acheta un gros cochon et s’apprêtait à l’égorger quand l’animal, mal ligoté, s’échappa. Son propriétaire le chercha partout. Ayant rencontré sur la route un inconnu et dévoré le désir de lui faire savoir ce qui se passait chez lui, le vaniteux demanda :
— Monsieur, aujourd’hui je célèbre l’anniversaire de la mort de mon père pour lequel j’ai voulu égorger un gros cochon, car au festin, j’ai l’intention d’inviter le plus grand nombre possible de parents et d’amis. Auriez-vous vu mon gros cochon quelque part ?
L’autre, qui portait un habit tout neuf, répondit :
— Depuis que j’ai eu l’avantage de mettre le bel habit que vous voyez, qui est de soie et que j’ai acheté très cher, je n’ai vu nulle part votre cochon.
Le serpent carré
Un jour, revenant de promenade, un grand hâbleur dit à sa femme :
— Tu sais, aujourd’hui je suis allé dans la forêt, j’ai vu un serpent… grand, mais si tu savais… bien vingt mètres de large et cent vingt mètres de long !
La femme, qui connaît son mari, décide de le taquiner un peu. Elle fait la moue et répond :
— Ça n’existe pas des serpents aussi longs !
— Tu ne me crois pas ? Si ça n’était pas cent vingt mètres, il arrivait bien à cent mètres !
— Cent mètres, il n’en existe pas non plus.
Désirant être cru par sa femme, il dit :
— Je t’assure, peut-être pas cent mètres, mais bien quatre-vingt !
Sa femme hoche encore la tête :
— Mais non, quatre-vingt mètres non plus ça n’existe pas, pas possible.
Le mari qui s’entête, s’écrie :
Mais c’est la vérité ! S’il ne mesurait pas quatre-vingt mètres, eh bien, soixante !
La femme, le visage renfrogné :
— Soixante, c’est encore trop long !
Le mari, prenant un air sincère :
— Il ne faisait pas soixante mètres, mais pour le moins, quarante.
Sa femme n’en continue pas moins à l’abuser :
— Même quarante mètres, il ne les faisait certainement pas.
Le mari se voit forcé à une nouvelle concession :
— Écoute, je vais te dire la vérité ! En fait, le serpent que j’ai aperçu faisait juste vingt mètres, pas un centimètre de moins !
La femme, alors, se tord de rire :
— Juste vingt mètres de large et vingt mètres de long. Alors c’était un serpent carré !